04 octobre 2022
La greluche et le renard, ou le retour de Thomas Clavel
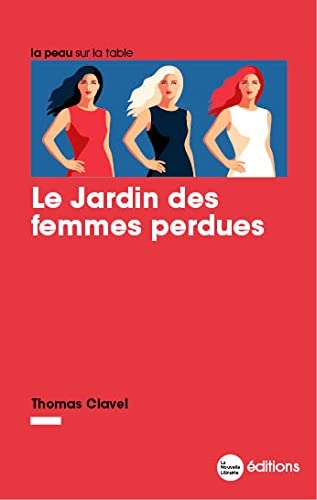
Naguère (voir ici-même mes chroniques des 19 juillet XX et 29 mars XXI), j’ai eu le plaisir de saluer les débuts d’un jeune romancier, Thomas Clavel, auteur de deux salubres et courageux romans. Un Traître mot dépeignait une France où les crimes de langue seraient punis avec une toute autre sévérité que les crimes de sang et où l’imposture victimaire, la traque des phobies les plus absurdes, la rééducation lexicale seraient devenues la règle.
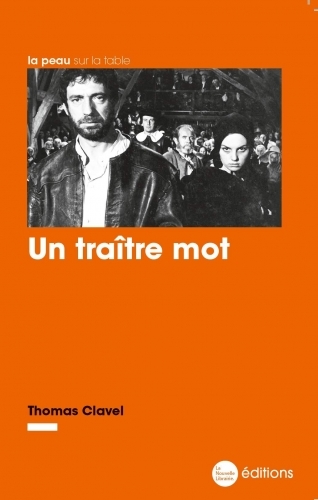
Hôtel Beauregard mettait en scène la toute-puissance de réseaux sociaux piratés par des êtres maléfiques, que, soit dit en passant, cette atroce Guerre d’Ukraine a fait se multiplier encore davantage, guerriers de clavier ou stratèges de cuisine.
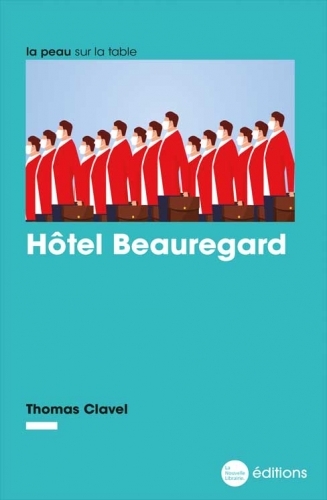
Dédié à Tantale, inventeur du désir, Le Jardin des femmes perdues est donc son troisième roman, ou plutôt, lui aussi, une sorte de conte philosophique - comme une variation contemporaine des Liaisons dangereuses. Avec une belle virtuosité, Thomas Clavel s’est amusé à camper deux types humains antithétiques, deux destins que nous découvrons par le truchement de journaux intimes au ton si différent : Victor, le séducteur, et Magali, la midinette, que la Providence fait habiter dans le même immeuble parisien.
Le premier, nietzschéen caricatural, qui fait songer au Costals des Jeunes Filles, est un vieux marcheur : il « manœuvre comme un doge et bondit comme un dogue » sur ses proies féminines. Son journal n’évite pas le ton emphatique et l’autosatisfaction cynique du joueur. La seconde se révèle une parfaite midinette, mais dans le genre pernicieux (à tout prix, elle veut nuire), pseudo-féministe surie, pimbêche conscientisée collectionnant clichés et tics de langage - et surtout les prudences - de la gauche idéologique (« Quand les gens comprendront que la grosse misogynie historique, c’est un truc à la base de bons blancs bien cathos tradis et bien propres sur eux. Alors on pourra avancer. Alors on pourra parler sérieusement. »).
Le paradoxe est que ce séducteur est un naïf et que cette vertueuse, qui voudrait bien, elle, être séduite, ira jusqu’à dénoncer son voisin pour un viol imaginaire. Thomas Clavel s’amuse à jouer de ce genre de situation limite qui illustre notre modernité tardive, qu’il décrit avec finesse, en explorateur des gouffres.
Christopher Gérard
Thomas Clavel, Le Jardin des femmes perdues, La Nouvelle librairie, 318 pages, 18€ . Les deux premiers romans sont publiés par la même maison.
On dit du mal de Thomas Clavel dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26 septembre 2022
Exit Marc Danval

Homme de théâtre, doyen de la radio belge (plus de soixante ans de présence), collectionneur acharné, noceur impénitent, Marc Danval était - cet imparfait est bien pénible à tracer - une sorte d’ogre, un ogre sympathique en diable, doté d’une mémoire prodigieuse et de ce zeste de mythomanie qui rendait sa conversation passionnante. Né en 1937, il avait croisé, disait-il, Hitler et Churchill ; il avait vidé des verres avec les plus grands noms du jazz et de la chanson française ; il avait en fait connu tout le monde depuis les années cinquante, de Nat King Cole à Paul Delvaux, de Pierre Fresnay à Orson Welles, d’Arletty à Michel Simon. Un phénomène !
Issu d’une famille d’artistes - son grand-père, José Sevenants, était pianiste et compositeur -, il avait fait ses débuts au théâtre et au cinéma (avec Gérard Philipe !) avant de bifurquer vers Radio-Luxembourg. La nuit bruxelloise d’un certain âge d’or n’avait aucun secret pour cet habitué de la Rose noire et du Pol’s Jazz Club. Il avait été reçu par Sacha Guitry, son idole de jeunesse ; il avait fréquenté Django Reinhardt, Toots Thielemans et Dizzy Gillespie - bref, il y avait chez lui une dimension quasi légendaire, dont il jouait à merveille : d’ailleurs, Thomas Owen, l’un des maîtres de la littérature fantastique belge le qualifiait de « monstre des lettres belges ».
Cet ami très proche de Robert Goffin était aussi poète, et gastronome, oenophile, chroniqueur littéraire – et aussi généreux donateur de sa collection de vingt mille disques de jazz à la Bibliothèque royale. Un fameux personnage donc, que j’ai été heureux de côtoyer.
Que la terre vous soit légère, Marc Danval !
Christopher Gérard
Vient de paraître : Michel Albas, Marc Danval l’Epicurieux, Ed. Jourdan – La Première.
Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21 septembre 2022
In memoriam Henry de Montherlant

Le 21 septembre 1972,
Henry de Montherlant se donnait la mort.
Pensons à lui !
« Je vois qu’arrivé au terme de ma vie j’ai bouclé la boucle, je suis revenu à la foi de mon adolescence, c’est-à-dire à l’absence de foi ; mais sympathie pour la religion, mêlée à amour pour le Grand Pan ».
La Marée du soir (1972)
La voix de Montherlant :
http://www.montherlant.be/audio-32-montherlant-poeme-3.html

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19 septembre 2022
Présence de Max-Pol Fouchet
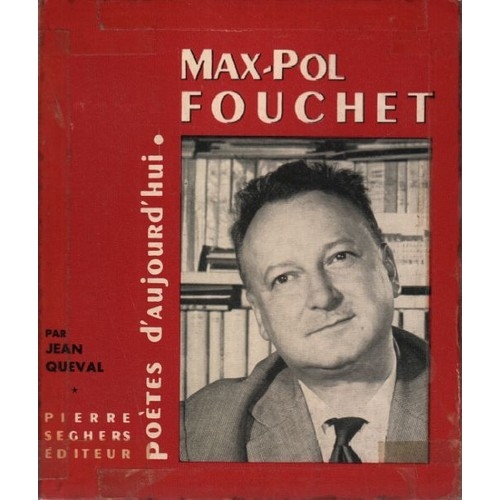
Exceptionnelle vente de livres rares - plus de 1200 lots - que celle qui se déroulera les 8 et 9 octobre prochains à l’Hôtel des ventes de Mayenne, puisqu’il s’agira de disperser la bibliothèque de Max-Pol Fouchet (1913-1980). Poète, fondateur en 1939 de la revue Fontaine, écrivain, critique, ethnologue, homme de radio et de télévision (Lectures pour tous), l’homme connut tout le monde depuis la fin des années 30 jusqu’à sa mort en 1980, soit pendant le dernier âge d’or de la littérature française. C’est le libraire de la rue Gay-Lussac, Alexis Chevalier, alias Le Pélican noir (http://www.pelican-noir.com/), un homme d’une érudition aussi fantastique que généreuse, qui a rédigé le catalogue de cette vente historique. Il a pu, l’heureux homme, pénétrer dans la maison de l’écrivain, située rue de Bièvre, et restée intacte depuis 1980, telle une bulle temporelle. Le rêve de tout bibliomane, des murs tapissés jusqu’au plafond de livres, souvent en édition originale…

Parmi les pièces remarquables, le manuscrit autographe du poème Liberté de Paul Eluard avec envoi, texte emblématique de la Résistance. Directeur à Alger de Fontaine, revue littéraire « dissidente », Max-Pol Fouchet correspondit avec Aragon, Char, Beckett, Michaux, Artaud, Cocteau – comme en témoignent nombre de lettres mises en vente. Gide et Giono, Montherlant ( deux lettres étonnantes de 1936 sur la guerre industrielle), Saint John Perse et Yourcenar… Et des SP en cascade ; de Butor à Jaccard, de Gary à Triolet, et même Blondin, Abellio, Cioran et Dominique de Roux. Splendides lettres de Georges Mathieu aussi. Bref, une vente historique.
https://www.librairiegaylussac.fr/le-catalogue/
Christopher Gérard
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07 août 2022
Stefan George et l’Allemagne secrète
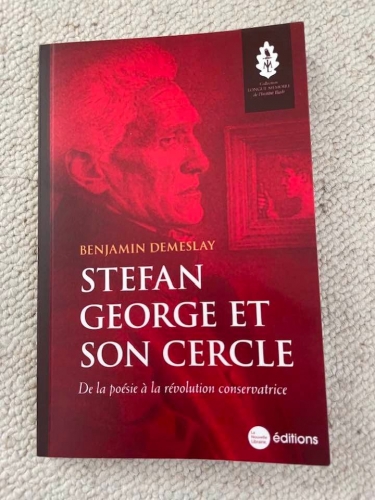
Étrange figure que celle, à la fois oubliée et occultée, du poète Stefan George (1868-1933), considéré par certains comme le Dante allemand, mort en Suisse près de Locarno, volontairement éloigné de sa patrie en un temps de grand basculement politique. Un trop bref essai de l’historien Benjamin Demeslay vient rappeler au public francophone l’existence de ce poète ésotérique et chef d’école aux allures de gourou, comme en témoignent les étonnants clichés du Maître, qui témoignent d’un art certain de la mise en scène. Traduit en français dès 1941 (chez Aubier – Montaigne), puis oublié et retraduit aux éditions de la Différence en 2009, Stefan George est peu étudié ; il n’existe à son sujet qu’une remarquable biographie en anglais, celle du professeur Robert Norton, Secret Germany. Stefan George and his Circle (Cornell Univ. Press, 2002). Se trouve aussi une grande thèse en français publiée, en 2010, sur ses liens avec Mallarmé, par son traducteur, Ludwig Lehnen.
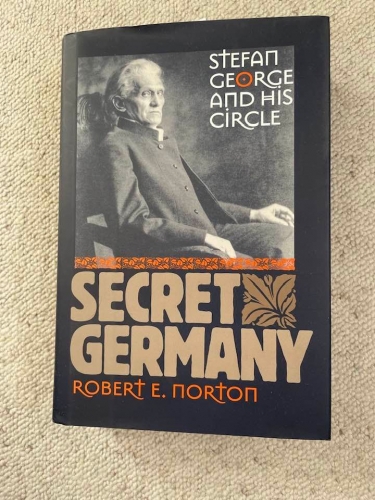
Peu de choses en somme sur un grand poète et sur son cercle de disciples, qui compta d’immenses esprits tels que Kantorowicz, Klages, Bertram, sans oublier les frères von Stauffenberg, conjurés de l’Attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944.
Stefan George appartint à ce courant idéaliste, ou « fondamentaliste esthétique », héritier du symbolisme, influencé par Baudelaire et Mallarmé, proche de peintres tels qu’Ensor et Khnopff, radicalement antimoderne, quasi platonicien (y compris dans ses dimensions « homophiles », l’attachement du Maître et de ses disciples n’évitant pas l’équivoque). Dès la fin du XIXème siècle, par ses poèmes et sa revue Feuilles pour l’Art (1892-1919), George illustre et défend une vision radicale de l’art et de la vie sous une forme souvent cryptique, ouvertement ésotérique. Il s’inscrit, comme chez Wagner ou Paul de Lagarde, dans un vaste mouvement postromantique d’affirmation de l’identité germanique et de l’approfondissement de ce que le poète nomme Allemagne secrète. Son recueil, Le Nouvel Règne (1928), le place à l’avant-garde du mouvement national, avec toutes les ambiguïtés que l’on devine. Dès 1933, le nouveau « règne » révèle ses penchants populaciers et criminels. Le poète s’éloigne ; le régime le met à distance après une timide tentative de récupération. Stefan George partage en ce sens le destin malheureux de la Révolution conservatrice et de tous ceux qui rêvèrent à une restauration d’un ordre traditionnel, comme les frères Jünger, Martin Heidegger et Carl Schmitt, qui passèrent rapidement du statut d’alliés potentiels à celui d’adversaires étroitement surveillés. Ce revirement est incarné par la chevaleresque figure du comte Claus von Stauffenberg, disciple favori du Maître, qu’il veilla en 1933, futur conjuré de 1944, fusillé par les SS en criant « Vive l’Allemagne secrète ! ».
Fascinante figure, ambiguë certes, que celle de ce révolté contre l’apocalypse moderne, et qui marqua des esprits aussi éloignés de lui qu’Adorno et Schönberg.
Christopher Gérard
Benjamin Demeslay, Stefan George et son Cercle. De la poésie à la révolution conservatrice, La Nouvelle Librairie, 72 pages, 9€
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







