10 janvier 2023
Bruno Lafourcade, janséniste de Gascogne
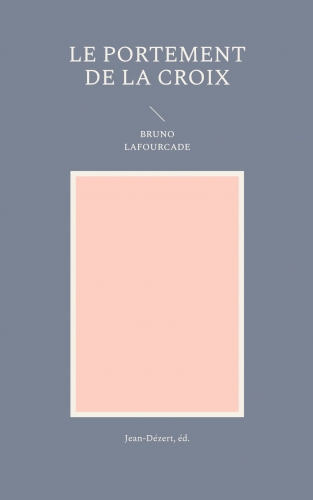
J’ai déjà parlé de Bruno Lafourcade, romancier et critique, fin lettré au physique de rugbyman, homme du Sud-Ouest (qui parle l’occitan), révulsé par le triomphe des cacographes et des impostures de l’époque, lui qui s’obstine, en probe artisan, à user d’une langue précise, ponctuée à la perfection et au style percutant.
Ainsi, par exemple, dans Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, essai sur la condition de l’écrivain, il évoque la fécondité en art des entraves comme du remords - et même de l’humiliation : tout ce qui tanne le cuir de l’impétrant en lui faisant prendre conscience de sa petitesse : « Il n’y a pas de littérature sans filiation, sans goût du passé, sans tombeaux à fleurir ; il n’y a pas d’art sans morts à bercer ».
Je viens de lire Le Portement de la Croix, roman qui vient d’être réédité. Dans l’un de nos échanges épistolaires, il m’écrivait que ce livre n’était pas pour moi, car trop chrétien. Il avait tort : je l’ai lu d’une traite et le considère comme une œuvre magistrale, digne de Bernanos (Lafourcade a d’ailleurs consacré une belle étude à Monsieur Ouine).
Le titre fait allusion à une sculpture en bois découverte dans une grange de Saint-Marsan, œuvre probablement due à des cagots, cette caste de parias censés descendre de lépreux, de cathares ou de Sarrasins, forcés de vivre à l’écart et de ne pratiquer que les métiers du bois. Un ancien calvaire noyé dans la broussaille joue aussi un rôle dans le roman. Double découverte, double crime atroce - dont les démoniaques prémices sont décrites successivement par un étudiant en théologie, par un jeune abbé et par le surveillant du collège oratorien de la Croix-Juguet, théâtre de l’un des meurtres. Envoûtante, l’atmosphère du récit doit beaucoup au jansénisme comme à la sorcellerie paysanne. Je ne sais si Lafourcade est vraiment catholique (il se prétend « plus pharisien que samaritain »), mais il « parle » catholique de façon troublante, et profonde se révèle sa culture théologique. Ses réflexions sur la laideur comme signe de l’absence de Dieu, sur le libre-arbitre et la grâce, sur la foi, cette démence (« La foi ne rend pas fou, elle est une folie ») s’inscrivent à la perfection dans la trame de cette tragédie, menée, oui, de main de maître.
Christopher Gérard
Bruno Lafourcade, Le Portement de la Croix, 202 pages, 17€ .
A commander à jeandezert.editeur@gmail.com
Lire entre autres sur ce site ma chronique du 8 juin 2021 :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2021/06/08/bruno-lafourcade-conseiller-litteraire-6320824.html
Il est question de Bruno Lafourcade dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20 décembre 2022
SOLSTITIUM

A tous les amis & correspondants
joyeux solstice d'hiver
et heureuse année MMXXIII
Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22 novembre 2022
Olivier Maulin, écrivain sauvage

Auteur d’une dizaine de romans picaresques, Olivier Maulin est, je l’ai dit naguère, un drôle de pistolet, dont la découverte de la littérature est passée par la farce médiévale. Ses romans, pleins d’une truculente poésie, font songer aux livres d’Henri Vincenot et son style peut parfois se révéler célinien. Il y a chez lui, dans les œuvres comme dans sa manière d’être, un je-ne-sais-quoi de féodal et de déjanté qui suscite une immédiate sympathie. Maulin aime Léautaud, ce qui est toujours bon signe. Et, par-dessus le marché, il est devenu royaliste le jour où il a serré la main de Baudouin, le roi des Belges en visite officielle à Paris.
C’est dire ma joie quand j’ai reçu Le Temps des loups, son dernier roman que publie le Cherche-Midi dans sa nouvelle collection Borderline, qui allie (sous des couvertures kitsch) mauvais esprit et totale liberté de ton.
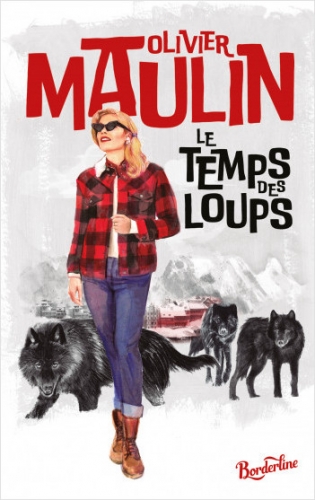
D’emblée, Maulin tape fort pour éloigner les mauvais lecteurs, les lappeurs de soupe, les perroquets qui ânonnent les catéchismes des bulletins paroissiaux de l’actuelle bien-pensance : « vieilles biques, coureuses d’expositions, fieffées salopes culturelles responsables du désastre ».
Sa chanson de geste débute lors d’un salon du livre dans un bled des Vosges, où se retrouve l’habituel gibier littéraire : écrivains hyper-subventionnés vagabondant aux frais du contribuable d’ateliers pédagogiques en résidences d’auteur (et d’autrice), romanciers alcooliques, polardeux humanitaires, pseudo-prodiges de moins de trente ans (« je suis une putain libérée, mais toujours soumise ») et, cerise sur le gâteau, Samantha Sun Lopez, illustre star américaine aux sept millions d’exemplaires vendus. C’est justement cette dinde que trois crétins hypersoniques du coin, les frères Grosdidier, veulent chloroformer et kidnapper pour toucher le gros lot. Heureusement pour nous, ils se trompent de proie et n’enlèvent que Blanche, la barmaid de la buvette. La suite dans ce désopilant roman.
L’un des écrivains de ce salon, Yvon Pottard, joue un rôle dans le déclenchement des opérations. Victime d’un commando de « féministes intersectionnelles » (sic), il prendra sa revanche en devenant l’historien officiel du royaume néo-médiéval et pagano-chrétien des Vosges qui surgira du chaos dans laquelle sombre la République, dont la devise pourrait être : « réhabiliter l’obscurantisme, revenir aux forêts hantées, aux prières collectives à la Vierge Marie et aux ballets des fées sur les landes embrumées ». Outre une sympathique société secrète de francs-bûcherons, le lecteur croisera un jeune chevelu aux mains trouées qui tente de rallier les loups à sa croisade - Jésus en personne, plutôt lucide sur son image contemporaine (« aujourd’hui, je passe pour un petit plaisantin amateur de table rase, apôtre du chaos et du déracinement qui ne sait que laver des pieds et tendre l’autre joue ») et un tantinet critique à l’égard de l’actuel pape : « grand dadais des pampas, mangeur de foin de la Patagonie, jésuite bipolaire ahuri à calotte, guanaco mitré aux dents de lapin qui vend l’Europe pour trente deniers ». Je ne résiste pas au plaisir coupable de citer cette charge contre l’abstraction : « Ce sont les morts qui nous gouvernent (…) On n’est pas des petits individus partis de rien, capables de tout. On appartient à une histoire qui nous dépasse, qui a fixé nos conduites dans ses grandes lignes sans qu’on le réalise, qui nous fait agir « naturellement » alors qu’on est pétris par les siècles ! ».
Une fois de plus, Olivier Maulin réenchante le monde avec ses chevaliers et ses loups-garous.
Christopher Gérard
Olivier Maulin, Le Temps des loups, Cherche-Midi, 322 pages, 15€
Voir aussi sur ARCHAION
ma note du 1er août 2018
http://archaion.hautetfort.com/archive/2018/08/01/avec-olivier-maulin-6070064.html
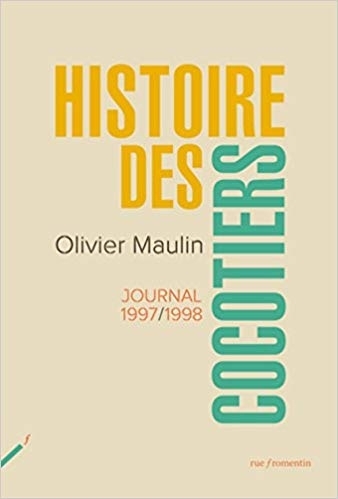
Il est question d'Olivier Maulin dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, cherche-midi | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09 novembre 2022
Jean-Baptiste Baronian, gastrologue & culinographe
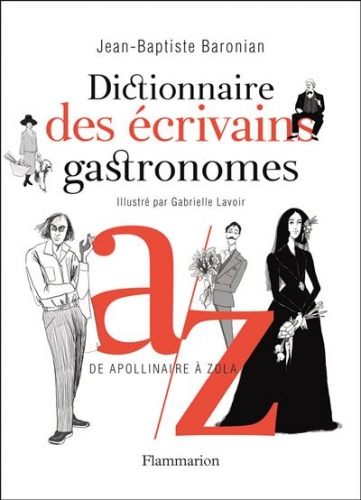
Pour le connaître un peu, je sais que Jean-Baptiste Baronian est une sorte d’ogre. La cravate n’y change rien : sous des dehors policés, l’homme est un affamé, un fauve à l’appétit universel. Viandes rouges et éditions originales, symphonies et polars, vins du Rhône et du Bordelais, tout est bon pour combler, un bref instant, sa fringale d’Agathopède (pour ce mot, voir son Dictionnaire amoureux de la Belgique).
Il vient de le prouver une fois de plus en publiant son Dictionnaire des écrivains gastronomes, d’Apollinaire à Zola, monument d’érudition sauvage où j’ai l’honneur et le plaisir de figurer avec quelques Belges, et non des moindres, de Pirotte à des Ombiaux, de Goffin à Namur. Notre encyclopédiste s’est amusé à répertorier culinographes & gastrologues, amateurs de bonne chère et adeptes de la dive bouteille.
Leurs communs ancêtres ? Rabelais et Balzac, et Dumas, assurément. Les élus doivent avoir composé non des livres de recettes (sauf avec un réel talent littéraire, comme Brillat-Savarin, Curnonsky ou Coffe), mais illustré dans leur œuvre le plaisir de manger ou de boire, qui « passe par l’esprit et par l’imaginaire ».
Un défilé de fines gueules, en somme, où l’on croise Agatha Christie et Gérard Oberlé, Jacques Chardonne et Sébastien Lapaque, San Antonio et Michel Houellebecq, tant d’autres comme le pantagruélique docteur Daudet, le bretteur royaliste, qui proclamait haut et fort : « Les régimes sont une abominable blague ».
Christopher Gérard
Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire des écrivains gastronomes. De Apollinaire à Zola, Flammarion, 432 pages, 26€
*
**
Voir aussi :
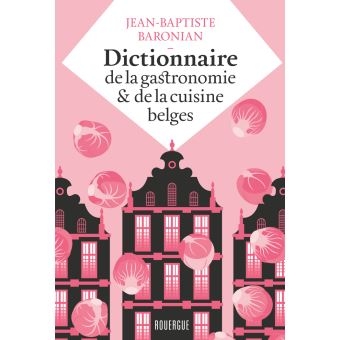
Gourmet et gourmand, le très érudit Jean-Baptiste Baronian nous livre avec ce Dictionnaire de gastronomie & de cuisine belges à l'étonnante couverture fuschia la suite, en quelque sorte, de son Dictionnaire amoureux de la Belgique (Plon).
Avec un soin maniaque et sans lésiner sur les détails les plus pointus, l'auteur promène son lecteur dans l'histoire culinaire et littéraire du royaume, depuis la fin du Moyen Age jusqu'à nos jours. Des incunables aux guides Delta, Baronian a tout dévoré sur la cuisine belge, que le grand Curnonsky considérait comme la meilleure d'Europe... après la française.
Surtout, comme l'homme n'est pas le moins du monde cuisinier mais plutôt amateur averti et exigeant bon vivant, il s'est intéressé non point aux recettes mais à l'histoire des mets, à leurs origines plus ou moins lointaines, même s'il montre que maintes recettes dites "traditionnelles" ne remontent pas nécessairement à Ambiorix.
Et, a contrario, plus d'une recette inventée par tel chef prestigieux, semble bien exister depuis l'aube des temps.
De cette cuisine que son cher Baudelaire trouvait "dégoûtante et élémentaire", Baronian connaît tous les secrets, tous les parfums. Son impressionnante mémoire à la fois gustative et littéraire lui permet de citer fort à propos les grands gastronomes, d'Escoffier à Gaston Clément (qui régna sur les cuisines belges), mais aussi les écrivains, ses confrères, d'Alexandre Dumas à Simenon, de Ghelderode à Léon Daudet, sans oublier l'auteur d'Aux Armes de Bruxelles - la fine fleur, en somme. Il n'oublie pas les grands chefs, d'Yves Mattagne à Pierre Wynants, d'Alexandre Lous à Marcel Kreusch.
Des anguilles au vert au waterzooi, des asperges de Malines au speculoos, le lecteur goûte à tout ce que la joyeuse Belgique produit d'euphorisants. Blanche de Louvain (dont Hugo fustigeait "l'arrière-goût odieux"), cramique, crevettes grises, huîtres d'Ostende (célèbres au XIXème, et chantées par Nerval), faro ("de l'eau deux fois bue" dixit Baudelaire), filet américain (qui remonterait au XVIIIème) - tout nous est révélé des mystères de la gastronomie thioise. Jusqu'à l'origine véritable des frites, introduites à Bruxelles par des émigrés parisiens.
Un mythe s'effondre, celui de l'autochtonie belge des frites...
Qu'à cela ne tienne, noyons donc notre chagrin à coups de kriek à la cerise et de genièvre au citron dans les estaminets bruxellois, par exemple à la Fleur en Papier doré, comme les surréalistes et les membres du groupe Cobra, comme Thierry Marignac et Jérôme Leroy !
Christopher Gérard
Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire de la gastronomie & de la cuisine belges, Editions du Rouergue, 312 pages, 28€
Il est question de cet écrivain dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures, XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05 novembre 2022
Avec Alain de Benoist

Non-conformiste de toujours, Alain de Benoist (1943), est l’auteur de dizaines de livres érudits sur l’identité européenne, la décroissance, l’écologie, le sacré et ses métamorphoses, les droits de l’homme, le populisme, le Jésus historique, etc. Il est aussi le propriétaire de la plus importante bibliothèque privée de France, près de deux cents mille volumes. Ce diable d’homme, qui est mutatis mutandis pour toute une génération l’équivalent de Maurras, a tout lu … jusqu’à l’œuvre complète d’Alain de Benoist !
Depuis la fin des années soixante, avec une régularité d’horloger du Grand Siècle, il travaille inlassablement à une refondation de la pensée conservatrice, ce qui lui a valu d’indignes procès d’intention et a fait de lui l’un des intellectuels français les plus ostracisés.
Son récent Contre le libéralisme. La société n’est pas un marché (Rocher), dont j’ai parlé ailleurs, livrait le fruit d’intenses réflexions sur le libéralisme comme idéologie, sur son anthropologie (fausse) et sur sa conception (réductrice) de la liberté, vues d’un point de vue conservateur : « Le libéralisme n’est pas l’idéologie de la liberté, mais l’idéologie qui met la liberté au service du seul individu. La seule liberté que proclame le libéralisme est la liberté individuelle, conçue comme affranchissement vis-à-vis de tout ce qui excède cet individu. Le principe d’égale liberté se fonde lui sur le primat de l’individu dans la mesure où celui-ci n’est plus considéré comme un être politique et social, mais comme un atome qui n’est par nature intrinsèquement lié à aucun autre. La liberté libérale se pose ainsi de manière abstraite, indépendamment de toute appartenance ou ancrage historique. »
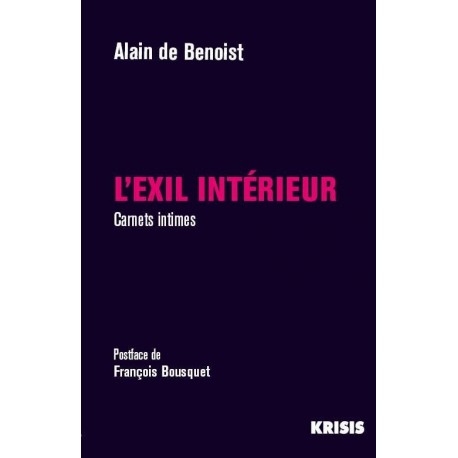
Avec L’Exil intérieur, Alain de Benoist délaisse un instant sa passion pour l’histoire (engagée) des idées. Il livre ici ses carnets intimes depuis un demi-siècle, près de trois cents cinquante pages d’aphorismes, de citations, de réflexions souvent lapidaires, exercice où il excelle. Le ton en est direct, dépourvu de fioritures, intimiste sans jamais abandonner une tenue de bon aloi. Les confidences affleurent, sans une once de sensiblerie ni d’apitoiement : juste le bilan d’un homme qui atteint bientôt sa huitième décennie et qui se retourne sur soixante ans de lectures et de ruminations, fidèle à la devise familiale : « Du goût, de l’ordre, de la patience et du temps ». Le titre donne le ton : Alain de Benoist n’aime guère l’état présent de notre civilisation ; la modernité lui paraît laide et anxiogène. Etranger à ce monde, en état de relative sécession, mais nullement aigri, encore moins haineux, il fait sienne la phrase d’Edgar Quinet placée en exergue de son livre : « Le véritable exil n’est pas d’être arraché à son pays mais d’y vivre et de n’y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer ». Comment ne pas partager ce sentiment ?
L’homme confesse une part de ruse et d’ambivalence, un côté Janus bifrons : « J’aime autant Céline que Montherlant ». D’où, sans doute, cette volonté tenace, de dépasser les antinomies devenues des blocages mentaux. Issu de la droite radicale des années soixante, il n’aura en effet cessé de tenter de clarifier la sensibilité « de droite »… tout en s’empressant de préciser : « A l’aube des années décisives, il est triste d’appartenir à un camp dont on sait par avance qu’à l’heure des décisions il fera le mauvais choix. » Cette atroce guerre d’Ukraine confirme son intuition…
Mais, pour le citer encore, l’essentiel est ailleurs : « Au-delà des causes que l’on défend, seule compte la qualité des êtres ».
Chacun trouvera son miel parmi ces pensées à dessein fragmentaires, non-systématiques, qui stimuleront sa réflexion sans toujours emporter son adhésion, peu importe, puisque l’intérêt est de suivre cet esprit qui se libère des dogmes et des réflexes de son milieu d’origine sans pour autant renier qui que ce soit. Comme il le dit très bien : « La table rase est l’équivalent progressiste de la terre plate ». Et Alain de Benoist, dont un aïeul fut créé baron par Marie-Thérèse d’Autriche en 1778, a gardé de l’ancienne noblesse ce mépris de la facilité et ce goût des devoirs qui distinguent du bourgeois.
Ce qui frappe à la lecture de ces carnets, c’est la solitude de son auteur, qui, s’il a eu et conserve encore des amis précieux, chemine relativement seul. Citons-le encore : « Une idée interdite est une idée qu’on ne peut exprimer qu’à la condition d’avoir du courage. Il en résulte que, lorsqu’une idée est interdite, ce sont les courageux qui en ont le monopole ». Périlleuse posture, que les cloportes, innombrables par nature, font payer au plus haut prix.
Le plus étonnant dans ce recueil, quelques poèmes d’antan, dont je ne résiste pas à citer deux strophes :
Mais où sont passés nos feux de camp
Sous quelle braise encore couve la flamme
En quelles poitrines se sont cachés nos chants ?
Voici le pays vendu à l’encan
Et le peuple lui-même a perdu son âme.
(…)
Où sont donc passés nos feux de camp
Les chants clairs des héros et le fracas des armes ?
Les dieux enfuis laissent la place aux titans.
Combien de temps encore faudra-t-il monter la garde
Sous l’oeil froid du Soleil qui, de loin, nous regarde ?
Dans une autre vie, celui que ses vieux amis appellent Fabrice aurait-il pu devenir poète, peintre ou cinéaste ? Who knows ?
Si j’avais une autre question à lui poser, ce serait la suivante : « tout votre itinéraire ne prend-il pas sa source dans un rejet esthétique du monde moderne ? » Le lecteur de Proust se souviendra à ce propos que « les idées sont les succédanés des chagrins ».
Lisons Alain de Benoist, aristocrate et rebelle.
Christopher Gérard
Alain de Benoist, L’Exil intérieur. Carnets intimes, La Nouvelle Librairie, 345 pages, 24€ Le même éditeur réédite Mémoire vive, passionnant livre d’entretien avec François Bousquet, naguère publié par le regretté Bernard de Fallois.
Il est question d'Alain de Benoist dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







