27 novembre 2024
Avec Pierre Le Vigan

Né en 1956 à Boulogne-Billancourt, Pierre le Vigan est urbaniste, spécialiste du logement social, mais aussi philosophe ; il a étudié en profondeur les métamorphoses de la ville, la progression des pathologies contemporaines et les discours, souvent à prétentions généreuses, qui justifient la réduction des libertés concrètes. Son dernier essai, Les Démons de la déconstruction, permet de comprendre les racines d’un mouvement « qui veut nous empêcher de penser, d’inventer et de poursuivre notre histoire d’Européens. » Le mouvement woke et la « culture de l’annulation » ne constituent-ils pas une attaque frontale, menée par de nouveaux fanatiques, contre les racines de notre civilisation, et en fait de toute civilisation ? Le Vigan analyse ici les soubassements théologiques de trois charlatans promus penseurs officiels de notre postmodernité, Derrida, Lévinas et Sartre. Pour ces penseurs, la déconstruction, principe en soi intéressant s’il s’agit d’une forme bienvenue de « décapage » libérateur et non d’orgueilleuse table rase, aboutit à la négation de toute stabilité, de toute continuité, de toute réelle présence – « tout doit être tourmenté et éphémère », le mot d’ordre des nouveaux gardes woke. Rejet irrationnel de toute verticalité, effondrement de la raison, chaos méthodique - telles sont quelques caractéristiques d’une régression anthropologique. Le Vigan pointe bien ce qu’il nomme à juste titre « le désamour du monde ».
Christopher Gérard
Pierre le Vigan, Les démons de la déconstruction. Derrida, Lévinas, Sartre, La Barque d’or, 156 pages, 19.99 €
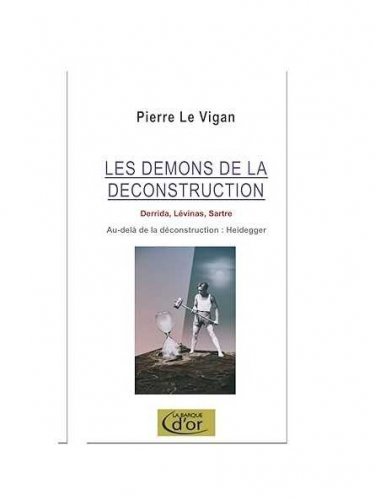
Entretien avec Pierre le Vigan
Pouvez-vous présenter votre itinéraire d’urbaniste passionné de philosophie ? Les grandes influences ?
Mon intérêt pour l’urbanisme vient de ce qu’il est au carrefour de la matérialité des choses (quoi de plus matériel qu’un bâtiment ?), de la sociologie (la vie d’un quartier), de l’économie (rien ne se construit sans argent), du politique (l’urbanisme a une fonction politique et symbolique) et de l’art. L’urbanisme n’est pas une science, c’est une pratique, mais c’est une pratique au carrefour de différents savoirs humains (notion préférable à celle de sciences humaines). En matière d’urbanisme, j’ai été très influencé par les analyses de Gaston Bardet. Proche d’Économie et Humanisme, il critique l’urbanisme fonctionnaliste, qui découpe les activités humaines en fonctions séparées, et défend un urbanisme culturaliste, différencié selon les pays et les cultures.
J’ai aussi beaucoup apprécié les travaux de Jean-Louis Harouel sur les villes et sur l’art. Dès lors, il était logique que je remonte vers des questions fondamentales sur le lien social, l’État, sur ce qui meut les hommes, sur la vérité, sur la beauté. En d’autres termes, il était inévitable que je m’intéresse à des questions philosophiques. À ce propos, j’ai toujours eu du mal à définir la philosophie comme la recherche de la sagesse. Même s’il est bon d’être sage, et si c’est sans doute le plus difficile. Mais je fais deux observations. L’une est qu’il est bon aussi de ne pas toujours être sage. L’autre est que la philosophie me paraît surtout devoir être la recherche de la vérité, et mieux encore, une réflexion sur la valeur de la vérité.
Vous avez publié des essais sur l’urbanisme contemporain et ses liens avec diverses pathologies. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Je n’ai pas publié d’essai sur « l’urbanisme et les pathologies mentales ». Si j’ai publié à la fois des essais sur l’urbanisme (Métamorphoses de la ville, La banlieue contre la ville) et des essais sur les pathologies mentales (Le malaise est dans l’homme), il ne faut pas y voir un lien systématique. J’ai été formé aux questions de psychopathologie à la fois à l’université et par l’école de Daseinsanalyse. Celle-ci est marquée notamment par les œuvres de Hubertus Tellenbach, Ludwig Binswanger et Arthur Tatossian. C’est un domaine de réflexion au carrefour de la psychopathologie, de la psychiatrie et de la phénoménologie, qui est, pour faire court, une façon d’appréhender la philosophie, c’est-à-dire certainement un peu plus qu’une « branche » de la philosophie. Je tiens à souligner que c’est une erreur que d’établir des liens rapides et automatiques entre psychopathologie et urbanisme. Néanmoins, on doit savoir qu’un certain urbanisme de masse et de plans de masse favorise l’anomie sociale, et des excès qui sont soit le ghetto soit le repli sur soi et la solitude de l’homme des foules.
Votre dernier essai porte sur la déconstruction. Comment définir ce concept sans doute galvaudé ? Quelles en sont les origines ? Peut-on parler d’une « bonne » déconstruction (au sens nietzschéen) et de l’autre, celles des « démons », qui triomphe pour le moment ?
La déconstruction désigne à l’origine une critique des textes visant à les décortiquer pour mieux les comprendre. Jusque-là, il n’y a rien à objecter. Mais elle est devenue une méthode visant à tout désenchanter, à introduire un soupçon systématique de manipulation. En ce sens, la déconstruction relève tout simplement d’une théorie du complot. Le soupçon poussé à l’extrême. Cette déconstruction a donné le « wokisme » et la « cancel culture » (culture de l’annulation de tout passé, de toute transmission, sauf la transmission d’une imaginaire culpabilité collective).
Chez Heidegger, les choses sont différentes. La déconstruction (exactement : la Dé-construction, terme proposé par Gérard Granel pour traduire Abbau) veut dire la désobstruction de ce qui nous bouche l’accès à l’être. C’est une désoccultation. Chez Nietzsche, l’équivalent de la déconstruction serait la destruction des fausses idoles, non pas – il faut le noter – au profit de la vérité, d’idoles plus « vraies », mais au profit d’idoles peut-être tout aussi fausses (qu’importe) mais qui nous poussent à faire de grandes et belles choses.
Il peut donc y avoir une déconstruction utile, celle d’encombrantes métaphysiques (« après la physique ») devenues déconnectées, justement, de la phusis (la nature, et plus largement l’ordonnancement du monde). Et il y a une « mauvaise » déconstruction, stérile plus que mauvaise pour dire le vrai, qui consiste à tout dévaloriser, à tout désenchanter, à ramener toute littérature à des dispositifs de pouvoirs, et tout processus de sélection culturelle à une discrimination insupportable. Cette déconstruction est effectivement démoniaque. Elle empêche le dialogue entre les hommes et les dieux et brise donc le quadriparti, le Geviert (la terre, le ciel, les mortels et les dieux).
En quoi cette dernière déconstruction, celle de Derrida, de Sartre et de Lévinas vous paraît-elle fondée sur « un désamour du monde » - posture qui pourrait peut-être rappeler certaines dérives dualistes, récurrentes en Occident ?
Prenons ces penseurs du plus récent au plus ancien par ordre d’influence. Derrida, c’est la déconstruction des appartenances. Je comprends tout à fait que l’on prenne ses distances avec les appartenances héritées. Les amis, c’est plus important, plus sérieux, plus profond que la famille. C’est en tout cas ma vision. Mais les appartenances héritées ne se limitent pas à la famille. On appartient à une sphère culturelle, que chacun s’approprie d’une manière spécifique, en choisissant un chemin singulier.
Lévinas maintenant. La pensée lévinassienne du « pour l’autre », du « souffrir pour la faute de l’autre » est de la fabulation du point de vue anthropologique. Cela ne veut rien dire. Un tel galimatias – une telle hémorragie vers l’Autre (et si l’Autre est un crétin ou un salaud ?) - interdit tout discernement dans les relations humaines. Il y a toutefois un intérêt à la lecture de Lévinas. C’est Heidegger vu d’en face. Lévinas, qui connaît bien la pensée de Martin Heidegger, en fait une lecture critique, de la rive d’en face. Plus je lis Lévinas, plus je sens que j’appartiens aux hommes de la rive d’en face. Celle de Heidegger. Toutefois, on peut créditer Lévinas d’une réelle honnêteté intellectuelle. De son point de vue, du point de vue de son Dieu tel qu’il l’imagine, ou tel qu’il le ressent (qui sait ?), il a sans doute raison. Mais son Dieu n’est pas le mien. Plus largement, ma conception du sacré ne passe pas par son Dieu, que je trouve bien provincial.
S’agissant de Sartre, on ne peut lui nier un certain talent – assez noir certes – de littérateur. Mais c’est fondamentalement un nihiliste. Si je cite un ouvrage critique de 1945, La sainte famille existentialiste, une vive critique de Sartre, du marxiste Henri Mougin (1912-1946), c’est que je suis d’accord avec lui au moins sur un point à propos de l’auteur de L’Être et le Néant. Je ne pense pas que le monde soit dépourvu de sens. Je pense qu’il peut en avoir plusieurs – et là je m’écarte sans doute d’Henri Mougin qui, comme marxiste, pensait sans doute que l’histoire n’a qu’un sens. Mais je pense que le monde est chargé de sens (au pluriel), qu’il nous faut opter pour certains et les assumer. Je ne crois pas que l’on puisse sortir, comme pourtant semblait l’espérer Heidegger, de l’époque des « conceptions du monde ». Il faut simplement savoir que le monde ne se réduit pas à des conceptions, qu’une part de lui échappe à ces rationalisations. Mais les conceptions du monde sont des pinces pour saisir le monde. Et là aussi, je rejoins Henri Mougin dans sa critique de Sartre et de son éloge d’une liberté complétement arbitraire, hors sol, aléatoire. Je rejoins Mougin en défendant l’esprit de sérieux contre l’esprit de dérision, l’esprit de ricanement si caractéristique de notre époque de basses eaux.
La déconstruction au sens négatif ne joue-t-elle pas un rôle destructeur pour l’enseignement et pour la transmission en général ?
La déconstruction amène à la relativisation de tout : les genres masculin et féminin, les différences entre peuples et cultures, etc. Elle amène à désenchanter le monde, et à l’uniformiser. C’est beaucoup. Et c’est beaucoup trop. « Allez, allez ! En prison : en prison pour médiocrité ! » disait Montherlant.
Vous semblez porter Heidegger très haut – comme une sorte d’antidote ?
Heidegger n’a pas besoin de moi pour être vu là où il est, c’est-à-dire très haut. Il en est de même pour Nietzsche. Vous remarquerez que Heidegger a un petit air malin, ce qui ne veut pas dire vicieux, ce qui ne veut pas dire qu’il « fait le malin », au sens de Charles Péguy. Ce petit air de celui « à qui on ne la fait pas », Nietzsche ne l’a pas, Nietzsche qui fut si malheureux, si lucide et en même temps si peu malin. Avec l’université, avec les femmes, avec tout le monde, et surtout avec lui-même. Cher pauvre Nietzsche. Riche en fulgurances, pauvre en diableries, pauvres en habiletés sociales.
Je vous surprendrais peut-être, mais les auteurs les plus importants pour moi ne sont pas philosophes. Je pense à Montherlant, l’auteur qui a le plus compté pour moi (ses Carnets 1930-1944 sont peut-être son chef-d’œuvre, mais tous ses romans et toutes ses pièces de théâtres sont prodigieuses, inaugurales, définitives). Et Drieu La Rochelle, si honnête (à en crever), si dur avec lui-même, si méchant avec les Juifs – alors qu’il a connu tant de femmes juives, et qu’il ne faut jamais dire du mal des femmes qui nous ont fait jouir, sauf si elles ne nous ont pas fait jouir, et encore : peut-être nous ont-elles réjoui, à leur façon. Jouir ou réjouir : il faut parfois choisir.
Pour revenir à Martin Heidegger, il ne se pose que les questions qu’il faut se poser. Rien d’accessoire, rien de superflu dans les thèmes qu’il aborde. La marche à l’étoile. Tout l’essentiel et rien que l’essentiel. C’est là l’immense différence avec les penseurs de la déconstruction nihiliste. Pour Heidegger, ce qui est difficile c’est de trouver ce qui est simple. Et c’est cela qui est nécessaire.
Propos recueillis par Christopher Gérard, septembre 2024.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







