02 août 2022
Agir ou subir ?
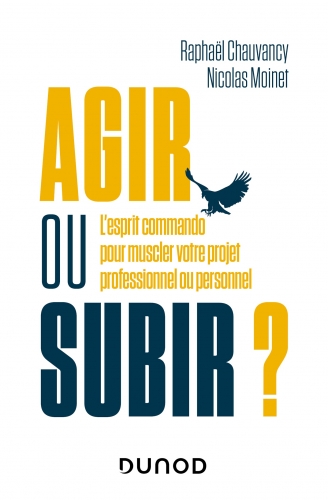
A priori, je ne puis accorder, je le concède sans fausse honte, un seul atome d’attention à toute cette littérature managériale et/ou de bien-être du style « produire dans la bonne humeur bio » ou « danser avec les arbres ». Les PuissancePoints me font somnoler ; les conseils de requins auto-satisfaits me donnent la nausée. Quant aux niaiseries New Age…
Pourtant, quand j’ai vu que Raphaël Chauvancy (°1978), dont j’avais lu le bel essai sur Jacques Laurent, sans doute le plus doué des Hussards, copubliait, avec un spécialiste en intelligence économique, Agir ou subir ?, je l’ai commandé sans hésiter, curieux de voir ce que cet officier supérieur des Troupes de marine (garder la minuscule, merci), détaché au sein des Royal Marines de Sa Gracieuse Majesté, avait à dire sur le rôle de l’esprit commando dans les projets personnels ou professionnels.
Je ne suis pas déçu par la haute tenue de l’essai, qui s’abreuve aux meilleures sources : Sun Tzu, le Maréchal de Lattre (« Ne pas subir ! ») ou encore René Quinton, l’auteur trop méconnu de puissantes Maximes sur la guerre. Raphaël Chauvancy utilise sa formation acquise dans les forces spéciales pour définir, dans un style aussi mâle que limpide, comment penser pour vaincre. Et vaincre signifie refuser de subir : il aurait d’ailleurs pu citer Dominique Venner : « Exister, c’est combattre ce qui me nie ».
Or, la vie sociale, culturelle, politique ou économique est toujours un terrain d’opération, avec ses vainqueurs et ses vaincus. Pour citer mon cher Héraclite : le conflit est le père de toute chose.
L’objectif de notre centurion est bien « d’extraire de l’ethos militaire l’état d’esprit et les approches transposables dans le monde civil », d’adapter à notre temps les valeurs cardinales de la deuxième fonction indo-européenne, celle des Kshatriya de l’Inde ancienne ou de notre noblesse d’épée : courage (« la première des qualités humaines » selon Aristote, l’éducateur d’Alexandre) et excellence, unité et adaptabilité, humour et humilité, joie et abnégation, et enfin détermination. Ces neufs valeurs doivent cohabiter à un niveau similaire chez le même homme (la même femme) pour constituer une chaîne incassable.
La devise des commandos, Who Dares Wins, « Qui ose gagne » est centrale dans cette préparation mentale aboutissant, écrit Chauvancy, à « la joie d’être l’artisan de sa propre vie, l’architecte, le bâtisseur et l’occupant de son temple intérieur ». À rebours du siècle, triste et geignard, notre officier exalte ce courage, unanimement loué mais rarement apprécié dans la vraie vie, sans doute le plus difficile, celui de « s’opposer aux idées reçues, de refuser les mimétismes et de combattre les dogmes ».

Deux chapitres m’ont particulièrement marqué, celui sur l’humilité et celui sur l’humour. La première qualité, dont je ne pense pas être excessivement pourvu, permet d’observer sans œillères un adversaire ou une situation de crise. Les grandes raclées ne sont-elles pas surtout dues, non pas à un manque de renseignements, mais plutôt au refus de voir ce qui est… et ce qui dérange le plan ou l’image tronquée, rassurante, que l’on se fait de la réalité ? Chauvancy rapproche fort à propos cette vertu d’humilité de la sôphrosynè hellénique, cette tempérance et cette modération propres aux meilleurs. Très justes aussi, ses propos sur la nécessité de l’humour, si possible mordant : créateur de confiance et de cohésion chez les camarades et déstabilisateur pour l’ennemi, qu’il enferme et paralyse dans une bulle cognitive – le piège du faux sérieux.
En valorisant comme il le fait la dureté et le refus des fausses fatalités, l’élan vital et la joie de l’effort, la discipline et le panache, Chauvancy fait avec une magnifique vigueur l’éloge de l’esprit corsaire, qui résiste aux normes comme aux rassurantes impostures.
Christopher Gérard
Raphaël Chauvancy & Nicolas Moinet, Agir ou subir ? L’esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel, Dunod, 156 pages. Voir aussi, Jacques Laurent, dans la collection Qui suis-je ? des éditions Pardès.
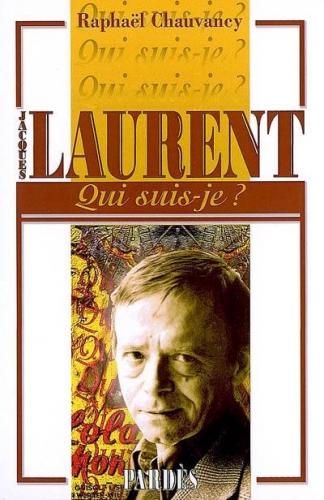
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21 juillet 2022
Fry's Ties
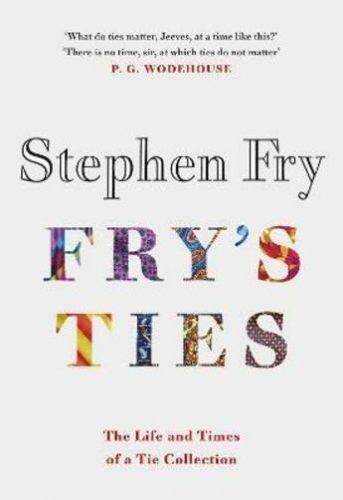
L’un de mes plus vifs plaisirs, lors de chacun de mes passages à Londres, est de m’attarder chez Hatchard's, 187 Picadilly, libraires depuis 1797 et fournisseurs de la Cour (by Appointment to Her Majesty the Queen, to H.R.H. the Duke of Edinburgh and to H.R.H. the Prince of Wales).

Nous sommes à deux pas des merveilles de Jermyn street, de Wilton’s, le plus ancien restaurant de Londres (since 1742) et de Burlington Arcade - une sorte de triangle d’or, ou disons de Saint des Saints, pour les anglomanes.
Quatre étages de livres où se perdre dans une parfaite quiétude, un personnel attentif, des tapis moelleux, et cette excellente idée de proposer aux visiteurs des signed copies de nouveautés choisies - j’ai ainsi pu m’offrir deux romans de John le Carré signés, et Fry’s Ties, de Stephen Fry (1957), célébrissime acteur britannique (hilarant aux côtés de Hugh Laurie ou de Rowan Atkinson), écrivain et homme de radio. Ce volume a attiré mon attention grâce à la citation de P.G. Wodehouse sur sa couverture : « What do ties matter, Jeeves, at a time like this ? There is no time, sir, at which ties do not matter. » Pour un amateur de cravates tel que votre serviteur, la citation a comme un goût de signe de ralliement, à rebours du débraillé de rigueur.

La cravate a en effet mauvaise presse, vue comme un instrument de torture, ce qu’elle n’est pas (une cravate ne « serre » jamais le cou de celui qui la porte, c’est la chemise qui, dans ce cas, n’est pas ou plus à la bonne mesure. Il suffit de passer à la taille supérieure de la chemise … ou, plus héroïquement, de faire un régime), ou encore comme le symbole d’une masculinité, évidemment toxique, et donc honnie par puritaines & pisse-vinaigres.
Il est vrai que la cravate symbolise à la fois un code, une autorité, en un mot une verticalité à laquelle notre époque furieusement égalitaire semble de plus en plus allergique. Le meurtre du Père, la haine de toute autorité, l’obligation implicite de ne jamais sortir du rang sont devenus des dogmes qui ne se discutent plus sous peine de vertueuse exclusion. Exit la cravate, condamnée comme les guêtres ou la chaise à porteurs ? Voire.
L’amusant livre de Stephen Fry constitue une magnifique et souvent spirituelle défense à la fois du goût et de la forme comme manières de résister à l’indifférenciation moralisatrice.
Tout jeune, Fry se montrait déjà réfractaire à l’esprit de son temps, à l’époque pré-punk des 70 : à quinze ans, ne possédait-il pas déjà quarante cravates ? Qui dit mieux ? Ne se vantait-il pas de ne porter que des vêtements de l’époque de son grand-père ? Ne poussait-il pas la provocation à ne fumer que des Balkan Sobranie, à ne lire que des auteurs du passé : Waugh, Kipling et Wilde ? Sacré Fry !

Son livre, celui d’un dandy qui ne se prend aucunement au sérieux, est illustré de clichés et présente des cravates de sa collection personnelle, chacune devenant le prétexte à des évocations souvent drôles, à des réflexions parfois mélancoliques sur le temps qui passe, sur le style et l’art de vivre. En filigrane, belle et lucide critique de ce qu’il appelle justement The Great Disruption - « What was respectable yesterday is repressive and despicable today ».
Nous le suivons de Jermyn street, la rue des chemisiers londoniens, à Madison Avenue, de Milan à Melbourne. Jeu avec la mémoire, exercice pratique d’élégance, Fry’s Ties se lit d’une traite, crayon à la main. Page après page, l’auteur partage avec nous sa passion pour les belles soies tissées ou imprimées, pour le toucher d’une cravate ; chaque cravate lui évoque un épisode de sa vie, de son admission au Garrick Club, le cercle des hommes de théâtre, à deux pas de Covent Garden (cravate salmon and cucumber) à celle du Marylebone Cricket Club (cravate eggs and bacon), le très sélectif club des amateurs de ce sport incompréhensible. Fry nous explique le principe des stripes, ces rayures de couleur qui constituent le signe codé d’une appartenance à un régiment, un club ou un collège (Eton : fond bleu de Prusse et fines rayures bleues), voire une entreprise. Les British reps ties ont ceci de particulier que les rayures, les stripes, descendent de l’épaule gauche, du cœur, à la main droite - l’inverse trahissant, horresco referens, une cravate américaine.
Fry semble chez lui dans les plus grandes maisons, de Turnbull & Asser, qui fournit en son temps Kim Philby et James Bond. Au sous-sol de ce magasin, on peut encore voir, parmi de sublimes pyjamas, le siren suit taillé sur mesure pour Churchill pendant le Blitz (d’où l’allusion aux sirènes d’alarme) : une sorte de salopette en velours, pratique pour travailler au War Cabinet tout en fumant le cigare. Il évoque aussi, parmi bien d’autres, New & Lingwood, fournisseurs officiels d’Eton College depuis 1865, une autre adresse dont je pousse la porte à chacune de mes visites dans la Burlington Arcade, juste en face de la statue en bronze de Brummel : j’y ai acquis, moi qui ne fume que quatre cigares par an, un smoking hat en velours, une sorte de fez ou de tarbouche, orientalissime et d’un chic absolu, pour lire et relire John le Carré.

L’éloge que fait Stephen Fry de Brooks Brothers (established 1818) m’a transporté d’enthousiasme : ah, ces nœuds papillons ! Comment ne pas se désoler davantage de la fermeture du somptueux magasin londonien de Regent street, remplacé par un entrepôt à fripes pour adolescents attardés ?
D’autres évocations m’ont en revanche laissé de marbre : telle ou telle cravate psychédélique, ornée de pandas ou de grenouilles… Mais une touche de mauvais goût, calculée avec minutie autant qu’assumée avec assurance, ne relève-t-elle pas, parfois, d’une forme d’élégance, en tout cas d’une sorte de courage suprêmement British ?
Bref, une promenade pleine d’humour et de charme qui plaira aux esthètes et à tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans certaine grisaille obligatoire.
Christopher Gérard
Stephen Fry, Fry’s Ties. The Life and Times of a Tie Collection, Michael Joseph, 256 pages, 14.99£

Lire aussi :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2020/12/28/le-chouan-des-villes-6287020.html
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18 juillet 2022
L’ultime roman de John le Carré

Nombreux sont ceux, je l’ai dit naguère, qui ne comprennent pas que John le Carré (1931-2020) n’ait jamais eu le Nobel de littérature, tant son oeuvre, traduite dans maintes langues, a changé du tout au tout le roman d’espionnage et radiographié cette Angleterre impériale « en chute libre », celle de M. Johnson e.a., qui l’exaspérait au point de lui faire prendre, juste avant de mourir, la nationalité irlandaise.
L’ancien professeur à Eton devenu cold warrior à Berne, Hambourg et Berlin, l’agent des prestigieux MI 5 (sécurité intérieure) et MI 6 (documentation extérieure) s’est révélé comme l’un des auteurs majeurs de la littérature contemporaine.
C’est donc avec une réelle tristesse que j’ai lu, sans même attendre la traduction française, prévue en octobre au Seuil, Silverview, son ultime roman, paru moins d’un an après sa mort. Le titre lui-même traduit bien le caractère énigmatique du récit, tout en allusions et en demi-teintes, qui, sans être un chef-d’œuvre stricto sensu, nous laisse ce que, dans sa postface, le fils de l’écrivain, Nick Cornwell (lui aussi auteur), appelle justement « a song of experience ». Dès les premières pages, le lecteur est pris dans les filets de son « agent traitant », qui le manipule avec maestria.

Comme toujours chez le Carré, les grandes figures sont réussies : Proctor, officiellement diplomate du Foreign Office et en réalité officier supérieur du Secret Intelligence Service, naguère chef de station à Buenos Aires du temps de la Guerre des Falklands, aujourd’hui chargé de tirer au clair une trouble affaire de fuites dans un réseau hyper-sécurisé où communique la crème des services anglo-américains. Proctor provient d’une famille de la gentry, mais attention libérale - pas tory pour un shilling - qui a compté quelques figures d’espions dans le Lisbonne de la guerre, chez les décodeurs de Bletchley Park et même dans l’Albanie des années 50.
Aux antipodes de l’espion désabusé qui fait bien entendu songer à Smiley, Julian - « a great Roman emperor » -, jeune trader de la City reconverti pour des raisons inconnues en libraire dans une station balnéaire de l’East Anglia avec ses plages 1900. Le roman commence d’ailleurs dans cette librairie déserte, où débarque, revêtu d’un imper râpé et coiffé d’un Homburg démodé, un ami de son défunt père, Edward, parfois prononcé Edvard, émigré polonais, ex-professeur de théologie marxiste à La Havane, Zagreb et Gdansk, fils d’un fasciste polonais fusillé à la Libération, ci-devant agent des services britanniques. En quelques pages, toute l’atmosphère du récit est campée avec ce ton et ce génie du dialogue propres à le Carré. Nous apprenons au fil du récit qu’Edvard a été connu par le Service sous le pseudo de Florian, agent aussi providentiel - excellent rendement - que portant malheur à ceux qui l’approchent de trop près, comme cette famille jordanienne, active dans une ONG saoudienne en Bosnie et qui sera victime d’une bavure. Edvard-Florian se trouvait en effet en mission dans le coin, recrutant à tour de bras sous identité allemande dans les Balkans en feu. Ses bons contacts avec un colonel serbe (les inévitables méchants du récit) lui permettent de sauver la belle Salma, mais ni son mari ni son fils. Dévasté par cette tuerie dont il est peut-être responsable, Florian se réfugie en Angleterre, à Silverview, le manoir de sa future femme, Deborah, qui se trouve être analyste en chef du Service pour le Moyen Orient. Le Carré signale incidemment que Silverview est la traduction anglaise de Silberblick, le nom de la maison occupée à Weimar par Nietzsche et sa sœur pendant les dernières années de la vie du philosophe. N’en révélons pas davantage.
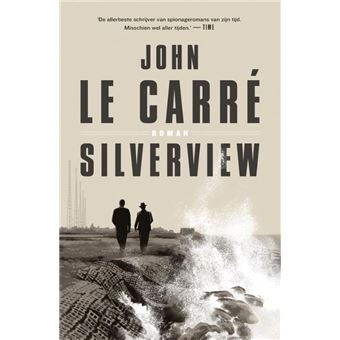
Nous retrouvons dans ce roman testament de le Carré nombre de ses obsessions : la figure d’un père indigne (ici, ils sont deux), l’analyse du traître en tant qu’archétype humain, l’exaspération face à la vassalisation d’une Grande-Bretagne rêvant à sa grandeur disparue, la virulente critique de la politique américaine (« America’s determination to manage the Middle East at all costs, its habits of launching a new war every time it needs to deal with the effects of the last one » et, à méditer en ces temps de propagandes éhontées, « NATO as a leftover Cold War relic doing more harm than good »). Enfin, cette vision grinçante de services secrets finalement peu efficaces, taraudés par le doute comme par l’arrivisme.
Quel talent, tudieu ! Comment ne pas rêver au roman que lui aurait inspiré cette atroce guerre d’Ukraine ?
Christopher Gérard
John le Carré, Silverview, Penguin Books, 256 pages, 8,99£
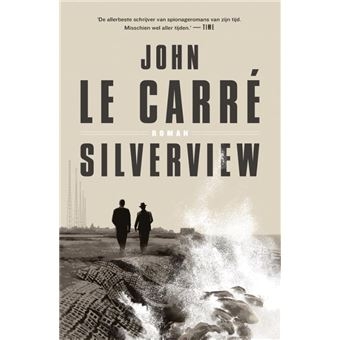
Lire aussi mon hommage du 14 décembre 2020 :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2020/12/14/exit-john-le-carre-6284184.html
Il est question de John le Carré dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28 juin 2022
In memoriam Vladimir Dimitrijevic

Il y a onze ans disparaissait Vladimir Dimitrijevic, mon éditeur, mon ami - un seigneur que je saluais en ces termes dans Quolibets : « Jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à cette fin qui lui ressemble - nette, sur la route, au milieu des livres : une mort de combattant - Dimitri aura incarné l'insoumission aux diktats des partis comme aux pressions des coteries. Fugitif du paradis collectiviste, rebelle à toutes les propagandes, y compris les plus doucereuses, il aura sa vie durant bataillé pour céder la parole à ceux qui étaient bâillonnés, des dissidents aux mystiques. Dimitri ou le grain de sable. Dimitri ou le rebelle à toutes les mises au pas. Et quelle liberté d'esprit! Jamais je n'ai entendu dans sa bouche un mot convenu, le moindre jugement qui ne fût pas le fruit d'une réflexion originale, d'une réelle profondeur et dénuée de toute pose. Fulgurante intelligence que la sienne, qui lui permettait en quelques mots de louer un auteur, de déchiqueter un imposteur ! Quelle intuition face aux livres comme aux hommes! Quel instinct ! Dimitri est sans doute l'homme le moins dupe que j'ai jamais rencontré, et l'un des plus intelligents, devant lequel chacun ne pouvait se sentir que dépassé. »

Voici ce que disait de lui son ami et confrère Pierre-Guillaume de Roux : « Mais celui <l’éditeur> sans doute qui m’a le plus marqué et avec qui j’ai eu de nombreux échanges, c’est le regretté Vladimir Dimitrijevic, fondateur et directeur des Editions L’Age d’Homme. Après la mort de mon père, dont il était l’ami, il a été pour moi la grande référence. J’ai été « nourri au lait de L’Age d’Homme » et de la littérature slave. Les conversations que j’ai eues avec lui m’ont beaucoup inspiré et ont été déterminantes. Il incarnait dans ce monde de plus en plus livré à l’argent et à la rentabilité une certaine idée aristocratique de l’édition, au service de la littérature davantage qu’à la recherche d’un succès facile. Ce que j’ai profondément admiré chez lui c’est cette manière de construire un catalogue extraordinairement vivant et incarné, à l’image de ses passions et de sa personnalité. Il ne publiait rien au hasard. »

En ce jour anniversaire de sa mort,
ayons une pensée et /ou une prière pour Dimitri !

Avec Dimitri, au Salon du Livre de Paris (2010)
*
**
Entretien avec Dimitri, directeur de L'Age d'Homme
Entretien avec une légende vivante
du monde de l'édition
Christopher Gérard: Depuis très longtemps, vous éprouvez pour la Belgique une profonde tendresse, à la fois personnelle et littéraire. Pouvez-vous nous en parler?
Vladimir Dimitrijevic: En 1954, au moment où j'ai quitté clandestinement la Yougoslavie communiste pour l'Occident, je ne savais quasiment pas où se trouvait ma ville de naissance, étant donné que le passeport - belge - que j'utilisais n'était pas tout à fait le mien: j'étais né à Anvers, j'y habitais Moretuslaan, j'avais 39 ans et les cheveux blonds. En réalité je n'avais que 19 ans … Quant aux cheveux, il faut croire que les blonds mûrissent plus lentement que le noiraud que je suis! J'avais eu le culot de prendre un billet d'avion pour Zürich à l'aéroport de Zagreb, en me disant qu'aucun policier n'imaginerait une fuite pareille, et cela a marché. Donc je suis belge, mon nom est Jacques Booth. Depuis trente ans, depuis la première foire du livre de Bruxelles - où je viens tous les ans -, dès que j'ai une interview comme celle-ci, je dis: "Jacques Booth, écrivez-moi! Je voudrais savoir qui vous êtes, vous remercier et m'excuser pour les ennuis que vous avez pu avoir avec la police yougoslave étant donné que votre passeport avait disparu de l'hôtel où vous séjourniez." Appel fraternel est donc lancé à Jacques Booth. La première fois que je suis allé à Anvers, j'ai immédiatement cherché la Moretuslaan, numéro 22, pour voir la maison. Chose extraordinaire: c'était un terrain vague! Je suis donc arrivé ici avec un faux passeport belge, habitant un terrain vague! Cela m'a fait un effet belge. Et voici pourquoi: dans la littérature belge, dans le fantastique belge, les changements de maisons, de rues sont fréquents. On les trouve chez Jean Ray, chez Thomas Owen par exemple. On pourrait ainsi écrire l'histoire de quelqu'un qui cherche celui qui l'a aidé et qui se rend compte que tout est à refaire, que tout est à revivre.
Muni de ce "faux passeport" - une tradition bien belge - et domicilié avenue Moretus - un lointain confrère des XVII Provinces -, vous pouviez impunément vous intéresser à notre littérature…
Exactement. J'ai commencé à lire Ghelderode, quelques surréalistes belges et cela m'a plu. Les surréalistes belges sont les seuls vrais, car les surréalistes français, trop cérébraux, arrivent à détruire l'image, le texte ou même le récit. Je les trouve surfaits. C'est une tendance qui aboutit dans la publicité moderne. La télévision est un avatar de ce surréalisme. Dans une certaine mesure, il y a une correspondance entre les littératures slave et belge: elles partent du réel, sont enracinées et surtout, les écrivains sont très différents les uns des autres. Il existe de grandes tendances, bien sûr, mais ils restent des individualités, comme Muno, que j'aimais beaucoup, comme beaucoup d'autres. Parmi eux, je citerai Jacques Henrard, un auteur très particulier, qui lui aussi fait son chemin, je dirais: son souterrain littéraire. Cela me plaît. J'ajouterai ceci: on ne refait pas sa vie, mais si je devais être un éditeur enraciné quelque part, je préférerais être un éditeur belge que français. En Belgique, je me serais senti chez moi, à l'aise, car un éditeur, s'il peut toujours créer des collections, doit avant tout avoir un terreau. Je suis un éditeur établi en Suisse depuis 1966, mais ici, je crois que j'aurais mieux réussi grâce au terreau justement, à tous ces gens curieux, qui me plaisent, qui suivent leur propre chemin. J'espère qu'ils continueront, car on sent aujourd'hui une tendance à l'uniformité. Par mon travail, j'espère donner un peu d'espoir et d'ambition aux écrivains, et leur permettre de durer.
Plus de cinquante auteurs belges existent et durent grâce à vous, comme le montre le beau catalogue 2002: La Belgique à l'Age d'Homme. L'Age d'Homme est bien "nach dom", notre maison. Mais, puisque nous parlons de littérature belge, quels en sont pour vous les points forts ?
L'indépendance! Comme mon pays natal, la Belgique est un pays-frontière: vous avez les Flandres et la latinité. Surtout, la peinture joue un très grand rôle dans la formation du goût et de la sensibilité en Belgique. Et cette peinture, je ne vais pas dresser de catalogue mais je pense tout de suite à Ensor, eh bien, elle est bonne! Cette peinture est aussi une pensée…
Vous nous avez compris! La peinture comme pensée!
Oui, elle n'est pas qu'un décor, mais bien une pensée. Prenez Hugo Claus, qui est à la fois peintre, dramaturge et romancier: il a cette fougue, ce trait du peintre dans sa poésie, dans sa littérature. C'est très particulier à l'espace belge et il faut que ceux qui cultivent cet héritage pictural comptent ici. Quant à la langue, ce n'est "la langue française", tout comme en Suisse. Des Suisses comme Haldas ou Ramuz sont de grands écrivains français, mais leur génie ne réside pas dans la suavité de l'expression ni dans la rhétorique. Leur langue est une langue arrachée, proche du pays et de ses gens, de leur accent, cela se sent. Pour moi, c'est essentiel: sans ce terreau, la littérature n'existe pas vraiment. En fait, il y a parmi les écrivains, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors peuvent produire des textes fantastiques, extraordinaires, étincelants, tout ce que vous voudrez, mais ils ne touchent pas. Ils ne sont pas dedans! L'essentiel est de tirer tout le suc d'un pays, sa musique et cela demande un grand travail. Voyez Ramuz, qui a publié jadis Deux Lettres, l'une adressée à son mécène suisse, l'éditeur suisse Mermod, l'autre à Bernard Grasset, sans doute le plus grand éditeur de sa génération. Grasset était attentif à cela: il avait senti que le sort de la littérature française se jouait dans la profondeur, dans…
… dans les marges ?
… dans les marges, oui. Enracinée comme chez Poulaille, ou l'œuvre colossale d'un Ramuz, d'un Giono, des écrivains qui ont fait coïncider la langue et la réalité. Chez Ramuz, vous entendez hésiter les personnages; des silences s'installent. Même chose chez Céline, très proche du monde des artisans du Passage Choiseul dont il a le parler dans l'oreille et qu'il transfigure en grande littérature. Tout ce courant était une réaction à une littérature assez conventionnelle, qui avait ses stylistes, mais qui me touche peu. La Belgique, avec un Ghelderode, c'est ma littérature!
Parlez-nous des grands écrivains belges que vous avez lus.
Depuis toujours, j'ai une passion pour Simenon comme pour Tchékhov et Toilstoï. Ce sont des médiums. Le style de Simenon est très personnel: quand vous essayez de le traduire dans une autre langue, vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. J'ai pu le vérifier en lisant des essais en serbe ou en russe, si vous traduisez Simenon mot à mot, ce n'est plus du Simenon. Vous n'avez qu'une histoire, mais vous perdez les silences. Le silence d'un Simenon est particulier, mystérieux même. Le théâtre de Ghelderode m'a beaucoup marqué et j'espère qu'il existe encore des metteurs en scène capables de représenter ce Moyen Age qui entre sans frapper, ce Moyen Age exubérant, que l'on trouve dans la peinture de l'époque. Alors, comment cette exubérance a-t-elle été perdue dans la civilisation européenne, c'est un autre sujet…
Vaste problème…
Oui, vaste problème!
Et parmi les écrivains belges que vous avez rencontrés…
J'aime beaucoup Jacques Henrard, un homme qui semble sortir des nouvelles de Tchékhov, simple et effacé. Il y a chez lui une compassion qui vous serre le cœur, sans volonté directe d'émouvoir. Pour moi, c'est un auteur très important. Je ne parlerai pas d'autres contemporains, ou alors une autre fois.
Et comme éditeur en général, de quoi êtes-vous le plus fier?
Du catalogue! Vous voyez, quand on me demande de parler de métier, je réponds que je ne sais pas. Quand suis-je devenu éditeur? A treize ans? Au moment où, en classe, dans le dénuement qui était le nôtre au sortir de la guerre, nous étions graves? Graves et pleins d'énergie, parce que, malgré la guerre et les familles décimées, régnait une sorte d'exubérance… Et puis il y avait la censure qui s'est abattue sur ma famille tout d'abord, ensuite sur mes goûts intérieurs. Comment se fait-il que je me suis toujours trouvé à côté des choses admises, sans le vouloir? Voilà une question qui me préoccupe: pourquoi ai-je toujours été à côté de ce qu'"on" attendait de moi? Je ne sais pas. Je ne suis absolument pas marginal, comme certains de mes confrères qui se situent explicitement "dans la marginalité". Je ne suis pas contre, mais ailleurs. Là où je peux réparer les torts, laisser les gens parler quand ils sont brimés. Je me suis intéressé au futurisme italien, à la littérature anglo-saxonne, à Wyndham Lewis, l'un des plus grands écrivains anglais, un homme complet, peintre et inventeur de formes, constamment mis dans les marges. Il n'est pas "marginal", il est mis dans les marges: les journaux ne parlent pas de lui. Même chose pour l'étonnant Caraco, dont j'ai publié plus de vingt livres. Je pense aussi à un autre homme complet, l'un de mes préférés, S. Witkiewicz. Tous ces gens sont autodidactes comme moi. Les formations restreignent la curiosité. Or, pour moi, la connaissance est une sorte de métastase permanente. Tout m'intéresse, même les insectes exotiques…
Ce serait donc le secret de votre métier: une curiosité tous azimuts ?
Oui, une curiosité tous azimuts, mais pas dispersée. Passionnée. Je ne mélange pas les genres. A un moment donné, se construit dans ma tête la mosaïque du catalogue. Vous voyez, quand je suis invité chez quelqu'un, la première chose que je fais, c'est impératif pour moi, c'est de regarder sa bibliothèque. On a beau me tendre un apéritif, tenter de m'asseoir de force, je regarde les livres. Et je regarde ce qui manque. C'est instinctif. Ainsi, ici à la Foire, je regarde partout et je me dis: "hou, là, il manque…" Ou bien: "ah, il a rempli la case". Cette mosaïque est pour moi essentielle: j'interroge ceux que je rencontre, mes amis, mes auteurs pour savoir où va le théâtre, où va le cinéma, etc. Ce que j'aime, c'est de recevoir un coup, a blow, disent les Anglais. La gifle en pleine figure. Qu'on me dise: mais, mon Dieu, regarde! Rozanov, Caraco, Witkiewiecz me donnent ce genre de choc. De ces chocs naît la mosaïque. Le catalogue. En fait, je suis très attaché à la transmission de la vie.
Je suis un grand pessimiste, mais qui croit à la transmission de la vie.
Bruxelles, le 14 février 2004
Cet entretien a d’abord paru dans la Revue générale de mars 2004 (Bruxelles).

Pierre-Guillaume de Roux, l'héritier.
16 juin 2022
Hypertextuel ?
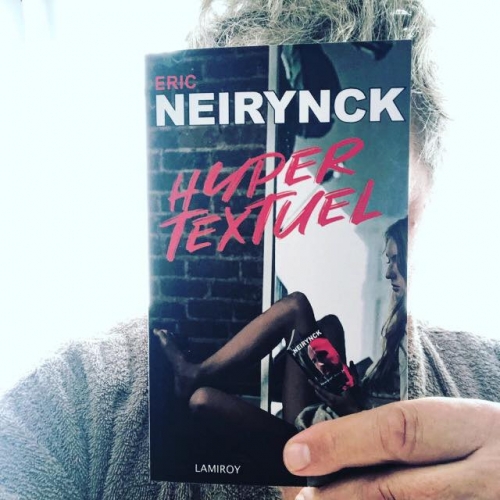
Hypertextuel ?
Naguère, j’ai signalé Camping, l’opuscule d’un auteur bruxellois, Eric Neirynck, un fan de Céline et de Bukowski, au regard aussi déjanté que désespéré. Je le suis donc, ce gus tatoué de la tête aux pieds qui s’épanche (un’ po troppo) sur la toile pour clamer sa révolte et son universel malaise. Il m’envoie Hypertextuel, un recueil de nouvelles au parti-pris poisseux, pour ne pas dire porno-plebs. Aux antipodes de mes goûts Stendhal –Morand…
En scène, la figure récurrente d’un quinquagénaire paumé, condamné aux besognes sordides, à une forme de misère affective, inadapté complet et rêvant à de sublimes nymphomanes… Quelques nouvelles traduisent bien la tristesse et l’angoisse, voire une sensibilité de type réaliste-magique, non sans des pointes de cruelle drôlerie.
Toutefois, la force d’une nouvelle résidant dans sa chute, le genre exige du travail, et c’est là que le bât blesse tant Eric Neirynck manque parfois de patience comme de constance : il semble plus jouer avec l’idée d’être écrivain que travailler à son œuvre. Le potentiel est bien réel ; manque une dose d’opiniâtreté. D’où un goût d’inachevé : certaines nouvelles tournent court.
Je ne puis donc que répéter mon conseil de 2018 : au travail, Neirynck !
Christopher Gérard
Eric Neirynck, Hypertextuel, nouvelles, Lamiroy, 124 pages, 14€

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : lamiroy, littérature belge | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







