14 janvier 2026
Sur la Source pérenne II
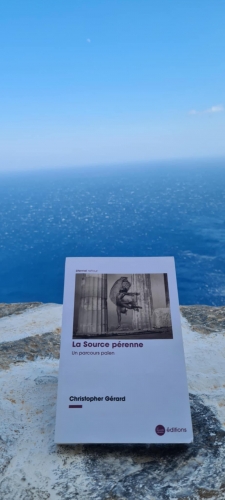
Quelles sont les modifications de cette troisième édition ?
Deux éditions du livre avaient paru, en 2000 puis en 2007, aux éditions L’Âge d’Homme, la si peu conformiste maison du
regretté Vladimir Dimitrijevic, qui accueillit, outre nombre de
Slaves, tant de Belges, de Pol Vandromme à Jean-Baptiste Baronian, de Georges Thinès à Hubert Lampo.
D’où cette troisième édition revue et augmentée (vingt-trois textes), sous la sobre casaque de La Nouvelle Librairie. Comme le dit à juste titre un critique belge, ce livre « s’inscrit dans la durée » : un quart de siècle. Dans dix ans peut-être, je publierai une quatrième édition…
À l’origine du titre, une expérience, une image aussi – la source vive qui coule, en plein cœur de Rome, sous la basilique San Clemente al Laterano, à côté du mithræum souterrain. Tout un symbole : une basilique paléo-chrétienne appartenant à des Dominicains irlandais, où subsiste, enfoui, le temple païen.
Vous évoquez dans le premier texte le paganisme comme religion de l’Europe et indiquez que son principal facteur de disparition fut évidemment l’évangélisation. Mais plus encore que la religion chrétienne, n’est-ce pas le découpage du temps calendaire qui a supplanté le temps organique, cyclique, du paganisme ? Et si cette dimension de l’existence est fondamentale au païen, comment peut-il encore l’éprouver essentiellement, voire se soustraire aux diktats de nos sociétés soumises aux horloges, aux agendas, aux contraintes horaires professionnelles comme privées ?
Avec l’évangélisation (souvent forcée : n’oublions pas que les
cultes païens furent interdits dès la fin du IVème siècle) et surtout la Contre-Réforme (car notre Moyen Âge était resté
foncièrement païen) s’impose en effet une autre vision du temps, linéaire et non cyclique, calendaire et non organique – officiel, en quelque sorte.
Augustin d’Hippone, platonicien puis manichéen dans sa jeunesse, développera, une fois converti au christianisme vers l’âge de trente-trois ( !) ans, sa vision d’un temps détaché des phénomènes naturels et observables, à savoir le mouvement des astres. Ce triomphe d’une abstraction sur le réel annonce, des siècles à l’avance, notre temps séquencé, celui des horloges numériques que vous évoquez. La posture païenne consiste à se réapproprier la vision cyclique, donc naturelle, du temps, celui qui fugit. Se soustraire, comme vous le dites justement, aux diktats utilitaristes et marchands, renouer avec les cycles et les fêtes, avec la ronde des saisons est un premier pas. D’où, je pense, une part du malaise contemporain, dû à cette rupture d’avec les rythmes cosmiques (agraires pour nos régions). Un exemple tout récent : la modification décidée d'en-haut, sans réelle concertation, dogmatique, des rythmes scolaires, une hérésie sur le plan pédagogique, qui fait la fortune des agences de voyage.
La claire conscience de la progression des cycles participe bien à la bonne santé du corps, de l’âme et de l’esprit. Pour ma part, j’ai la chance de vivre en bordure d’un vaste parc, où batifolent renards et rouge-gorge, hérons et écureuils roux. De ma fenêtre, je peux suivre, jour après jour, les métamorphoses de la nature – cet « éternel retour » en version microscopique est un spectacle apaisant autant qu’une source, pérenne, de bonheur et d’équilibre.

Vous rejetez toute manifestation de paganisme « clanique », collective comme autant de mascarades. Est-ce à dire que, à une époque où la communion a cédé le pas à la communication, le paganisme est la forme la plus aboutie, non de l’individualisme, mais du personnalisme ?
Je n’ai pas stricto sensu rejeté des manifestations de paganisme en raison de leur caractère clanique, dont certaines sont émouvantes et crédibles – je pense à divers groupes helléniques, baltes ou italiens. Ce n’est tout simplement pas ma tasse de thé et j’ai peu de goût pour ce qui pourrait dériver en mascarade.
Etre une personne différenciée (et non un individu récriminant avec aigreur pour ses droits), si possible debout et structurée autour d’une colonne vertébrale, au temps de l’individualisme grégaire, me paraît le défi à relever pour tout homme libre. Les engouements de masse et les comportements de meute m’inspirent de la méfiance. J’ai les curées, surtout si elles se prétendent vertueuses, en horreur. Les tribus m’ennuient… même si les liens communautaires des clans et de la famille au sens large apparaissent comme des protections pour la personne face au Léviathan moderne et contre les aléas du rapide destin. L’étude du courant personnaliste me paraît, comme vous le suggérez, une piste intéressante.
Vous dont le paganisme semble fondé sur un parcours individuel, allant de découvertes en révélation, de rencontres en partages, quelle est votre point de vue sur l’initiation ? La plus parfaite n’est-elle pas celle où, comme vous, l’on se choisit ses maîtres ? Vous considérez-vous comme un auto-initié ?
Les Mystères d’Eleusis ou de Mithra ont disparu et leurs secrets, diabolisés par l’Eglise, ont été perdus : ne subsistent que quelques formules, quelques bas-reliefs que les savants tentent d’interpréter. Comme vous l’observez, l’initiation pour moi est personnelle, fruit d’un cheminement relativement (pas totalement) solitaire, celui d’un contemplatif. Par nature, je ne suis pas à l’aise dans les groupes où l’on vous apprend à penser droit et où les ambitions puériles, les conflits de personnes accaparent l’attention et vous distraient de l’essentiel. Je n’ai donc pas accepté les propositions d’appartenir à l’une ou l’autre société à prétentions initiatiques, dont les « incarnations », parfois sympathiques, ne me convainquaient pas outre-mesure. J’y vois une sorte de théâtre, un réseau social ou professionnel, bien plus que l’occasion d’atteindre un niveau supérieur de conscience.
J’ai bien rencontré, en Inde, deux ou trois figures impressionnantes, mais qui s’inscrivaient dans une filiation
plurimillénaire dans le cadre de leur caste. J’ai pu en effet m’entretenir assez longuement avec les équivalents locaux de nos druides de jadis, qui m’ont, de manière quasi paternelle,
encouragé dans ma quête sans jamais vouloir me convertir. De certaines soirées passées sur le toit d’un temple à Bénarès, je garde un souvenir lumineux.
Votre géographie mentale est, comme vous venez de le dire, tournée vers l’Inde et plus encore la Grèce antique - Apollon. Vous parlez moins des hérésies, et je pense en particulier à la gnose. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette forme de pensée tout à fait originale ?
Mon livre débute en effet pas une invocation à Apollon Archer. Ma formation de philologue classique m’a, d’une certaine manière, rendu allergique à l’occultisme comme à toute forme de confusion. En effet, j’ai été dressé à accéder aux textes originaux dans leur langue originelle, à en effectuer une lecture la plus rigoureuse possible pour les comprendre avant de les interpréter. Il y a là un devoir fondamental de probité et de clarté qui m’a été inculqué dès mon adolescence : reditus ad fontes.
Les gnostiques, avec leur dualisme foncier, posture qui m’est
étrangère, n’ont jamais suscité chez moi qu’un intérêt strictement documentaire. Idem pour les hérésies chrétiennes, le catharisme par exemple, qui me fait horreur. Les figures d’Apollon et de Dionysos, la tradition gréco-latine dans sa limpide pureté me paraissent suffisamment riches et complexes ; une vie ne suffit pas à les maîtriser. Je n’ai donc pas le temps à perdre dans les souterrains de la sous-culture, fût-elle ancienne.
Quant à l’Inde, où j’ai eu la chance naguère de me rendre à trois reprises pour y dialoguer avec des brahmanes, elle m’intéresse en tant que conservatoire de valeurs et de rites remontant à notre préhistoire commune. Les trop peu nombreux cours de sanskrit suivis à l’ULB m’ont appris primo une forme de rigueur dans l’analyse, secundo l’importance des origines indo-européennes, jusque dans le vocabulaire.
Vous citez l’Allemand Ernst Jünger comme l’un des plus grands esprits du XX e siècle. Son personnage de l’Anarque dans le roman Eumeswill n’est-il pas la parfaite figuration du païen idéal des temps modernes ?
Je parle longuement d’Ernst Jünger dans Les Nobles Voyageurs, mon journal de lecture. J’ai eu la chance de correspondre avec lui à la fin de sa longue vie et même d’être cité dans Soixante-dix s'efface V, l’ultime volume de son journal.
Voici ce qu’il disait … à l’âge de cent ans : « Parfois, je pense que les Dieux aussi feront un jour leur retour, en se manifestant sous d’autres formes. Pour moi, dans la nature, le cosmos, il y a une dimension divine, sacrée. » Le même se range d’ailleurs parmi les partisans du retour à une expérience cyclique du temps : « La puissance du cosmos reste identique, il n’y a ni progression ou régression, ni accélération ou décélération qui puissent la modifier. Ce qui change, ce sont les figures... » Qui dit mieux en termes d’apollinienne clarté ? « Sans Dieux, pas de culture » confiait-il encore peu avant de mourir, alors qu’il méditait avec lucidité sur le retrait provisoire d'Apollon (« le poème s'affaiblit », remarquait-il) et son corollaire, le triomphe des Titans, c'est-à-dire, devant nous, cent ans de péril. Nous y sommes, dans le règne des Titans ! Comment ne pas partager ses inquiétudes sur le tournant totalitaire et brutal de notre époque ?
Vous traitez d’énormément de choses de l’esprit, d’auteurs et de livres, de textes et de citations, mais puis-je vous demander s’il existe une vision du corps, partant une diététique païenne, et si, dans la vie quotidienne, vous vous l’appliquez ?
Vous qui, cher Frédéric, êtes un ascète dans la plus pure tradition liégeoise, qui se nourrit de fèves bio des bords de Meuse et de thé vert, vous connaissez, y compris dans sa version wallonne, l’adage romain Mens sana in corpore sano, que nous devons à Juvénal. Etre philosophe, pour les Anciens, c’est aussi adopter un genre de vie. Les méthodes concentrationnaires de l’industrie agro-alimentaire, la pollution de notre biotope jusqu’au fond des océans, souillés par l’omniprésent plastique, jusqu’aux nappes phréatiques où se retrouvent des résidus chimiques et ce partout sur notre planète, ne peuvent que bouleverser l’homme conscient, et a fortiori le païen, c’est-à-dire quelqu’un qui tente de vivre en harmonie avec le cosmos – lequel commence dans notre cuisine.
Etre païen ne se limite pas à une forme de paillardise qui serait une saine réaction contre pisse-vinaigre et faux dévots. Tout ce qui nuit à la santé, les addictions et les drogues, la nourriture ultra-transformée, les produits de mauvaise qualité, les vins soufrés et bourrés de pesticides, sont aux antipodes du mode de vie païen. Engloutir une pizza surgelée est, comme le port d’un jogging informe ou d’une casquette de la police new-yorkaise, le premier pas vers la géhenne. En revanche, relire une Ode d’Horace en partageant un flacon pansu de vin naturel avec les amis relève de la plus ancienne civilisation.
Veuillez pardonner la brutalité de ma dernière question mais le but ultime du paganisme, par son inscription dans un vitalisme, son refus de la notion d’arrière-monde, son intransigeante discipline et sa quête de sagesse, n’est-il pas avant tout de se préparer à affronter la mort, pour lui voler sa victoire ?
Pour moi, être païen est en effet, malgré le bonum vinum du cher Horace, une forme d’ascèse : il s’agit, comme vous le dites, de parvenir à une forme de purification, non dans le sens d’un consolatrices, par essence des impostures. La mienne, de posture, est, je l’espère, éminemment tragique, aux antipodes de toute forme de ce que Montherlant appelait la morale de midinettes, aujourd’hui omniprésente comme les plastiques. Je ne puis croire un seul instant au salut, ni à tout ce qui nie la dimension tragique de l’existence. La lecture naguère de La Philosophie tragique, le chef-d’œuvre de Clément Rosset, un vrai Grec, m’a marqué à jamais. Le seul authentique blasphème, comme le dit Rosset, c’est l’oubli du tragique et l’acceptation de la consolation sous la forme de fables : espérance, rétribution post-mortem, salut sont pour moi des mots vides de sens. Des fables pour enfants terrifiés par la nuit obscure. Pour un vrai Grec, qui accepte l’irrémédiable, le destin est justifié autant qu’immérité. Non point l’illusoire bonheur, mais la joie. Refus de tout pathos, reconnaissance de l’universelle dureté : en ce sens, le récit, par Platon, de la mort de Socrate, qui boit la ciguë en devisant avec ses disciples, me touche autrement que celui de la Crucifixion du Fils (et son retour sur terre avant l’envol final). Je préfère donc les Dieux qui nous sauvent de la morale à Celui qui prétend nous « libérer » du destin, l’unique veritas sempiterna, pour citer Cicéron.
Christopher Gérard
Bruxelles, Calendes de juin MMXXV
Propos recueillis par Frédéric Saenen pour la Revue générale.
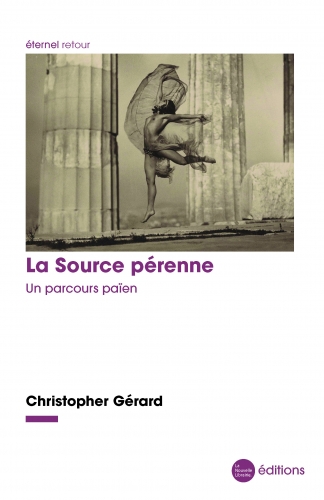
Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |








Les commentaires sont fermés.