18 février 2016
Raskar Kapac

Initiative aussi sympathique que bienvenue en ces temps post-littéraires : un quarteron de jeunes officiers s’unit pour ressusciter l’esprit des brûlots de jadis. On songe à Matulu ou à l’actuel Livr’Arbitres. À Immédiatement, aux Epées… Certes, Raskar Kapac, du nom d’un personnage des aventures de Tintin, ne comporte, pour le moment, que quelques pages, mais la tension y est. La fidélité aussi, puisque cette gazette à l’ancienne se propose d’honorer la mémoire de Jean-René Huguenin (1936-1962), l’auteur de La Côte sauvage, et surtout d’un Journal (1955-1962) qui, par son incandescence, a marqué à jamais tous ceux qui ont eu, jeunes pour les plus chanceux, le bonheur de lire ce moraliste impitoyable qui voulut fonder une aristocratie. Nombre de pages de ce Journal posthume nourrissent le lecteur fraternel, qui ne peut que s’y reconnaître : « Personne pour nous applaudir, presque rien pour nous encourager, et pourtant rester digne, rester un homme d’honneur ».
Tué dans un accident de la route, Huguenin serait sans doute devenu l’un des grands polémistes de sa génération, l’un de ces jeunes capitaines perdus – comme Nimier, qui le rejoignit dans la mort six jours plus tard.
Christian Dedet, écrivain secret de la trempe d’un Guy Dupré ou d’un Jean Forton, livre aux jeunes chouans de Raskar Kapac quelques souvenirs sur l’écrivain foudroyé, qui affirmait que « le génie, c’est d’être soi-même » et qui, par-dessus tout, haïssait la tiédeur. La gazette, dont on attend les prochaines livraisons, publie quelques pages inédites d’Huguenin, celles d’un roman inachevé. Goûtons ce tableau de la Libération : « Elle ne se débattait pas, ne criait même pas, ses yeux maintenant grand ouverts, offerts au ciel d’été avec horreur, avec extase, et la foule autour d’elle était devenue si silencieuse que l’on pouvait entendre le cliquetis de la tondeuse. Eric regardait leurs figures fixes, glacées par l’attention, et il devinait la voluptueuse douleur qu’ils éprouvaient à humilier, non pas cette jeune femme peut-être coupable, mais la race humaine, l’homme, eux-mêmes. »
Christopher Gérard
Raskar Kapac, trois sesterces. En kiosque.
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18 janvier 2016
Morphine monojet, ou le retour de Thierry Marignac
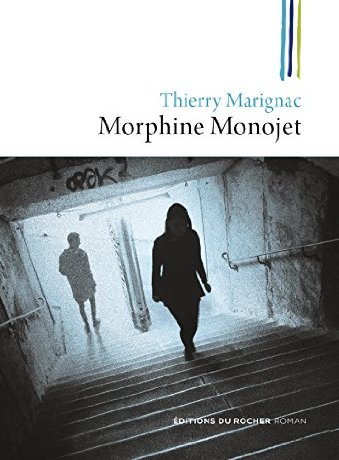
A la fin de Fasciste, livre-talisman, Thierry Marignac cède la parole à l’un de ces enfants perdus au crépuscule qui hantent son roman : « Je suis un décadent au fond, prêt à renoncer à l’ambition et au reste pour me gorger de plaisirs. Mais aujourd’hui, choisir les plaisirs, c’est choisir la mort ».
Morphine monojet illustre à merveille cette sentence en ce sens que ce roman déjanté et cruel, d’une drôlerie certaine, met en scène un quatuor composé, pour faire simple, de trois mousquetaires et d’une milady au chien d’enfer, lasse et presque belle : à ses basques, trois fils perdus – c’est le sous-titre du roman – en quête non d’un Graal de Bretagne mais d’une héroïne de Thaïlande ou de Turquie, coupée à l’infini, trafiquée dans de minuscules paquets qui s’échangent dans les bouges de Belleville. Il s’agit bien de cette diabolique « fringale de jouissance et d’anesthésiant aux entrailles de l’époque », qui se danse sur des airs vénéneux.
Nous sommes dans le Paris de 1979, qui est encore celui du « monde d’avant » comme dirait le confrère Jérôme Leroy, un Paris d’avant les bobos et les salafistes - un autre siècle. Un ashkénaze suicidaire, un fils perdu vaguement arménien (donc commis aux négociations) et Fernand, le Gaulois de la bande, bâtard sans famille, composent le trio des toxicos, obsédés par le brown sugar qu’ils s’injectent en faisant fi du plus élémentaire principe de précaution. Trois épaves en manque, qui tombent sur Jackie, fille d’une sorte d’espion britanique et d’une princesse d’Oman - qui, elle, joue avec la drogue et s’en sortira. Le vol, dans le somptueux appartement d’icelle, par l’un des futurs trimards, d’une seringue intacte datant de la guerre (celle de Dunkerque - Omaha Beach) emplie de morphine pure, lance tout ce petit monde dans une course poursuite absurde, quasi picaresque. Thierry Marignac s’amuse, et nous aussi, dans ce city movie enlevé, rapide - du nerf, de la gouaille sans chiqué, pas une once de gras. Hymne à la nuit, éloge tout en pudeur de l’amitié, requiem de l’Amour, Morphine monojet nous confirme que l’auteur de polars aussi originaux que Milieu hostile et Renegade Boxing Club a, de haute lutte, conquis sa place d’orfèvre par la grâce d’une langue drue et d’un œil de lynx.
Christopher Gérard
Thierry Marignac, Morphine monojet, ou Les Fils perdus, Le Rocher, 15,90€
Lire aussi, du même, Fasciste (Hélios noir), Renegade Boxing Club (Série noire) et Milieu hostile (Baleine).
Thierry Marignac, sur le confrère C.G. - éloge funèbre :
http://antifixion.blogspot.be/2013/11/christopher-gerard-heretique-du-moyen.html
Je dis encore plus de mal de Thierry dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature russe, héroïne | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30 décembre 2015
Présence de Pol Vandromme

Une indifférence de rébellion
Livre testament que ce florilège de chroniques et d’évocations composé par le regretté Pol(ydore) Vandromme (1927-2009) peu de temps avant sa mort. Dès l’exergue, le ton du livre, dédié à Jacqueline de Roux, l’épouse de son confrère et ami Dominique, est donné par cette citation de Maurice Scève : « Mon espérance est à non espérer ».
La fin du voyage approchant, le vieux critique, l’un des plus brillants et les plus profonds de ces septante dernières années, fait le point, « en désespoir de cause ». « On ne vieillit pas, écrit-il, on durcit à certaines places, on pourrit à d’autres. » Le remède à cette inévitable sclérose ? La tendresse. De critique, Vandromme se mue en moraliste, mais toujours avec l’allure qui convient, cette indifférence aux dogmes et aux diktats, cette hauteur tempérée par l’humour : « être à l’écart sans être au-dehors, être ici en étant ailleurs ». Voici donc sa feuille de route, destinée aux cadets, à tous ceux dont il salua les débuts avec une rare générosité. Une dernière fois, Vandromme se retourne pour saluer quelques auteurs, pour en égratigner d’autres.
Parmi les premiers, celui que, dans la conversation avec les cadets (le cher Marc Laudelout confirmera), il appelait, en toute simplicité, Louis. Louis ? Louis qui ? Céline, bien sûr, à qui il consacra l’un des premiers essais, juste après son compatriote Marc Hanrez. Non sans malice, Vandromme repère les disciples de l’immense Céline : Queneau, Sartre… Et rappelle que Bagatelles pour un massacre, pamphlet qui n’a pas été lu avec l’attention qu’il mérite en raison de terribles malentendus, est aussi « un manifeste littéraire de l’importance de la préface d’Hernani ». Pour Vandromme, les choses sont simples : Le Voyage au bout de la nuit constitue l’aboutissement et l’apothéose du surréalisme.
Modiano a droit à de belles pages, justes et profondes. Comme Froissart et Chimay, Tournai et Rodenbach, la Meuse et la Sambre. Et Fraigneau, le Vieil Européen. Et Gomez Davila, le réactionnaire pur sucre. Ou l’exquise Marie Nimier.
Mouchés en revanche, Steiner et sa « prose jargonnante aux cocasseries sentencieuses », Sollers (« il travaille dans le génie ; il est Céline les jours pairs, Joyce les jours impairs ; Kafka l’année bissextile »). Plus deux ou trois finauds et bricoleurs.
Rebelle sans rien de faisandé, Pol Vandromme nous adresse d’outre-tombe ce message de lucidité et d’amitié. Lisons-le.
Christopher Gérard
Pol Vandromme, Une Indifférence de rébellion, Pierre-Guillaume de Roux, 192 pages, 23 €
*
**
En mai 2005, j'avais adressé à Pol(ydore) Vandromme quelques questions pour un entretien paru dans La Revue générale.
Christopher Gérard : Lisant L’Humeur des Lettres, ce manuel du lecteur et de l’écrivain, je tombe sur ces lignes qui paraissent vous convenir à la perfection : « en discorde avec siècle, en harmonie avec la littérature ». Seriez-vous l’un de ceux que Nimier appelait les libertins du siècle ?
Vous êtes un critique clairvoyant, à l'intuition souveraine, ce qui me change heureusement des critiques aveugles qui brandissent leur canne blanche et qui ne s'aperçoivent de rien.
Votre devise ? Littérature d'abord ?
Si vous voulez, étant entendu que la littérature ne sert à rien, affranchie qu'elle est de la norme utilitaire - politique, morale, sociale, mercantile -, se bornant à être une incitation au plus voluptueux des plaisirs.
Et si vous deviez citer trois de vos maîtres ?
Puisque vous me contraignez à me borner - sans doute parce que vous croyez avec la sagesse populaire que les bonnes choses ne vont que par trois -, je choisis trois maîtres de style, Saint-Simon, Retz, Pascal
Parmi les écrivains belges (ou français de Belgique), quels sont ceux qui vous ont le plus fait pâlir ?
Par souci de sécurité - les mégères m'attendent au tournant pour bastonner le mauvais sujet, mauvais confrère de surcroît - je m'en tiendrai à des écrivains morts, Max Elskamp, Norge, Simenon, Henri Michaux et Marcel Thiry (parce qu'il m'a fait pâlir au nom de Vancouver).
Depuis plus de trente ans, vous commettez impunément le délit de faux en écriture. D'où vous est venu ce goût pour le pastiche littéraire ? Quel plaisir vous apporte-t-il ?
Parce qu'un écrivain, c'est d'abord un ton, un style. Parce que le pastiche, tentative de critique interne, est un jeu de rôle que soutient l'élan d'une sympathie de tour mimétique (du moins quand il est pratiqué à la suite de Proust, en réprouvant le dénigrement médiocre d'un Reboux). Parce que, en définitive, le plaisir n'a pas de raison à donner, la sienne suffisant à tout.
Parmi tous les auteurs que vous abordez, je ne trouve ni Elémir Bourges, ni Ernst Jünger. Vous imaginez sans peine ma stupéfaction. Justifiez-vous sur le champ !
En somme, vous exigez que je me mette à la mode et que je m'astreigne à un exercice de repentance. Dans le temple des dieux et des déesses, au pied de l'autel antique, je bats ma coulpe en récitant mon confiteor. Je réclame humblement votre pardon et, avec l'espoir que vous me l'accorderez, je suis sensible à votre indulgence, puisque vous ne me réprimandez qu'à propos de mon silence sur Bourges et Jünger. Il y a beaucoup d'autres grands auteurs qui ne sont pas traités dans mon recueil et qui eussent mérité de l'être. Il me semble que vous auriez dû m'accabler de votre courroux en regrettant que mon recueil ne soit pas encyclopédique.
Je vous absous. Et vos projets?
Quoi ! Vous n'avez pas l'air de vous souvenir de La Fontaine: Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge ! Un quasi-octogénaire peut avoir des projets, mais aucune assurance de les mener à bien. Voici les miens, pourvu que le Dieu des chrétiens me prête vie: un volume de souvenirs, un essai sur Jacques Perret (Jacques Perret, Gaulois de noble origine, Editions du Rocher) un volume de chroniques, cette fois consacré à des écrivains contemporains. Rien donc qui puisse satisfaire le sens de l'histoire et la conscience universelle.
Dans Les Nobles Voyageurs, je rends hommage à Pol Vandromme.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16 novembre 2015
Matzneff noster

Récemment, je terminais l’une de mes chroniques consacrées à Gabriel Matzneff en rappelant que, quoi que grommellent les envieux, ce disciple d’Epicure compte parmi les rares classiques d’aujourd’hui.
L’opportune réédition de Boulevard Saint-Germain, augmentée d’une magnifique préface, m’offre l’occasion de confirmer ce jugement : quelle fluidité de la langue, quelle aisance à invoquer les ombres comme à chanter les plaisirs de l’existence, quel éloge de Paris, la cité de l’empereur Julien !
Voyez ces lignes : « Souvent, lorsque je suis à Paris et que l’air est doux, je vais m’asseoir sur un banc du square de Cluny qui, entre les ruines du palais et l’asphalte du boulevard Saint-Germain, forme un timide asile de verdure, et, fermant les yeux, je me dis : « Rentre en toi-même, Gabriel, et comprends que c’est ici, oui, ici, que le Génie de l’Empire est, en cette nuit mémorable, apparu à Julien. » Quelle plus belle évocation, digne d’un mage de l’ancienne religion, que celle d’une nuit glaciale de février 360, quand les troupes celtes révoltées portèrent sur le pavois le jeune Julien, proclamé empereur à Paris ! L’aventure, trop courte, de Julien II dit l’Apostat commençait. Et voilà que l’orthodoxe Matzneff s’exclame : « rien n’est plus digne de respect que la tentative de restauration opérée par Julien : offrir à nouveau des sacrifices sur les autels abandonnés de Vénus et de Bacchus ».
A l’époque de la première édition, en 1998, Paris n’avait pas encore honoré son premier empereur (le second étant Napoléon). Contrairement à ce que m’écrit l’ami Matzneff dans son envoi manuscrit, cet oubli a été réparé, puisqu’une venelle du XIVème arrondissement porte l’illustre patronyme. A l’époque, j’avais eu l’heureuse surprise de découvrir que je figurais parmi les personnages de ce roman parisien, aux côtés de S.A.I. Julien II, de Casanova et d’Armani, de Montherlant et de Bourvil…
Matzneff nous fait visiter son Paris, ses librairies et ses restaurants, ses salons (celui de Jacques de Ricaumont, détenteur d’une recette mythique de gâteau au chocolat) et ses boutiques. Il nous éblouit par un savoir d’une parfaite élégance.
Boulevard Saint-Germain ? Un hymne au bonheur, à lire et relire en hommage à la cité en deuil. Une pérégrination urbaine, tour à tour drôle et érudite, coquine et émue, un fragment de mémoire que nous laisse ce libertin de race, qui masque à peine une âme inquiète, en laquelle s’équilibrent virilité et sensibilité.
Christopher Gérard
Gabriel Matzneff, Boulevard Saint-Germain, La petite vermillon, La Table ronde, 8,70€.

Sur Gabriel Matzneff,
lire aussi mon Journal de lectures
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, paris | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08 octobre 2015
Les Années Foch
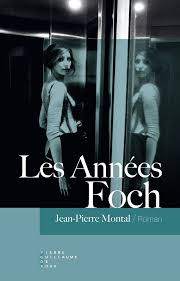
Biographe de Maurice Ronet, Jean-Pierre Montal dirige Rue Fromentin, une jeune maison d’édition qui a publié un Dictionnaire élégant de l’automobile ainsi qu’un curieux album sur Roger Nimier.
Voilà que, par un joli coup d’essai, il se lance comme romancier et nous fait entendre une voix singulière, entêtante malgré de menues faiblesses, et qui peut faire songer à une sorte de Modiano post-moderne.
Dans Les Années Foch, Montal trace le portrait d’une génération d’enfants perdus, celle de 1995. Le héros ? Un étudiant de province monté à Paris pour y suivre les cours bidon d’une école privée de journalisme (amusants pastiches), mais aussi pour se lancer sur les traces encore fraîches d’une amie d’enfance, évaporée sur les trottoirs de Babylone. Son point de chute ? L’ancienne Avenue du Bois, où Boni de Castellane, le dandy de la Belle Epoque, se fit jadis construire, avec les dollars de son Américaine, le Palais rose, une réplique du Grand Trianon. L’avenue Foch donc, luxueuse et crapuleuse, avec sa faune de diplomates, de proxénètes géorgiens et de tapineuses dites de luxe, avec ses oisifs neurasthéniques et, last but not least, Michel Damborre, dandy lui aussi, mais des sixties, plus ambigu que son modèle et qui m’a fait songer au Sir Craven de Tempo di Roma, ce chef-d’œuvre.
Last, j’exagère, car en fait, car Montal présente, en guise de clin d’œil, une autre figure du milieu parisien, « chauve rondouillard aux lunettes noires », « l’auteur de Métapolitique de l’invisible », qui ne peut être que le sosie du regretté Jean Parvulesco. Là, c’est à Melville que l’on songe, à ses nuits ouatées, pleines de mystère et d’angles morts.
Le coup de maître de Montal, je le vois pour ma part dans l’épilogue, où il revient sur les lieux du crime une génération plus tard, c’est-à-dire en 2020. Le héros a pris des rides et du bide du côté de New York ; il retrouve le Paris glaçant de la numérisation globale et du pistage cybernétique, un Paris aux voitures silencieuses, cool et sans migrants. Ces quelques pages, comme sabrées, frigorifient. Méditation sur l’aliénation moderne, Les Années Foch analysent sans pitié le désenchantement d’une génération forcée de vivre dans un monde toujours plus injuste et plus laid.
Christopher Gérard
Jean-Pierre Montal, Les Années Foch, Pierre-Guillaume de Roux, 192 pages, 20.90€
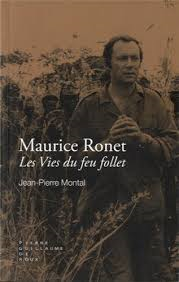
Mon papier sur ce bel essai :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2013/10/07/tombeau...
Lire aussi :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, dandysme | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







