13 septembre 2016
Avec Arnaud Bordes
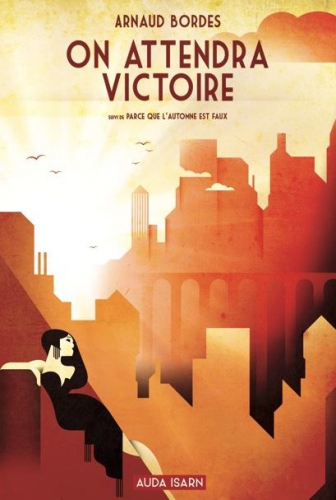
Editeur se mouvant avec grâce dans une clandestinité supérieure (voir http://alexipharmaque.net), Arnaud Bordes est avant tout écrivain, et l’un des plus fins connaisseurs de la Décadence et de l’esthétique fin-de-siècle. Des textes rares tels que Pop conspiration ou La Matière mutilée avaient attiré l’attention des amateurs de livres denses et cryptés, parfois jusqu’au vertige, et qui semblent constituer les prémisses d’un grand roman antimoderne. Notre Des Esseintes récidive aujourd’hui avec un double opuscule, mi-récit d’anticipation, mi-journal musical et littéraire.
On attendra Victoire ne peut se résumer : obscur et prophétique, le récit, présenté comme artificiel, date du monde d’après, celui des Barbares. Banlieues en flammes & charniers ou, pour citer Bordes : « villes noircissant dans les fumées d’incendies, pillages, populations déplacées, périphériques ravagés, unités auxiliaires errantes et radicalisées (sic) ». Tel est le tableau, sur fond d’officines occultes, de complots masqués aux yeux d’une opinion sidérée avec art. Pointilliste et avec un je-ne-sais-quoi de flamand, la peinture de cet après-monde contraste avec les souvenirs des divers narrateurs, tous plus ou moins liquidés à un moment ou un autre et qui se souviennent, qui d’une lecture d’Huysmans ou de Villiers de l’Isle-Adam, qui d’un air entêtant de Joy Division ou de Vogelsang.
Parce que l’automne est faux est le journal d’Arnaud Bordes (2004 – 2015), où son travail d’éditeur apparaît (trop) peu. Lectures (names, names, names !), musique (idem), jeunes femmes (anonymes). Paul Morand et Jules Verne (en effet grand romancier initiatique et géopolitique), Ernst Jünger et le regretté Jean Parvulesco, les chers David Mata et Bruno Favrit, et bien entendu Nerval, Eliade, tant d’autres, passent, parfois d’un pas trop rapide, comme si l’auteur avait la tête ailleurs. Fulgurantes, quelques formules claquent : « Tout est plaie depuis la mort des rois ».
Un bémol toutefois. L’avalanche de noms propres, bien que parfois poétique. Des coquilles, nombreuses (hendiadys, Libye…) et surtout la syntaxe, comme relâchée à dessein, par coquetterie « artiste ». Or, même en version décadente, l’écrivain ne doit-il pas, avec l’humilité du chevalier médiéval, vénérer la langue qu’il aime et sert ?
Christopher Gérard
Arnaud Bordes, On attendra Victoire. Suivi de Parce que l’automne est faux, Editions Auda Isarn, 156 pages, 17 piastres.
Voir aussi mes Quolibets
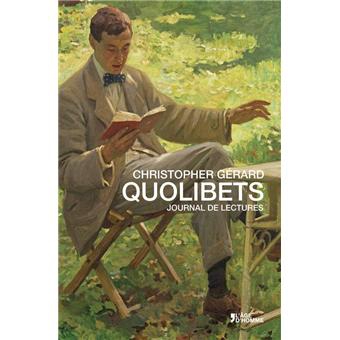
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07 septembre 2016
Adios ou l'éloge du monde d'avant
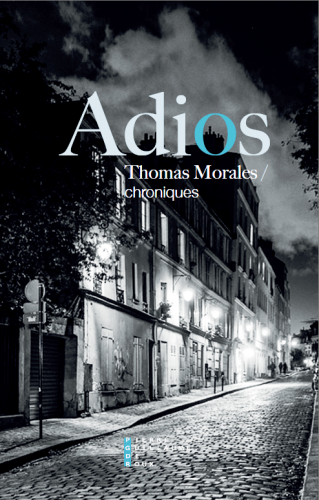
Eloge du monde d’avant
Auteur d’un Dictionnaire élégant de l’automobile (Rue Fromentin), critique littéraire et de cinéma, Thomas Morales aime les actrices et les voitures des années 50, 60 et 70. Et les films d’Audiard, l’Italie d’avant Berlusconi, la BD et la télévision un peu nunuche de ces années-là. Une sorte de réactionnaire souriant à la mémoire d’éléphant, incollable sur les Alfa Roméo et Nathalie Delon, sur Michel Constantin et Claudia Cardinale, Pilote et de Playboy. Une encyclopédie du monde d’avant, dont il exalte la nostalgie dans Adios, recueil de chroniques parues dans Causeur, Valeurs actuelles ou Service littéraire. Sa devise ? In retro veritas. A le lire, on goûte cette sensibilité passéiste, nourrie d’une impressionnante culture : Ronet et Belmondo, les films de Philippe de Broca et de Michel Audiard, Paul Meurisse (alias Théobald Dromard), Blondin et Berthet, ADG et Malet, La Dame de Monsoreau et Les Brigades du Tigre, tels sont les personnages de ce roman antimoderne d’une France encore préservée de l’horreur techno-marchande, une France où le mot « identité » n’avait aucun sens, puisque tout le monde communiait dans la même liturgie.
Parfois forcée (les années 70 furent, quoi qu’il prétende, un modèle de kitsch aux antipodes d’un âge stylé), la mélancolie de Thomas Morales n’en demeure pas moins communicative, tant son talent d’évocation, qui est celui d’un artiste, fait oublier un instant de justes préventions. Philippe d’Hugues avait en son temps publié chez Bernard de Fallois une fort convaincante défense et illustration des 50’. Thomas Morales s’inscrit à sa manière dans cette filiation, une certaine naïveté en plus.
Christopher Gérard
Thomas Morales, Adios. Eloge du monde d’avant, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 172 pages, 17€
Voir aussi mon Journal de lectures :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25 mai 2016
La droite littéraire

"La vie n'est pas le critère à partir duquel on juge l'art."
Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la littérature française, 2005.
Journaliste et normalien, auteur d’un essai sur le voyage d'écrivains français à Weimar sous l'Occupation (Le Voyage d’automne, Plon, 2000), F. Dufay se penche, dans Le soufre et le moisi. La droite littéraire après 1945. Chardonne, Morand et les hussards (Perrin), sur la droite littéraire après 1945 en comparant les itinéraires croisés de Paul Morand et de Jacques Chardonne. Ces deux phares de l’avant-guerre doivent « repartir à zéro » non en raison d'une quelconque collaboration mais plutôt de compromissions. « Rien d’horrible en fait », admettra Bernard Frank: quelques textes favorables à l'Europe nouvelle pour Chardonne, ancien dreyfusard et ami de L. Blum, défendu en 1945 par Mauriac et Paulhan. Morand, quant à lui, représente Vichy à Bucarest et à Berne sans pour autant s'impliquer dans la Révolution nationale. En 1953, il est réintégré dans la Carrière. Pendant la guerre, ces deux écrivains interviennent en faveur de proscrits (le propre fils de Chardonne est déporté pour espionnage). Avec le triomphe sans partage de la gauche idéologique, adepte d'une épuration permanente, toute la droite se voit en 1945 ostracisée par une nouvelle caste dominante, acquise aux utopies révolutionnaires, et qui organise autour d’elle une véritable conspiration du silence. La mode existentialiste, la toute-puissance de Sartre et des Temps modernes, le terrorisme intellectuel du PC et de ses filiales font alors peser une chape de plomb sur la vie culturelle. F. Dufay semble tout ignorer de l'atmosphère tendue de l'époque: pensons à l'affaire Kravchenko, à la négation systématique des atrocités soviétiques, aux procès de Moscou. Une poignée d’écrivains – M. Dufay écrirait « un quarteron » - se ligue pour défendre une liberté de création réellement mise en danger, ainsi que les nombreux interdits de séjour (plus d'une centaine d'auteurs, qui figurent sur la liste noire du CNE): les hussards, inventés par B. Frank dans son fameux "Grognards et hussards". Roger Nimier, le plus actif d’entre eux, se lie avec Morand et Chardonne avant de réhabiliter Céline de façon quasi miraculeuse. Tous ces « non-conformistes des années cinquante » ferraillent contre les professeurs de marxisme, les démocrates-chrétiens apeurés et autres compagnons de route.
Parmi ses multiples faiblesses, le livre superficiel de F. Dufay ne mentionne pas le lien évident avec les réseaux révolutionnaires-conservateurs des années 30, étudiés en leur temps par J.-L. Loubet del Bayle, puis par Nicolas Kessler. La monumentale Histoire des droites en France, publiée sous la direction de J.-F. Sirinelli (Gallimard) n'est pas même citée, pas plus que les thèses de N. Hewitt, de G. Loiseaux ou de J. Verdès-Leroux: il s'agit du travail d'un journaliste, plus friand d'anecdotes que d'analyses. A F. Dufay revient toutefois le mérite d'avoir souligné le paradoxe suivant: les apôtres du désengagement et d'une frivolité toute "parisienne" ont souvent fait leurs classes à l’Action française ou dans ses marges; certains reprennent du service au moment de la guerre d’Algérie (Nimier et Laurent appartiennent à la mouvance OAS). Leur désinvolture, leur indifférence à l’histoire ressemblent à des leurres : comme le remarque à juste titre B. Frank, « ce sont des écrivains que les circonstances ont contraint à se moquer de la politique ». Cette indifférence feinte pour l'histoire masque à peine l'impuissance des vaincus. Mais ce constat, B. Frank l'avait fait en 1952 avec autant d'élégance que d'esprit. F. Dufay, lui, se montre bien plus sévère que son talentueux prédécesseur et propose, au lieu d'une essai littéraire tentant de comprendre une époque troublée (la fin d'une guerre civile, les débuts de la guerre froide), une sorte d'enquête policière où le gendarme fait la morale aux délinquants, un sermon où le puritain fustige les libertins. Son moralisme est d'autant plus agaçant qu'il est anachronique, fondé sur des a priori illustrés par un vocabulaire qui trahit son hostilité profonde pour des écrivains injustement qualifiés d'épigones: les hussards, "ces écrivaillons bourrés de tics", dont le pedigree serait "chargé", "sévissent" dans des revues "ou autre Table ronde"; ils sont nourris de la "soupe primitive de l'Action française", etc. A-t-il vraiment lu toute l'œuvre de Déon et de Laurent? A-t-il pris la mesure de la mise au pas des lettres françaises en ces années d'après-guerre? Quant à Morand et Chardonne, stylistes reconnus par leurs pairs, ils se distingueraient par "une commune sécheresse de style et de cœur". Morand, qui travaille jusqu'à son dernier souffle, l'auteur de plus de 60 livres entre 1920 et 1976, date de sa mort, réduit à quelques pages d'un journal intime où il passe sa rage devant le déclin d'une civilisation! Un superbe écrivain jugé à l'aune du politiquement correct le plus abêtissant!
En outre, l'accumulation de clichés ne constituant pas une analyse, le lecteur a l'impression de lire un pamphlet dont l'auteur se contente trop souvent de lectures partielles (de préférences des citations courtes d'écrits privés), de procès d'intention (l'antisémitisme présumé, jamais prouvé, de Nimier ou de Déon; la volonté prêtée à Chardonne de lancer une épuration à l'envers). F. Dufay a pu consulter la fameuse correspondance quotidienne échangée entre Morand et Chardonne, d'où la méchanceté n'est pas toujours absente, c'est un fait… qui ne prouve rien, si ce n'est que deux scrogneugneus peuvent très bien dire du mal de leurs contemporains comme nous le faisons tous un jour ou l'autre. Pratiquer une telle réduction du supérieur à l'inférieur - une manie des biographes à l'anglo-saxonne? - n'est-ce pas négliger l'essentiel: l'œuvre de ces artistes, manifestement méconnue. Qualifier un joyau classique tel que Parfaite de Saligny de "perle rococo" n'est pas une preuve de goût ni de lucidité. Insister avec lourdeur sur la "sécheresse" de Morand, c'est oublier que, dans Tais-toi, l'artiste met en scène un homme paralysé par la pudeur et le goût de la solitude. C'est ne pas tenir compte des témoignages nombreux - Jacques Brenner, dans Le Flâneur indiscret ou Marcel Schneider, dans L'Eternité fragile - sur l'attention portée aux cadets de Chardonne, la jeunesse d'esprit et la gentillesse d'un Morand léguant sa garde-robe à un homosexuel notoire (sans parler des Juifs aidés au bon moment, puisque tel est devenu le critère absolu).
L'artiste. Voilà celui que F. Dufay ne réussit pas à comprendre, et donc à aimer. Il aurait dû réfléchir à cette phrase de Barthes, tirée de Sur Racine (1963): "tout le monde sent bien que l'œuvre échappe, qu'elle est autre chose que son histoire même, la somme de ses sources, de ses influences et de ses modèles: un noyau dur, irréductible, dans la masse indécise des événements, des conditions, des mentalités collectives". Il n'a rien vu du mystère de la création, du salut par l'art grâce au purgatoire imposé (probablement mérité) à ces écrivains qui, mis hors jeu, se rétablissent grâce à leur talent bien davantage que par l'action souterraine d'une quelconque conjuration.
© Christopher Gérard
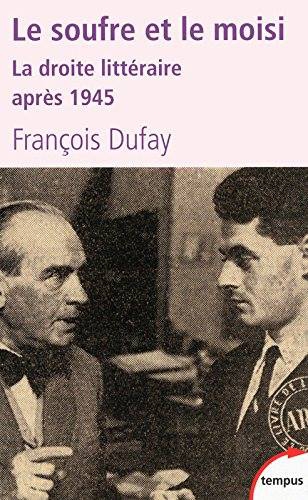
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09 mai 2016
Le journal littéraire de Marc Hanrez : Poste restante
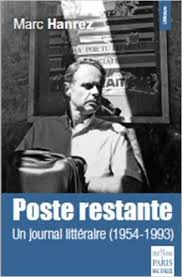
Heureuse idée qu’a eue Marc Hanrez (1934), de publier un bref extrait, la pointe de l’iceberg, d’un journal intime tenu de 1958 à 2000. Des 6000 pages que compte ledit journal, il en a extrait une centaine, relatives au milieu littéraire qu’il a côtoyé depuis ses années d’étudiant à l’Université Libre de Bruxelles jusqu’au campus de Madison (Wisconsin, USA), où il a, trente ans durant, enseigné la littérature française.
Etudiant en philologie romane, il subit, comme tant d’autres, le choc du Voyage, lu quasi d’une traite dans un train de nuit. C’est au style de Céline qu’il consacre son mémoire de licence. Notons que, à peine dix ans après la guerre, étudier des écrivains maudits ne semble nullement tabou. A la même époque, il se passionne pour Drieu la Rochelle, à qui il pense consacrer une thèse, avec l’assentiment d’un ponte de l’ULB : « ses limites sont émouvantes, comme est poignante sa lucidité généreuse ». Invité par Céline, il a eu le privilège de le rencontrer à Meudon, et même de l’enregistrer : « J’ai foutu en l’air toutes leurs incantations, le tralala syntaxique, etc. ». C’est à Hanrez que Céline lance : « l’histoire de l’homme blanc s’est terminée à Stalingrad… à bout de souffle … le théâtre blanc a fermé».
Avec l’aide de Roger Nimier, qui le reçoit à bras ouverts chez Gallimard, le jeune philologue publie l’une des premières monographies consacrées à celui qu’il considère comme un grand moraliste européen. Suivront d’autres études sur Céline, un magnifique Cahier de l’Herne consacré à Drieu, le premier essai consacré à Abellio… et aussi quelques recueils de poèmes raffinés, comme Chemin faisant (Ed. Xénia).
En soixante ans, Marc Hanrez a rencontré du grand monde : Cocteau, Nimier, son grand ami Dominique de Roux, Aymé, l’égaré J.-E. Hallier, Vladimir Dimitrijevic alias Dimitri, et même Sollers (« le pitre intégral »), à qui il semble fort lié. Des Belges aussi, et non des moindres : le hussard Vandromme, le très-étrange Marcel Lecomte (« ineffable, apollinien, dionysiaque et pontifiant »), les professeurs Emilie Noulet et Roland Mortier, Norge et Bertin, Robert Poulet (« un genre canaille intellectuelle et raffinée »). Curieusement, aucune trace de Marc Laudelout, l’insubmersible éditeur du Bulletin célinien.
Ce journal littéraire nous promène des années 50 aux premières années du siècle XXI, des campus américains au Café de la Mairie, place Saint-Sulpice ; le lecteur y croise Jean Marais et Marc-Edouard Nabe, Gabriel Matzneff et le traducteur de Jünger, Julien Hervier. Quelques jolies femmes. A Madison, il reçoit Borges et Butor, Genette et Kristeva. Comment ne pas envier celui qui a eu la chance et de consulter les livres annotés de la main même de Drieu, et d’entendre Jean Cocteau déclarer au tout Bruxelles de 1955 : « le poète est un anarchiste et un aristocrate ». Un joli livre qui, en ces temps post-littéraires, se lit avec une pointe de mélancolie.
Christopher Gérard
Marc Hanrez, Poste restante. Un journal littéraire (1954-1993), Editions de Paris, 96 pages, 14€
On dit du mal de Marc Hanrez dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24 février 2016
Bonnes nouvelles de Gérard Oberlé

Ripailleur, anarchiste, polyglotte, bibliophile et dipsomane : ce Chassignet que nous décrit Gérard Oberlé se révèle franchement suspect, au point, horresco referens, de se gausser des « histrions de l’erreur galiléenne », du « pilou-pilou théophagique », et de s’afficher, non sans crânerie, comme « un adepte tardif des cultes abolis ». Circonstance aggravante, le bougre cite Pétrone et Rabelais, chante les vins de Bourgogne et, oui, l’oubli, « l’oubli plus doux que le souvenir ».
Puits de science, l’auteur d’Itinéraire spiritueux et des splendides Mémoires de Marc-Antoine Muret récidive ainsi avec ce récit en trois parties, où le lecteur partage la vie d’un humaniste français du XXIème siècle, des rivages du Nil aux paillottes de la Nouvelle-Calédonie, en passant par le Sud profond. C’est à Assouan, dans ce palace Old Cataract que fréquentèrent Agatha Christie et Winston Churchill, que se déroule le récit le plus abouti du recueil : Oberlé décrit avec délices ses amis égyptiens, la faune haute en couleurs des expatriés… Une baronne perdue, un exilé romain, un dandy bostonien, l’inévitable voyou local dansent sous nos yeux une pavane quelque peu surannée, juste assez funèbre, ô combien séduisante. Délicieusement à rebours du siècle jusque dans sa mélancolique gaieté, le styliste entortille son lecteur par d’érudites calembredaines. Gérard Oberlé ? Un baroque égaré, un Païen de la décadence, un Précieux libertin : le petit maître dans toute sa splendeur.
Salve, nobilissime.
Christopher Gérard
Gérard Oberlé, Bonnes nouvelles de Chassignet, Grasset, 212 pages, 17 sesterces.
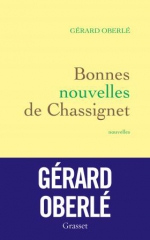
Voir aussi mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, bourgogne | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







