11 décembre 2014
Agnotologie

Agnotologie.
Un nouveau vocable appris ce jour en sirotant un café éthiopien chez Aksoum (http://www.aksumcoffeehouse.com/) et en lisant le Monde diplomatique, gracieusement mis à ma disposition : créé par un professeur de Stanford, le terme désigne cette science de l’ignorance (au service, qui l’eût cru, d’un néo-capitalisme libidinal – merci mai 68) qui consiste à organiser le brouillage intégral des repères, à entretenir un obscurantisme hargneux, tout cela pour vendre du tabac synthétique ou du vin soufré, pour détruire l’école publique, pour…
Agnotologie. De quoi transformer un fringant conservateur (Votre serviteur) en Garde rouge – ou plutôt en Garde blanc (les épaulettes, le style...).
« Il faut, contre cette société, constituer une force de combat, libre de toutes les vieilles doctrines, un corps-franc".» dixit Drieu (Gilles).
Sabre au clair !

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : agnotologie, armées blanches | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03 novembre 2014
Désuet, Christopher Gérard ?

Désuet ?
Dans sa note Osbert & autres historiettes, Loïc Di Stefano, du Salon littéraire, (http://salon-litteraire.com/fr/christopher-gerard/review/...) évoque, non sans gentillesse, le caractère désuet de ce livre, voire de mon style.
Désuet est introuvable dans Littré, car le mot n’apparaît qu’à la fin du XIXème, formé sur le participe du verbe latin desuesco : « je me déshabitue » (merci Gaffiot). Mais c’est tout moi, cela : déshabitué ! Je dirais même plus : décontaminé. J’assume, je persiste et signe : désuet, jusqu’au bout des ongles. Et même suranné, voire archaïque, que dis-je ? attardé. Car je m’attarde (en bonne compagnie) loin des blandices du siècle, je musarde tout en gardant à l’esprit que Littré disait des mots tombés en désuétude qu’ils peuvent difficilement être rayés de la langue vivante. Désuet peut-être, mais coriace.
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : désuet, littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24 octobre 2014
De l'Elégance masculine
Julien Scavini, arbitre des élégances

Excellente idée qu’a eue le jeune tailleur parisien Julien Scavini, de publier ses intelligentes réflexions sur l’élégance masculine sous la forme d’un album illustré avec goût, qu’il a intitulé Modemen, avec un clin d’œil aux amateurs de cette fameuse série US, Mad Men, qui a tant fait pour remettre à l’honneur une esthétique classique. Lorsque je lui ai rendu visite dans sa ravissante boutique située à quelques encablures des Invalides, Scavini m’a expliqué que, au départ, il avait une formation d’architecte et qu’il avait appris le métier de tailleur par la suite. Pourquoi avoir abandonné l’architecture ? La crise, et surtout une formation par trop cérébrale négligeant le goût et le bon sens au profit d’un radotage postmoderne (Bourdieu, Derrida & tutti quanti). Surtout : la passion du beau ; le goût des étoffes ; la volonté d’illustrer et de défendre une élégance intemporelle. Car Scavini tient clairement pour l’élégance anglaise, dans la lignée de l’illustre James Darwen, l’auteur d’un livre talisman, hélas épuisé, que tout gentilhomme a posé sur sa table de chevet, Le Chic anglais.
Modemen se présente comme un bel album dont toutes les illustrations sont de la main de l’auteur, dans un style que je rapprocherais de la ligne claire, celle d’Hergé. Pas une seule photographie donc, mais des dessins soignés… dignes d’un architecte (qui aurait désappris Bourdieu !). Scavini y répertorie les 101 basiques du vestiaire masculin, de la cravate aux souliers, en passant bien entendu par le costume, sa spécialité. Etoffes, cols, coupes et astuces, accessoires et détails de fabrication (le veston, entoilé ou, horresco referens, thermocollé ?), notre jeune spécialiste passe tout en revue sans dogmatisme aucun, toujours fidèle au goût classique - rien de trop -, mais sans jamais jouer au scrogneugneu ni au ringard. Bref, un ouvrage précieux, enrichi d’une liste d’adresses, malheureusement limitée à la seule Lutèce.
Christopher Gérard
Julien Scavini, Modemen, Ed. Marabout, 224 p., 16.90€
Voir le site et le blog de Julien Scavini : http://www.scavini.fr/

*
**
James Sherwood, gentleman londonien

The Perfect Gentleman ! Quel gentilhomme ne rêve d’égaler Oscar Wilde, Cary Grant ou l’actuel Prince de Galles, ces modèles de classe et de raffinement ? Sous ce titre lumineux, James Sherwood, le spécialiste de l’élégance britannique - il est l’auteur de l’ouvrage de référence sur les tailleurs de Savile Row* - propose un album somptueusement illustré où sont reprises les trente maisons londoniennes qui comptent, ces maisons mythiques qui fournissent rois et princes depuis deux siècles et qui, aujourd’hui, connaissent une étonnante renaissance grâce à une clientèle exigeante qui ne veut plus d’une production de masse ni de ces « grandes marques » pour parvenus internationaux.
Tabac, fusils, portos, tweeds, chemises : tout l’univers fermé de l’upper class britannique ouvre un instant ses portes et révèle ses traditions d’excellence ainsi qu’un conservatisme de bon aloi, puisque ces entreprises, souvent familiales, préservent et développent un savoir-faire ancestral, allié à un redoutable sens du commerce. Grâce à ce Perfect Gentleman, nous savons (ou nous voyons confirmer ce que nous avions appris par ouï-dire, entre deux portos) où trouver le chapeau (chez Lock), la flanelle (chez Fox Brothers), le stilton ou la popeline, les parapluies victoriens et les costumes bespoke - c’est-à-dire taillés à la main sur mesure pour une personne qui a décidé de tous les détails, jusqu’aux plus invisibles. Comme le montre bien l’ouvrage, la quintessence du luxe anglais se trouve concentrée dans un espace unique au monde, celui de Picadilly et de St James, qui est aussi celui des clubs, où se croisent les ombres de Byron et de Brummell.
Christopher Gérard
James Sherwood, The Perfect Gentleman, Thames & Hudson, 222 pages, 38£
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : élégance, dandysme | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23 octobre 2014
Présence de Thierry Maulnier
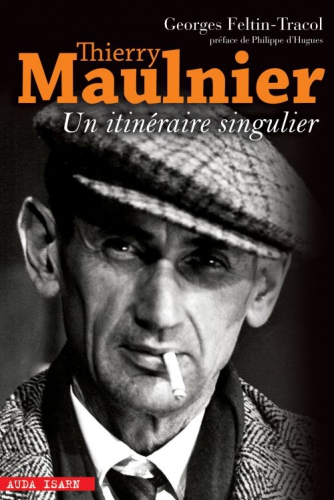
Itinéraire singulier que celui de Jacques Talagrand (1909-1988), mieux connu sous son pseudonyme de L’Action française, Thierry Maulnier. Normalien brillantissime, condisciple de Brasillach, de Bardèche et de Vailland, Maulnier fut l’un des penseurs les plus originaux de sa génération, celle des fameux non conformistes des années 30, avant de devenir l’un des grands critiques dramatiques de l’après-guerre, ainsi qu’un essayiste influent, un chroniqueur fort lu du Figaro, et un académicien assidu. Un sympathique essai tente aujourd’hui de sortir Maulnier d’un injuste purgatoire, moins complet bien sûr que la savante biographie qu’E. de Montety a publiée naguère, puisque l’auteur, Georges Feltin-Tracol, a surtout puisé à des sources de seconde main. Moins consensuel aussi, car ce dernier rappelle à juste titre le rôle métapolitique de Thierry Maulnier, actif dans la critique du communisme en un temps où cette idéologie liberticide crétinisait une large part de l’intelligentsia, mais aussi du libéralisme, parfait destructeur des héritages séculaires. Car Maulnier, en lecteur attentif des Classiques, savait que l’homme, dans la cité, doit demeurer la mesure de toutes choses sous peine de se voir avili et asservi comme il le fut sous Staline, comme il l’est dans notre bel aujourd’hui. Feltin-Tracol souligne par exemple le fait que, peu après mai 68, Maulnier s’impliqua aux côtés d’un jeune reître au crâne ras, qui avait tâté de la paille des cachots républicains, dans l’animation d’un Institut d’Etudes occidentales qui influença la toute jeune nouvelle droite. L’activiste en question s’appelait Dominique Venner, futur écrivain et directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire…
Le digne académicien, le ponte du Figaro, n’avait pas oublié sa jeunesse d’orage, quand, exaltant Nietzsche et Racine dans deux essais mémorables, il critiquait les mythes socialistes ou nationalistes, et analysait cette crise de l’homme européen dont nous ne sommes pas sortis, en tout cas par le haut. Héritier de Maurras, mais de manière critique et sans servilité aucune (posture moins courante qu’on ne le croit chez les intellectuels français, si friands d’obédiences et de chapelles, si perinde ac cadaver ), Maulnier prôna dans des brûlots tels que L’Insurgé (dangereusement proche de la Cagoule, comme me le dit un jour le délicieux Pierre Monnier, salué comme il se doit dans la jolie préface de Philippe d’Hugues) ou Combat une révolte spirituelle (et agnostique), aristocratique (et libertaire), conservatrice (et personnaliste), aux antipodes des mises au pas rouges ou brunes. Son credo peut se résumer par une phrase de son vieux maître provençal : « un ordre qui est une tendresse tutélaire pour la chair et l’âme des hommes et des choses, à qui il permet de naître, de grandir, et de continuer d’être ». En un mot comme en cent, la subversion classique, celle-là même qu’illustra l’écrivain Jacques Laurent.
Penseur lucide et inquiet, sensible au déclin d’une Europe fracturée, Maulnier ne cessa jamais de réfléchir au destin de notre civilisation, notamment en faisant l’éloge de Cette Grèce où nous sommes nés, qui « a donné un sens bimillénaire à l’avenir par la création d’une dialectique du sacré et de l’action, de l’intelligence héroïque et de la fatalité ». Ces simples mots, aussi bien choisis qu’agencés, montrent que Maulnier ne fut jamais chrétien, mais bien stoïcien à l’antique – ce qui le rapproche de la Jeune droite des années 60.
Insulté par la gauche idéologique, calomnié par la droite fanatique, tenu pour suspect par les bien-pensants (un sportif qui lisait Nietzsche !), Maulnier fut un homme relativement isolé, qui n’adouba nul disciple. Voilà une raison de plus pour lire Maulnier, ses Vaches sacrées, sa lumineuse Introduction à la poésie française, qu’il composa avec son amie de cœur, la future Pauline Réage.
Christopher Gérard
Georges Feltin-Tracol, Thierry Maulnier. Un itinéraire singulier, Ed. Auda Isarn, 106 p., 18€
Voir aussi Etienne de Montety, Thierry Maulnier, Julliard.
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, thierry maulnier | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07 octobre 2014
L'Abondance et le rêve

Sous ce titre révélateur, L’Abondance et le rêve, Christian Dedet publie la suite de son Journal des années 60, qui avait débuté par Sacrée jeunesse. Nous y suivions les premiers pas de ce jeune Occitan, futur médecin passionné de littérature, à Montpellier, où il collabora à la revue La Licorne, à Paris, où il publia au Seuil son premier roman, Le plus grand des taureaux, tout en fréquentant Montherlant, Dominique de Roux, Jean-René Huguenin et Michel Déon. Nous l’accompagnions même à Meudon, quand, pris d’un pressentiment, Christian Dedet rendit visite à Céline quelques jours à peine avant sa mort (« le regard peureux », « le ricanement de faune débusqué »).
Entre deux stages de médecine, entre deux bonnes fortunes ou deux récitals de piano (pages lumineuses sur le génial Lipatti), Christian Dedet dressait le portrait d’un fils de famille choyé, d’un rebelle bien élevé - le feu cathare en complet gris.
Aujourd’hui, il nous livre la suite, attendue, de ces mémoires d’un veinard. Le jeune toubib découvre les joies du service militaire, à Perpignan au 11ème Choc, en lisant Drieu et Montherlant. Bien que publié dans une maison classée à gauche, le romancier semble davantage trouver son miel au sein de la droite « buissonnière » – pour citer le regretté Pol Vandromme, l’un des premiers critiques à avoir fait amitié avec lui, et avec quelle générosité, comme en témoignent ces lignes : « Nous ne sommes pas beaucoup à penser ce que nous pensons, à sentir ce que nous sentons ; il faudrait que notre amitié s’affirmât davantage. Nous avons besoin de nous sentir entourés dans un monde où la bêtise et la bassesse me désespèrent un peu plus chaque jour. »
Notre Languedocien se sent plus proche d’impertinents tels que Dominique de Roux, Gabriel Matzneff ou Jacques d’Arribehaude que des bonzes de Tel Quel, ces « théoriciens du vide », dont il repère tout de suite les tendances inquisitoriales. Nourri de Rabelais comme de Sénèque, Dedet se révèle moraliste au détour de plus d’une page de ce précieux Journal : « ne pas vouloir disparaître avec ce qui disparaît ; ni se sentir trop coupable en acceptant ce qui naît ». En quelques mots, un type d’homme se trouve dépeint. Un moraliste proche des Romains, un peu sec donc, mais avec cette touche de sybaritisme méditerranéen. Un égotiste élégant, en même temps profond, car lucide et adepte de la posture tragique : point de refuge en Dieu chez lui, mais une sorte de paganisme romantique et hautain.
Pour un cadet, la lecture de ce Journal a parfois un arrière-goût amer : les lettres d’éditeurs, l’attention des critiques, les visites aux confrères, les voyages qui dépaysent, l’infinité des possibles, bref : l’abondance et le rêve, aujourd’hui révolus…
Parmi les portraits d’écrivains, je retiendrai ceux de Roland Cailleux, le dandy dépressif ; de Jean-René Huguenin, son « air invincible et meurtri » ; et Delteil, et encore Vandromme, le généreux Vandromme, qui lui écrit cette phrase essentielle, d’une telle justesse : « Les livres que nous écrivons doivent nous être donnés de surcroît – en récompense de la fantaisie de notre paresse et de notre humeur vagabonde. »
Outre l’amusante faune des villes thermales (où officie cinq mois par an le bon docteur Dedet), le Journal présente aussi quelques belles jeunes femmes, jusqu’à la rencontre qui change une vie, celle d’une artiste catalane que Christian Dedet n’a plus quittée.
Christopher Gérard
Christian Dedet, L’Abondance et le rêve. Journal 1963-1966, Les Editions de Paris, 408 pages, 18€.
Voir aussi, sur Christian Dedet

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, années 60, christian dedet | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







