24 février 2016
Bonnes nouvelles de Gérard Oberlé

Ripailleur, anarchiste, polyglotte, bibliophile et dipsomane : ce Chassignet que nous décrit Gérard Oberlé se révèle franchement suspect, au point, horresco referens, de se gausser des « histrions de l’erreur galiléenne », du « pilou-pilou théophagique », et de s’afficher, non sans crânerie, comme « un adepte tardif des cultes abolis ». Circonstance aggravante, le bougre cite Pétrone et Rabelais, chante les vins de Bourgogne et, oui, l’oubli, « l’oubli plus doux que le souvenir ».
Puits de science, l’auteur d’Itinéraire spiritueux et des splendides Mémoires de Marc-Antoine Muret récidive ainsi avec ce récit en trois parties, où le lecteur partage la vie d’un humaniste français du XXIème siècle, des rivages du Nil aux paillottes de la Nouvelle-Calédonie, en passant par le Sud profond. C’est à Assouan, dans ce palace Old Cataract que fréquentèrent Agatha Christie et Winston Churchill, que se déroule le récit le plus abouti du recueil : Oberlé décrit avec délices ses amis égyptiens, la faune haute en couleurs des expatriés… Une baronne perdue, un exilé romain, un dandy bostonien, l’inévitable voyou local dansent sous nos yeux une pavane quelque peu surannée, juste assez funèbre, ô combien séduisante. Délicieusement à rebours du siècle jusque dans sa mélancolique gaieté, le styliste entortille son lecteur par d’érudites calembredaines. Gérard Oberlé ? Un baroque égaré, un Païen de la décadence, un Précieux libertin : le petit maître dans toute sa splendeur.
Salve, nobilissime.
Christopher Gérard
Gérard Oberlé, Bonnes nouvelles de Chassignet, Grasset, 212 pages, 17 sesterces.

Voir aussi mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, bourgogne | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18 février 2016
Raskar Kapac

Initiative aussi sympathique que bienvenue en ces temps post-littéraires : un quarteron de jeunes officiers s’unit pour ressusciter l’esprit des brûlots de jadis. On songe à Matulu ou à l’actuel Livr’Arbitres. À Immédiatement, aux Epées… Certes, Raskar Kapac, du nom d’un personnage des aventures de Tintin, ne comporte, pour le moment, que quelques pages, mais la tension y est. La fidélité aussi, puisque cette gazette à l’ancienne se propose d’honorer la mémoire de Jean-René Huguenin (1936-1962), l’auteur de La Côte sauvage, et surtout d’un Journal (1955-1962) qui, par son incandescence, a marqué à jamais tous ceux qui ont eu, jeunes pour les plus chanceux, le bonheur de lire ce moraliste impitoyable qui voulut fonder une aristocratie. Nombre de pages de ce Journal posthume nourrissent le lecteur fraternel, qui ne peut que s’y reconnaître : « Personne pour nous applaudir, presque rien pour nous encourager, et pourtant rester digne, rester un homme d’honneur ».
Tué dans un accident de la route, Huguenin serait sans doute devenu l’un des grands polémistes de sa génération, l’un de ces jeunes capitaines perdus – comme Nimier, qui le rejoignit dans la mort six jours plus tard.
Christian Dedet, écrivain secret de la trempe d’un Guy Dupré ou d’un Jean Forton, livre aux jeunes chouans de Raskar Kapac quelques souvenirs sur l’écrivain foudroyé, qui affirmait que « le génie, c’est d’être soi-même » et qui, par-dessus tout, haïssait la tiédeur. La gazette, dont on attend les prochaines livraisons, publie quelques pages inédites d’Huguenin, celles d’un roman inachevé. Goûtons ce tableau de la Libération : « Elle ne se débattait pas, ne criait même pas, ses yeux maintenant grand ouverts, offerts au ciel d’été avec horreur, avec extase, et la foule autour d’elle était devenue si silencieuse que l’on pouvait entendre le cliquetis de la tondeuse. Eric regardait leurs figures fixes, glacées par l’attention, et il devinait la voluptueuse douleur qu’ils éprouvaient à humilier, non pas cette jeune femme peut-être coupable, mais la race humaine, l’homme, eux-mêmes. »
Christopher Gérard
Raskar Kapac, trois sesterces. En kiosque.
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17 février 2016
Avec Corinne Hoex

Valets de nuit
Trente-trois courtes nouvelles pour cerner les fantasmagories d’une femme qui rêve à ses rencontres avec des hommes singuliers : l’astrologue solennel, le boucher érotomane, le pompiste odorant, le maître-nageur sculptural, l’institueur sadique, l’évêque pris de frénésie partageuse… Entre deux métamorphoses en pieuvre ou en nuage, en côte de bœuf ou en chatte, nous participons, émoustillés et conquis, aux délires sensuels d’une poète. Et quel éloge du corps masculin, mine de rien.
Coquin, le ton du recueil est donné dès l’exergue par cette citation de Labiche : « Mon Dieu ! Comme vous avez un grand lit ! Vous comptez recevoir ? » Non, pas le moindre bâillement dans le lit de cette donzelle dont la prose ciselée avec art nous cajole et nous stimule sans jamais nous endormir. Démonstration au lecteur dubitatif : « Je suis une forêt ténébreuse. J’ai de grands arbres aux racines noires, des taillis profonds et de sombres futaies, des ravines, des broussailles, des orties et des ronces. J’ai des hêtres immenses, des chênes orgueilleux. J’ai des clairières aussi, des trouées d’herbe tendre où la lune pénètre et caresse mes mousses. J’ai des fées, des sorcières, des ogresses, des elfes. J’ai des divinités, des nymphes, des ondines et de charmantes dryades qui paressent mollement parmi les frondaisons. Et j’ai des biches, bien sûr, des renardes, des louves, des fourmis, des libellules… » Alors, heureux ?
Corinne Hoex : une voix qui compte en notre bel aujourd’hui.
Christopher Gérard
Corinne Hoex, Valets de nuit, Les Impressions nouvelles, 160 pages, 14€
*
**
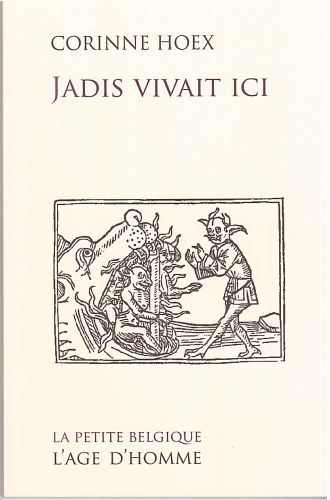
Dans son dernier opus, qu’elle aurait pu intituler Caput, Corinne Hoex, clairement victime d’une crise de céphalophobie aiguë, nous invite à perdre la tête. Décollations apparaît en effet comme une sorte de dérive insolite où l’auteur s’amuse au rythme de variations loufoques et pleines d’une juvénile fantaisie à jouer avec l’idée de décapitation. Macabre ? Nullement, tant Corine Hoex, en virtuose de la langue (qu’elle n’a pas dans sa poche), excelle dans l’art de l’improvisation, à l’instar de ces stars du jazz - car c’est au jazz que fait songer Décollations :une jam session. Tout part de l’idée d’une femme acéphale, qui n’a donc plus - si elle l’a jamais eue - la tête sur les épaules. Oubliés, par conséquent, les migraines, les dentistes et les coiffeurs. Plus rien ne lui reste en travers de la gorge à cette tête de linotte. Ni portugaises ensablées, ni chaudes larmes. Et quels prestigieux précédents : le philosophe Boèce (et non Boège, Corinne : où aviez-vous donc la tête ? Que l’on coupe celle du directeur de collection !), S.A.R. Marie-Antoinette, la citoyenne Charlotte Corday, et tant de saints ? Tour à tour coquine (privée de tête-bêche), érudite (elle en a du plomb dans la cervelle !), Corinne Hoex désarçonne avec maestria, manie l’implicite et le jeu de mots, usant d’une riche palette de vocabulaire et d’allusions, non sans crâner, pour le plus grand plaisir du lecteur, qui opine du chef.
Christopher Gérard
Corinne Hoex, Décollations, L’Age d’Homme, 90 pages, 14€.
Dans le même registre, voir Ma Deuxième langue, Les feuillets de corde, 2€
Il est question de Corinne Hoex dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20 janvier 2016
Marina Tsvetaeva

Orel i Arkhangel
Orel i Arkhangel, Gospoden’ prom ! : « Aigle ou archange, Tonnerre du Seigneur ! ». Poésie de Russie (1912-1920) et Poésie de maturité (1921-1941) rassemblent en un joli coffret l’édition bilingue de l’œuvre lyrique intégrale, 1170 poèmes (dont bien des inédits), du météore que fut Marina Tsvetaeva (1892-1941). Deux magnifiques volumes pour saluer l’une des grandes voix de la poésie russe, qui se fit remarquer dès l’âge de dix-huit ans dans le Moscou d’avant 14, celui de la fin du Siècle d’Argent. Toute sa vie durant, Marina Tsvetaeva brûla de passion amoureuse ou poétique, « sur le fil du rasoir ou au bord de l’abîme ». Du Moscou des tsars à la terreur bolchevique, de l’exil parisien au retour en URSS, où elle se pendit de désespoir, la poétesse illustre par ses vers le basculement de la Vieille Russie, le déferlement de la barbarie moderne et la résistance de l’artiste. Ovide russe (dixit le grand slavisant Georges Nivat), elle déploya une puissance littéraire qui laisse pantois tant nous emporte ce tourbillon, excellemment traduit par Véronique Lossky, dont il faut saluer la talentueuse probité. Ses hommages à l’Armée blanche évoquent Chénier : « Garde blanche, ton destin est sublime (…) De l’ancien monde le dernier rêve : Jeunesse. Courage. Vendée. Le Don. » Comment ne pas être aussi bouleversé par son salut à la Tchécoslovaquie envahie : « Brebis soumises et tous – moutons, Esclaves d’Hitler, avec Staline marchez ! » Ou par ce poème de janvier 1940, peu avant son suicide : « Tu étais ma blanche neige, Tu étais mon bon pain, Noire – la neige ! Sec mon pain ! »
Christopher Gérard
Marina Tsvetaeva, Poésie lyrique complète, version bilingue, 2 volumes, Editions des Syrtes, 928 et 832 pages, 40€
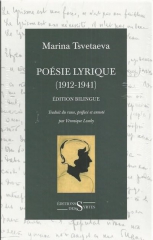
Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18 janvier 2016
Morphine monojet, ou le retour de Thierry Marignac
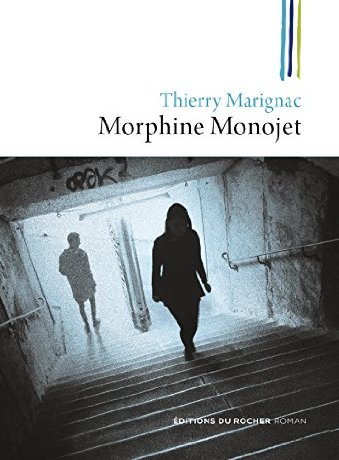
A la fin de Fasciste, livre-talisman, Thierry Marignac cède la parole à l’un de ces enfants perdus au crépuscule qui hantent son roman : « Je suis un décadent au fond, prêt à renoncer à l’ambition et au reste pour me gorger de plaisirs. Mais aujourd’hui, choisir les plaisirs, c’est choisir la mort ».
Morphine monojet illustre à merveille cette sentence en ce sens que ce roman déjanté et cruel, d’une drôlerie certaine, met en scène un quatuor composé, pour faire simple, de trois mousquetaires et d’une milady au chien d’enfer, lasse et presque belle : à ses basques, trois fils perdus – c’est le sous-titre du roman – en quête non d’un Graal de Bretagne mais d’une héroïne de Thaïlande ou de Turquie, coupée à l’infini, trafiquée dans de minuscules paquets qui s’échangent dans les bouges de Belleville. Il s’agit bien de cette diabolique « fringale de jouissance et d’anesthésiant aux entrailles de l’époque », qui se danse sur des airs vénéneux.
Nous sommes dans le Paris de 1979, qui est encore celui du « monde d’avant » comme dirait le confrère Jérôme Leroy, un Paris d’avant les bobos et les salafistes - un autre siècle. Un ashkénaze suicidaire, un fils perdu vaguement arménien (donc commis aux négociations) et Fernand, le Gaulois de la bande, bâtard sans famille, composent le trio des toxicos, obsédés par le brown sugar qu’ils s’injectent en faisant fi du plus élémentaire principe de précaution. Trois épaves en manque, qui tombent sur Jackie, fille d’une sorte d’espion britanique et d’une princesse d’Oman - qui, elle, joue avec la drogue et s’en sortira. Le vol, dans le somptueux appartement d’icelle, par l’un des futurs trimards, d’une seringue intacte datant de la guerre (celle de Dunkerque - Omaha Beach) emplie de morphine pure, lance tout ce petit monde dans une course poursuite absurde, quasi picaresque. Thierry Marignac s’amuse, et nous aussi, dans ce city movie enlevé, rapide - du nerf, de la gouaille sans chiqué, pas une once de gras. Hymne à la nuit, éloge tout en pudeur de l’amitié, requiem de l’Amour, Morphine monojet nous confirme que l’auteur de polars aussi originaux que Milieu hostile et Renegade Boxing Club a, de haute lutte, conquis sa place d’orfèvre par la grâce d’une langue drue et d’un œil de lynx.
Christopher Gérard
Thierry Marignac, Morphine monojet, ou Les Fils perdus, Le Rocher, 15,90€
Lire aussi, du même, Fasciste (Hélios noir), Renegade Boxing Club (Série noire) et Milieu hostile (Baleine).
Thierry Marignac, sur le confrère C.G. - éloge funèbre :
http://antifixion.blogspot.be/2013/11/christopher-gerard-heretique-du-moyen.html
Je dis encore plus de mal de Thierry dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature russe, héroïne | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







