29 décembre 2015
Compagnons d'aventure
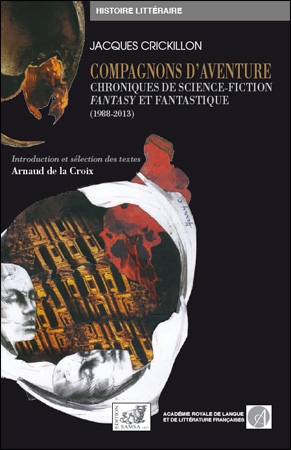
Romaniste ayant marqué des générations de lycéens et d’étudiants du Conservatoire royal de Bruxelles, Jacques Crickillon (1940) est l’une des voix majeures des lettres belges. Voyageur passionné de mythes, poète exigeant, prosateur inclassable (donc intéressant), il a aussi mené une carrière de critique littéraire passionné dont les avis parfois tranchés étaient attendus avec inquiétude par les impétrants comme par les vieux briscards.
Indifférent au qu’en dira-t-on, rétif aux conformismes des gens de lettres, l’homme s’est intéressé, aussi, aux littératures dites de marge, de genre, voire aux paralittératures. C’est précisément ce qu’illustre le joli volume concocté pour l’Académie royale par Arnaud de la Croix, le spécialiste des livres maudits. De 1988 à 2013, Jacques Crickillon a rédigé pour la revue belge des bibliothécaires des notes de lecture d’une rare liberté d’esprit et de ton. Aujourd’hui, c’est un recueil de ces chroniques qui paraît sous une élégante jaquette, toutes consacrées à la science-fiction, à la fantasy et au fantastique.
Science-fiction ? Par les mânes de Sainte Beuve ! Prévoyant les moues crispées des uns et des autres, le poète et critique met d’emblée les point sur les i : « ce genre méprisé par les peigne-culs de la pseudo-culture véhicule depuis plus d’un demi-siècle les seules interrogations qui comptent, celles de la morale et de la métaphysique ». Pour Jacques Crickillon, toute forme de paresse et de refus de l’imaginaire est à bannir. A bon lecteur, salut.
Van Vogt, l’immense Dick, le très-subversif Spinrad, Ballard et Zelazny font l’objet d’éloges mémorables. De même, les maîtres du fantastique, les Belges Owen, Prévot, le trop méconnu, et Muno, sont à juste titre encensés. Et Tolkien, et Lovecraft, et Machen, et Dunsany…
Ewers et Kubin ne sont pas oubliés, ce qui en dit long sur le goût et la science du critique !
Christopher Gérard
Jacques Crickillon, Compagnons d’aventure. Chroniques de science-fiction, de fantasy et de fantastique (1988-2013), SAMSA-Académie royale, 276 pages, 22€
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature, fantastique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12 mai 2014
Avec Jean-Baptiste Baronian

L’Ecole belge de l’étrange
Paradoxal Jean-Baptiste Baronian ! Ce fils d’exilé arménien, né à Anvers et installé tout jeune à Bruxelles, s’est rapidement révélé, dès les années 70, comme l’un des plus fins connaisseurs de ce qu’il a justement appelé l’école belge de l’étrange. Il a donc fallu à la Belgique littéraire un outsider complet, lui-même éditeur et écrivain, pour révéler l’une de ses plus étonnantes facettes, car le fantastique et le réalisme magique, très présents chez les écrivains belges, constituent l’un des fondements - sans rien de marginal - de leur paysage mental. C’est le sujet d’une lecture publique qu’il a donnée à l’Académie royale, et qu’il reprend dans une synthèse bienvenue.
Depuis La Jeune Belgique au moins, depuis les années 1880, les « fantastiqueurs », comme disait Théophile Gautier, sont légion dans la Patrie des Arts et de la Pensée. En témoignent nombre d’œuvres de Ghelderode et de Jean Ray, de Gérard Prévot et de Franz Hellens, et plus près de nous d’Anne Richter et de Jean Muno, voire de Bernard Quiriny et de l’auteur de ces lignes. Dans sa causerie, Baronian repère les influences du symbolisme (Bruges-la-Morte !) et du naturalisme expressionniste sur les auteurs fantastiques d’hier et d’aujourd’hui. De même, la double culture latine et germanique a joué un rôle dans l’éclosion d’une sensibilité sans rien de régionaliste.
Baronian qualifie à juste titre ces écrivains d’insurgés : « des francs-tireurs, des rebelles, des frondeurs … n’acceptant pas la pesante tyrannie du réel ». Longtemps ignoré des faux puristes et des « petits profs de français dénués de discernement » (dont quelques académiciens que Baronian égratigne au passage… au sein même de leur compagnie), le fantastique a reçu sa légitimation littéraire d’en bas, des vrais lecteurs et non des machines à lire. Faut-il dire et répéter que le seul adoubement qui compte est celui des passionnés, des amateurs, au contraire de l’indulgence trafiquée des tâcherons, stérilisés par les dogmes ?
Christopher Gérard
Jean-Baptiste Baronian, La Littérature fantastique belge. Une affaire d’insurgés, Académie royale de Belgique, 64 pages, 5€
*
Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,
aux éditions L’Age d’Homme
http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0
Entretien
Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre itinéraire?
J’ai toujours eu du mal à me définir, à m’analyser, à admettre que je serais peut-être ceci ou peut-être cela. Sans éluder la question, je songe à ce que dit Valery Larbaud, une des principales figures de mon panthéon. À ses yeux, l’essentiel de la biographie d’un écrivain consiste dans l’histoire de ses livres et de ses lectures. Mon histoire à moi, mon itinéraire, c’est donc tout ce que j’ai publié depuis le début des années 1970 jusqu’à ce jour : plus de soixante livres, des dizaines de préface, des milliers d’articles… Et c’est également toute ma bibliothèque dont mon entourage prétend qu’elle est des plus imposantes. Mais ce sont aussi mes disques qui sont innombrables, presque tous des disques de musique dite classique et de musique dite contemporaine, mes dilections couvrant un spectre très large, de Bach à Kagel, en passant par Beethoven, Verdi, Brahms, Debussy, Strauss, Britten ou Chostakovitch.
Quelles ont été pour vous les lectures qui vous ont le plus durablement marqué ?
Il y a en plusieurs. La première, c’est sans conteste L’Ile au trésor de Stevenson que je considère comme un des plus beaux romans jamais écrits, peut-être même, du point de vue formel, comme le roman le plus parfait. Je l’ai lu et relu plus de dix fois, et chaque nouvelle lecture m’a conforté dans mon enthousiasme. Je vous citerai ensuite les romans de Dostoïevski et de Faulkner ainsi que les nouvelles de Poe, de Kipling et de Borges… Et puis, dans le désordre, Le Capitaine Fracasse de Gautier, Madame Bovary de Flaubert, l’admirable Dominique de Fromentin, les Histoires désobligeantes de Bloy, Fermina Marquez de Larbaud… Je n’oublie pas non plus Chesterton, Céline, Bernanos, Morand, Greene et Guérin. Ni, bien sûr, Simenon que je relis sans cesse et dont chaque livre constitue une prodigieuse et perpétuelle redécouverte. Ni James Cain, Horace McCoy, David Goodis et Charles Williams dans le vaste domaine de la littérature policière… Je reste aussi « durablement » marqué par des poètes : Villon, Baudelaire Verlaine, pour moi le plus grand poète français, Apollinaire, Elskamp, Fargue que j’adore, Pessoa, Thiry, Follain… Bon Dieu, tous ces noms que j’évoque me donnent le tournis !
Les grandes rencontres?
Je vais me contenter de ne citer ici que trois personnes : un artiste, un écrivain et un libraire. L’artiste, c’est le peintre abstrait Jo Delahaut dont la rigueur intellectuelle m’a toujours fasciné, un homme ouvert à tout, à toutes les formes de la création, à toutes les aventures de l’esprit. L’écrivain, c’est Jean Muno. J’ai fait sa connaissance vers les années 1973 ou 1974, alors que je travaillais à mon anthologie La Belgique fantastique. J’avais lu dans des revues quelques-uns de ses nouvelles et je m’étais tout de suite rendu compte qu’elles avaient un ton différent, qu’elles étaient pour ainsi dire subversives, ne serait-ce que par rapport à celles, plus classiques, de Thomas Owen. Malgré notre différence d’âge, nous sommes rapidement devenus des amis – je préciserais des amis rares par notre métier. Ensemble, nous parlions surtout des problèmes inhérents à la création romanesque : comment mettre en scène un personnage, comment développer un chapitre, comment équilibrer la structure d’une histoire, bref tout simplement comment écrire, et le faire chaque jour… La disparition brutale de Jean Muno en 1988 m’a laissé littérairement orphelin… Quant au libraire, il se prénomme André, un Flamand pétri de culture française. Il travaillait à la librairie Corman à Knokke lorsque je n’étais encore qu’un jeune homme. Il m’a initié à toute une série d’auteurs dont on ne m’avait jamais parlé au collège et dont on ne trouvait pas à l’époque les œuvres dans les collections de poche : Gracq, Borges, Calet… Je lui dois beaucoup, beaucoup d’émotions littéraires. Je lui ai d’ailleurs rendu hommage dans mon discours de réception de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.
D'où vous est venue cette passion - car vous êtes un homme de passions, n'est-ce pas? - pour le roman policier?
Je n’ai pas une réponse toute faite à cette question. Je sais que j’ai le goût du mystère et de l’étrange, que j’aime les histoires énigmatiques, celles qui tiennent en haleine et vous incitent à tourner les pages, sans presque jamais lever les yeux. En un mot, j’aime le suspense, et même dans des romans qui ne reposent pas sur une intrigue criminelle. En réalité, je suis extrêmement sensible à la construction d’un roman et je dois reconnaître que les auteurs de policiers sont d’ordinaire de très habiles architectes et de formidables meneurs de jeu. Voyez Agatha Christie, sa mécanique est prodigieuse… Sans compter qu’elle a du style et qu’elle manie l’ironie avec brio. C’est ce qui explique en grande partie pourquoi elle échappe au purgatoire des lettres… Et puis ce que j’aime dans le roman policier, c’est qu’il sacralise d’emblée et sans détours des tensions, des crises, des situations tragiques ou violentes, souvent jusqu’au paroxysme. C’est particulièrement le cas dans les romans noirs anglo-saxons, par exemple aujourd’hui chez des auteurs comme Dennis Lehane, Ken Bruen, Michael Connelly ou Daniel Woodrell.
Passion que vous illustre aujourd'hui avec Le Bureau des Risques et Périls, du nom de cette mystérieuse officine dépendant directement, si mes informations sont exactes, du Premier Ministre. Roman d'une conjuration, pastiche de crime parfait, version quelque peu subversive du Cluedo … Mais qu'est-ce que ce livre en fin de compte?
Qu’est-ce que ce livre ? Peut-être un OLNI. Entendez : un objet littéraire non identifié. Il ressortit à la fois au roman d’énigme, au vaudeville, à la parodie, au jeu de rôles, au roman humoristique, à la parabole genre Chesterton, au roman unanimiste puisque aussi bien aucun des personnages mis en scène n’en est réellement le héros… Je ne vous cache pas que j’ai éprouvé du plaisir à l’écrire, mais sans trop savoir si ce plaisir serait partagé ou non. On est toujours seul et égoïste quand on écrit – seul et égoïste avec ses idées, y compris ses idées fixes, avec sa façon de voir et de concevoir son livre.
Vous y maniez un humour noir, fataliste même…
Je vais enfoncer une porte ouverte : l’humour n’est jamais rose, il est toujours noir et fataliste, quand bien même il se dissimulerait derrière de jolis sourires enjôleurs et des pitreries. En quoi sans doute mon Bureau des Risques et Périls n’est pas seulement, je crois, un simple entertainment, mais aussi une charge contre un certain modus vivendi dans le monde actuel. Mais je m’empresse d’ajouter que je ne suis pas pour autant un donneur de leçons, et encore moins un moraliste. Mon humour noir, au fond, il est naturel, ou presque. C’est à peine si dans mon livre, j’accentue les traits de caractère et me moque de mes personnages.
Bruxelles n'est-elle pas l'un des principaux personnages de votre roman?
Vous avez raison, Bruxelles est partout présent dans ce livre. Il l’est du reste dans la très grande majorité des œuvres de fiction que j’ai publiées au point, me semble-t-il, qu’on peut en parler comme un personnage récurrent. Je me demande même si on ne pourrait pas regrouper tous mes romans sous un seul titre générique : Les Mystères de Bruxelles.
Vos projets?
J’en ai plusieurs. Je mets actuellement la dernière main sur un nouveau roman, un roman noir dans la veine un peu sombre de Matricide, de Rase campagne et de L’Apocalypse blanche. Je travaille aussi sur un essai consacré à Verlaine. Après avoir écrit sa biographie et, par la suite, celle de Rimbaud, je me suis rendu compte que le cadre même de la biographie, qui est un genre en soi, m’empêchait de m’attacher à tel ou tel aspect de mon personnage et de faire état de commentaires circonstanciés sur ses œuvres. Ce sera également l’occasion de mettre à bas diverses idées reçues le concernant. La plupart des exégètes de Verlaine prétendent ainsi qu’après Sagesse qui date de 1881, il n’a plus rien produit d’important et que sa poésie s’est desséchée. C’est absurde !
Propos recueillis par Christopher Gérard
Bruxelles, février 2010.
Lire aussi :

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature, belgique, fantastique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28 janvier 2014
Vogelsang ou la mélancolie du vampire : la beauté, l'amour et la mort.
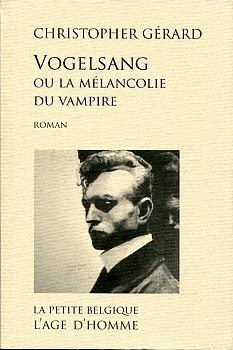
Un prédateur lettré
Pour aborder la littérature fantastique, Christopher Gérard a choisi la difficulté. Il a jeté son dévolu sur un personnage classique, tellement exploité par les auteurs les plus divers que cette créature est devenue pour le lecteur une sorte de monstre familier. Comment, avec un tel sujet, échapper aux poncifs et aux lieux communs ? Notre romancier par ailleurs brillant va-t-il nous faire regretter son audace ou son inconscience ? « Vogelsang est un conte d’amour et de mort », m’écrit Christopher Gérard, dans sa dédicace (1). Mais encore ? Vogelsang, est-ce le souvenir du château du même nom, situé au Nord d’Hasselt, en Belgique, un manoir perdu au milieu d’un bois ? Ou serait-ce le chant des oiseaux ? Vogel et Sang : traduits du néerlandais ? Quoi qu’il en soit, on s’aperçoit vite que Christopher Gérard a réussi une gageure, que son roman requiert une attention spéciale, car il est tissé d’un réseau de liens secrets, de références littéraires singulières, en sorte que le lecteur va de surprise en surprise, il passe d’un étonnement à l’autre.
Au départ, l’idée de Christopher Gérard est aussi simple qu’astucieuse : dès le début de son histoire, il dédramatise la littérature vampirique en l’actualisant à l’extrême. De la sorte, il parvient à renouveler un genre littéraire usé jusqu’à la corde . Laissant courir à sa guise une imagination subversive, l’auteur poursuit avec ironie et élégance un récit ludique qui se déploie dans un décor étonnant : Le modernisme high tech de la résidence du vampire fait en effet penser davantage aux hôtels de luxe de James Bond plutôt qu’au sombre repaire montagnard, choisi par Bram Stoker pour son Dracula. Ceci dit, les lecteurs pressés, avides de sensations fortes, seront servis : tous les ingrédients de l’histoire traditionnelle de vampire sont conservés ; il y a en abondance, du sang, de la violence et des crimes. Mais les lecteurs plus subtils n’en resteront pas là, car ce roman possède un double fond, ou pour prendre une image plus concrète, c’est un roman à tiroirs. Sous le récit d’horreur, on trouve un roman historique. Christopher Gérard a le goût du panache, des grandes fresques épiques, des personnages, des lieux, des événements prestigieux : on apprend donc que Laszlo Vogelsang a 240 ans, qu’il a connu Le Paris de Louis-Philippe, La Vienne impériale, Moscou, à l’époque des Tsars… Comme tous les êtres de sa race, ce vampire est en effet soumis à de longues périodes de dormition, il possède d’innombrables souvenirs, il est sujet à d’irrépressibles et profondes nostalgies, notamment celle de la culture raffinée qu’il a connue autrefois à Paris, à Vienne, à Moscou, une culture qui a sombré dans l’oubli le plus profond, en ce Bruxelles du vingt et unième siècle où il est forcé, bon gré mal gré, de vivre et de poursuivre sa carrière de prédateur lettré.
La mélancolie et la musique
Ces nostalgies de Vogelsang nous amènent à découvrir le contenu du second tiroir du livre où se cache le récit le plus précieux, celui, à vrai dire, que je préfère, car j’ai longtemps fréquenté la littérature romantique allemande. Or, on ne peut s’y méprendre, le souffle lyrique et dramatique qui soulève la seconde partie de ce roman est bien celui du romantisme allemand, ce grand tumulte du Sturm und Drang, cette tempête poétique qui donna naissance à un des plus splendides mouvements littéraires qu’ait connu l’Europe. Christopher Gérard, en romancier prévenant, a parsemé son histoire d’indices révélateurs, pour que le lecteur attentif reconnaisse la route dangereuse qu’il va lui faire prendre. Dans cette seconde partie du roman, plus question d’ironie et de divertissement. Le ton change, se fait plus confidentiel, plus intime, parsemé de citations littéraires très révélatrices.
L’auteur poursuit la quête intérieure de son héros. Et c’est ici que se déploient la musique et la mélancolie, deux thèmes omniprésents dans Vogelsang : ils sont aussi les sources mêmes du romantisme, mais encore une fois, il faut saisir le sens profond que l’auteur donne aux mots . En parlant de mélancolie, il ne décrit pas cette dépression ordinaire dont souffrent tant de nos contemporains, victimes consentantes d’une société de consommation effrénée, mais bien cette vague de tristesse étrange que Goethe appela la « maladie noire de l’âme », ce dégoût de vivre qui s’empara, en Europe et outre-Atlantique, de tout le XIXe siècle littéraire, et qui se confondit avec une quête existentielle : tant de génies connurent ce soleil noir de l’esprit. En Allemagne, Goethe, Novalis, Brentano, Hoffmann, Eichendorff…En France, Chateaubriand et Baudelaire, Lamartine et Musset, Rousseau et Nerval, pour ne citer que ceux-là. A la même époque, en Amérique, Poe écrivait : « La mélancolie est le plus légitime de tous les tons poétiques ».
Oui,Vogelsang appartient bien à cette famille-là : et pour mieux nous en convaincre, Christopher a fait de lui un mélomane, la musique étant l’autre thème qui habite tout le romantisme, surtout le romantisme allemand qui fit du roman musical son apothéose : je pense notamment à l’œuvre d’un des plus grands, Hoffmann qui fut compositeur et chef d’orchestre à Bamberg. Replacé dans ce contexte familier, le livre de Christopher Gérard apparaît, lui aussi, comme un de ces romans musicaux, la musique révélant le sens occulte de cette histoire à double fond, dévoilant au lecteur les aspirations secrètes et l’identité cachée de ce vampire extraordinaire. Car Laszlo le délicat aime Bach et Scarlatti par-dessus tout, il les chante pour lui à ses moments perdus, il les joue au piano presque tous les soirs , dans la solitude de sa demeure, le piano l’aidant, « à voguer sur les flots du temps qui tout dévore… »
Et c’est ainsi qu’opère le pouvoir cathartique de l’art, cette musique merveilleuse donnant à une aventure aux débuts sanglants une dimension poétique et intemporelle. Laszlo est littéralement transformé par le piano « qui lui fait découvrir l’humanité ». Il arrive un moment où le docteur Vogelsang n’a plus soif de sang mais bien de compassion et de tendresse. On apprend, in fine, qu’il est passionnément épris d’une femme et qu’il est en outre fils d’un homme, d’où sa sensibilité esthétique, sa vulnérabilité et sa mystérieuse nostalgie. Si nous relisons dans cet esprit le livre, nous découvrons, dès les premières pages, l’amorce du thème musical. Comment débute en effet cette première partie sanglante du récit ? De façon très inattendue, par l’évocation du chant des oiseaux.
Désirer, déchirer
La musique qui s’inscrit d’abord légèrement dans le début de la narration va se développer peu à peu, s’amplifier à travers le roman, pour finalement occuper la place centrale, mais entre ces intermèdes mélodieux, Vogelsang rode dans la nuit, cherchant ses terrains de chasse dans les endroits les plus glauques de la bonne ville de Bruxelles : un ancien bar à filles de la rue du Pépin, à la Porte de Namur, les alentours de la Barrière de Saint-Gilles, la route d’Anvers ou les environs de la Gare du Midi…Dans cette histoire pleine de bruit, de fureur et d’accents célestes, les extrêmes se rejoignent : la violence et la barbarie le disputent à une tendresse rêveuse et comme désincarnée. La férocité la plus sordide côtoie constamment le sublime, dans une proximité étonnante qu’on retrouve dans l’oeuvre d’un grand romantique allemand auquel Christopher Gérard fait plusieurs fois référence. C’est Heinrich von Kleist. Or, toute l’œuvre de Kleist, comme Vogelsang, est placée sous le signe d’une mystérieuse complicité entre la beauté, l’amour et la mort. Les références faites à Kleist dans le livre de Christopher Gérard, sont des clés qui éclairent le sens véritable du drame. Ainsi, la femme aimée par le vampire s’appelle Penthésilée ; dans le drame éponyme de Kleist, Penthésilée est l’héroïne, une guerrière foudroyée par l’amour, c’est la Reine des Amazones, et pour insister sur ces ressemblances, la Penthésilée de Christopher cite elle-même un extrait du drame de Kleist, une réflexion cruelle et lucide:« Désirer…Déchirer » dit-elle. « Cela rime. Qui aime d’amour songe à l’un et fait l’autre. » Terrible logique de la passion. Autrement et moins bien dit : qui aime blesse et même tue sans le vouloir.
J’ouvre ici une parenthèse, en rappelant que la réalité a rejoint la fiction, dans la vie et l’œuvre de Kleist : comme pour signer son œuvre de son propre sang, l’écrivain s’est donné la mort, en compagnie de sa fiancée, sur les bords du lac Wannsee, à Berlin. On trouve des traces de ce comportement suicidaire chez Vogelsang dont les tristes amours finissent dans un bain de sang mais pour terminer en beauté, je voudrais citer, en écho à cette réflexion de Kleist, un passage du discours de Phèdre, dans Le Banquet de Platon. Pourquoi Platon et pourquoi Phèdre ? C’est que durant une nuit d’insomnie, Vogelsang, alias Christopher Gérard, lit Le Banquet de Platon et voici les commentaires du romancier : je crois qu’avec ces paroles-là, nous atteignons le cœur de son livre et même le cœur de la problématique humaine.
« De la dague à poignée d’argent que m’offrit jadis un prince au visage oublié, je coupe les pages jaunies, toutes craquelées, pour me plonger dans ce texte que j’entends encore me lire la voix mélodieuse de ma mère : Eros, une grande et merveilleuse divinité pour les hommes comme pour les Dieux », déclare Phèdre dans son discours. Et pour nous, Seigneurs, qui n’appartenons ni à l’une ni à l’autre de ces races ? Nous qui tenons les hommes pour nos inférieurs, qui nous interdisons de les fréquenter – sans doute parce qu’ils nous ressemblent trop - et qui vivons cachés parmi eux comme d’insatiables sangsues ?
Phèdre poursuit : Mourir pour autrui, ceux-là seuls le veulent, qui aiment. Cette phrase prononcée il y a vingt-cinq siècles me serre le cœur. Nous qui ne quittons nos repaires que pour semer la mort funeste, éprouvons-nous quelque chose qui ressemble à l’enlaçant amour ? Aimons-nous ? Pour qui accepterions-nous de mourir ? »
Ainsi se termine Vogelsang ou la nostalgie du vampire, cette œuvre singulière qui commence comme un divertissement élégant et se termine en roman initiatique, dans la tradition du héros ténébreux à la recherche de lui-même.
Ainsi va Christopher Gérard, de Bram Stoker à Platon.
Anne RICHTER
(1) Christopher Gérard, Vogelsang ou la mélancolie du vampire, collection La Petite Belgique, L’Age d’Homme, Lausanne 2012
Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, vogelsang, littérature belge, fantastique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16 juillet 2012
Avec Anne Richter
D’Anne Richter, qui a publié son premier livre à quinze ans, Vladimir Dimitrijevic, le directeur des éditions L’Age d’Homme, disait justement : « Vous habitez tout ce que vous écrivez ». Outre des essais littéraires sur Simenon et Milosz, des anthologies et des essais sur le fantastique féminin, Anne Richter a aussi publié des recueils de nouvelles, comme L’Ange hurleur, Le Chat Lucian, et, le dernier en date, La Promenade du Grand Canal, textes élaborés avec soin et dont le point commun semble bien « une adhésion au mystère qu’il faut essayer de décrypter sans le déflorer ».
La Promenade du Grand Canal se compose de neuf nouvelles, ancrées dans le rassurant quotidien de Bruxelles, et qui se rattachent au genre du réalisme fantastique. Nulle rencontre avec des créatures d’outre-monde comme chez Lovecraft, mais la lente découverte de la réalité extérieure qui reflète l’univers intime des personnages.
Un redoutable agresseur symbolise le profond malaise d’une femme qui peine à trouver son équilibre : c’est une peur de papier qui la poursuit. Dans la première nouvelle « Le feu rouge et les lunettes », la vue atrophiée de Frédéric Salmon (!) révèle la part animale enfouie en chacun de nous. Le regard de chair déficient aiguiserait-il le regard intérieur qui débusque chez l’être humain l’animal-totem qui l’habite ? La rencontre de Frédéric avec la femme-biche, la trouble ambiguïté de leurs relations, développent avec délicatesse un thème naguère traité dans La Truie par Thomas Owen, le maître du fantastique belge.
Dans les textes d’A. Richter, écrivain panthéiste, s’établit un dialogue entre l’âme individuelle et le cosmos : une femme qui rédige un livre sur son enfance est, dans la réalité, confrontée à cette époque par l’intermédiaire d’une étrange fillette. Fine lettrée, l’auteur pratique l’art de la mise en abîme: les affres du couple Mary Godwin, l’un de ses auteurs de prédilection, et de Percy Shelley font office de lointain miroir pour les déceptions amoureuses du narrateur. La peinture, dont elle a révélé ailleurs la magie insoupçonnée, joue également le rôle de fil d’Ariane entre les générations, entre un passé qui refuse d’être oublié et un présent à construire. Un portrait qui retrouve sa place dans une chambre contribue à rétablir l’harmonie dans la vie de la propriétaire des lieux.
Des chemins s’entrecroisent au gré d’un destin qui tisse entre les êtres des liens subtils, parfois facétieux : qui est réellement la femme nimbée de lumière qui attend le sombre Benoît ? Quel amant éveillera-t-il à la plénitude la pétillante Barbara : le trop lisse Dustin ou Thibaut le mélomane, drapé dans ses mensonges ? Margot qui collectionne avec ferveur – délicieuse trouvaille poétique – les « instants subtils », ceux qui ont l’odeur et la couleur des souvenirs d’autrui, trouvera la sérénité dans son propre instant présent, celui chanté par le sage Horace. L’accomplissement des destinées passe par des chemins étranges sur lesquels nous entraîne la langue fluide et raffinée de l’auteur. Si le vocabulaire, particulier à chaque nouvelle, lui confère son atmosphère unique, l’ensemble forme un chatoyant caléidoscope qui invite le lecteur à explorer les mille facettes du monde qui l’entoure.
Christopher Gérard
Anne Richter, La Promenade du Grand Canal, L’Age d’Homme, 110 pages, 15 €
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : anne richter, littérature, fantastique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







