23 août 2019
Avec Pierre Mari
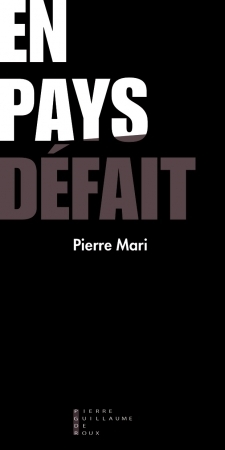
Le titre, En Pays défait, annonce la couleur : l’auteur, Pierre Mari (1956), auteur d’essais sur Rabelais et Kleist, mais aussi de romans, ne donnera ni dans le consensus mou ni dans le tiède acquiescement. La collection où il publie sa charge contre les mandarins d’aujourd’hui abrite quelques brûlots (les zélotes de Sartre & Foucault en prennent pour leur grade) ; son éditeur, le cher Pierre-Guillaume de Roux, s’inspire sans se cacher le moins du monde de ces précieux volumes allongés de couleur brune (Libertés 49, dirigée par Jean-François Revel) que Jean-Jacques Pauvert éditait dans les années 60 et où l’on retrouvait Berl et Papaïoannou, d’Holbach et Barbey. En cherchant bien chez les bouquinistes survivants, on trouve encore pour quelques euros ces pamphlets d’un autre temps.
Mari, lui, est bien du nôtre, de temps, qu’il qualifie, dans une langue toute classique, de « bagne anthropologiquement inédit » - ce qui est bien vu, puisque, naguère encore, « tout le monde n’appartenait pas au même temps ». Les aspects déplaisants de l’époque, de toutes les époques, pouvaient être compensés par la survie de bulles temporelles comme par la possibilité de « faire dialoguer l’ici et l’ailleurs, le jadis et le maintenant ». Cette possibilité, cet échappatoire sont lentement mais sûrement éradiqués, sous nos yeux, avec la complicité active d’élites aussi déconnectées qu’indifférentes : « Je parle de vous tous qui bénéficiez d’une forme ou d’une autre de consécration, et chez qui j’observe la même pathologie, entretenue et même cultivée : l’incapacité de dire les choses comme tout le monde les sent – l’empêchement de sentir juste et fort. Comme si, dès qu’on échappe à l’anonymat, un implacable constat de tiédeur devait être signé avec la machine pourvoyeuse de visibilité. » Docilité et convenance sont de toutes les époques certes, comme l’abaissement moral, mais depuis les années 80, l’universelle démission, la rupture névrotique du lien civilisationnel, l’amnésie forcée sont devenues la règle. Le désarroi, l’accablement de Pierre Mari, qui sont ceux de toute une génération, la mienne, proviennent de notre impuissance à comprendre ce qui nous est arrivé.
Comment ce « morne alignement des têtes » que, naïfs, nous croyions propres aux défunts régimes à parti unique, comment cette insupportable langue de coton (un salut en passant à François-Bernard Huyghe qui, le premier, analysa cette dernière), comment ce déclin du courage civique et ce conformisme hargneux se sont-ils ainsi imposés ? C’est ce mystère, ce désir mortifère de sombrer que le talentueux Pierre Mari dissèque d’un scalpel sûr, sans anesthésie.
Christopher Gérard
Pierre Mari, En Pays défait, Ed. Pierre-Guillaume de Roux, 186 pages, 16€
Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, pamphlet, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24 mai 2019
Luc Dellisse
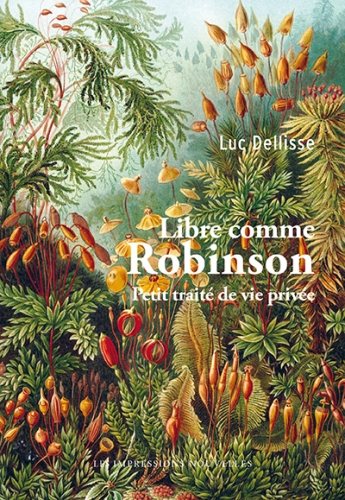
Né à Bruxelles mais naturalisé français, Luc Dellisse est auteur de livres pour la jeunesse, critique littéraire, enseignant (à la Sorbonne, s’il vous plaît), scénariste et poète.
Dans Libre comme Robinson, il nous livre des réflexions bienvenues sur le nouveau monde qui vient, celui de la « ruche planétaire » où disparaît progressivement l’authentique liberté, et sur la manière, bien concrète, de gagner ces maquis qui résistent à la grande mise au pas : « La liberté de mœurs, l’indépendance d’esprit, la maîtrise du langage, la connaissance de l’Histoire, le secret et la discrétion, sont entrés dans un immense laminoir, parfois appelé globalisation ». Il propose quelques dizaines de pistes à tous ceux que ne transporte pas d’enthousiasme la grandissante restriction des libertés réelles... qui s’opère sous nos yeux (fermés) au nom du Bien et de la Vertu. Comment échapper un tant soit peu au contrôle et à la dépossession, au collectivisme et à la massification, à ce « tout-commerce » que constitue la mondialisation ? Comment s’organiser pour ne pas être du voyage ?
Dans un monde radicalement inédit (surpopulation et brassage obligatoire, remplacement numérique et omni-surveillance électronique, épuisement des ressources et marchandisation sans fin,…) comment trouver et protéger cette île déserte où Robinson parvient à être à la fois hors du monde et dans le monde ? Comment trouver son unité dans un monde disloqué, comment résister au désir morbide de transparence et réhabiliter la réserve - au sens strict du terme ? A lire ces réflexions intempestives, je repère aussi chez Luc Dellisse un refus passionné de la dégradation de notre langue, entre autres par le biais de l’écriture inclusive ou de l’aplatissement journalistique.
Christopher Gérard
Luc Dellisse, Libre comme Robinson. Petit traité de vie privée, Les Impressions nouvelles, 17€
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05 avril 2019
Avec Gérard Guégan
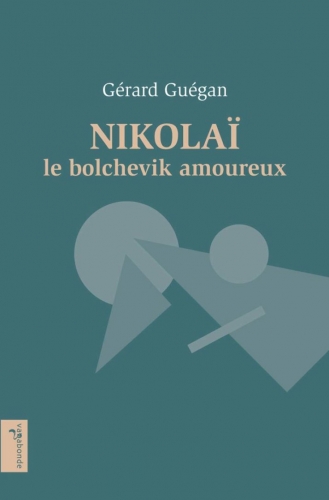
Un bolchevik amoureux ?
C’est le camarade Thierry Marignac qui, lors d’une de nos activités politico-culturelles (Duvel & chinon), m’a tendu ce court roman d’un ancien journaliste des Lettres françaises et même, horresco referens, de L’Humanité, dont j’avais lu naguère la passionnante biographie de Jean Fontenoy, l’auteur de Shangaï secret (1938), écrivain opiomane, ex-cadre du Parti communiste français, engagé volontaire en Finlande contre les Soviets, collaborateur proche de Drieu la Rochelle, qui se suicide dans les ruines de Berlin en mai 1945.
Ce Gérard Guégan semble en effet fasciné par les destins hors norme, comme celui de Drieu justement, à qui il a consacré un bref roman… un tantinet bavard (comme Drieu et son frère Malraux pouvaient l’être à l’époque). Ou comme, aujourd’hui, celui du révolutionnaire professionnel Nicolas Boukharine (1888-1938), chef de l’Internationale communiste, rédacteur en chef de la Pravda et théoricien de ce que les marxistes russes surnommaient diamat – le matérialisme dialectique. Boukharine fut le successeur désigné de Lénine avant de se rallier sans illusion à Staline jusqu’à sa prévisible élimination. Deux ans avant son procès et son exécution, en 1936 donc, Boukharine est envoyé par le Vojd, le Guide, à Paris pour y négocier l’achat aux mencheviks des archives de Marx et d’Engels. C’est ce voyage que Guégan romance avec un doigté et un sens du rythme d’une redoutable efficacité, au point que l’idée m’effleure d’un scénario de film.
Boukharine comprend très bien que Staline, ce félin, joue avec lui et tente de le piéger. S’il émigre, il trahit ; s’il rentre, ce sera comme espion ou comme saboteur… Le bolchevik parvient à faire sortir sa jeune épouse, qui est enceinte – subtile habilité du Vojd, alias le Grand Equarrisseur (lequel fait songer à l’abject tyran de Sur les falaises de marbre, d’Ernst Jünger), qui tend sous les pieds de sa proie le tapis mortel. Dans ses conversations avec Aragon (grotesque, quand il décrète que Dostoïevski « n’est pas réaliste-socialiste »), Malraux, Renoir ou Nizan, Boukharine ruse et feinte. Jusqu’à la pirouette finale, où Guégan se révèle de première force.
Christopher Gérard
Gérard Guégan, Nikolaï, le bolchevik amoureux, Vagabonde, 172 pages, 13.50 €.
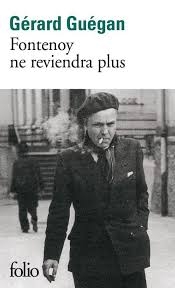
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17 janvier 2019
L'Apocalypse selon Denis Cheynet.
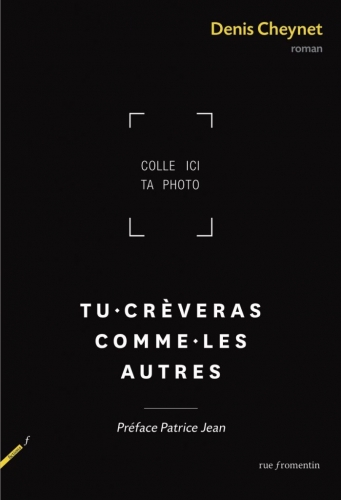
Magistral premier roman, que nous offre Denis Cheynet avec Tu crèveras comme les autres, sous la casaque noire des éditions rue Fromentin et avec une éclairante préface de Patrice Jean, auteur de la maison*, qui parle à bon droit de « grand roman sur les impasses technologiques et philosophiques du monde moderne ».
Le coup de génie réside dans l’usage quasi hypnotique de la deuxième personne du singulier, comme dans les Dix Commandements, qui donne au roman cet air incantatoire et prophétique, mais aussi de l’indicatif - mode de la réalité - futur simple. Le romancier vaticine ; il décrit ce qui adviendra : la terrifiante descente aux Enfers d’un cadre moyen de la région parisienne, et en fait de toute une civilisation, happés par l’effondrement subit du monde techno-marchand.
En quelques mois à peine, le petit-bourgeois post-moderne, insignifiant rouage d’une firme d’informatique (l’un de ces nouveaux métiers auxquels les diplodocus de mon âge ne comprennent rien), gavé de séries politiquement correctes et de week-ends cucul-la-praline, se trouve projeté dans l’univers nettement moins policé de The Road : finis l’appartement propret doté de l’écran extra-plat, le zoning industriel et sa cantine bio, le bolide de fonction et les cartes en plastique ! Place au struggle for life le plus féroce, décrit avec une minutie quasi sadique, non sans une once d’humour noir soigneusement celée (le ton macronien du Président qui, alors que tout flambe, en appelle encore, avant de prendre la fuite, à « aider tous les citoyens du monde »).
Tu crèveras comme les autres est bien un conte philosophique, en ce sens que l’auteur force son lecteur à prendre conscience de l’insondable vacuité, de l’égoïsme obscène et de la terrifiante dépendance de l’Occidental, soumis à son smarfaune, asservi par l’usure, crétinisé par d’ineptes obligations professionnelles : « Le travail t’absorbera au début de la semaine, te malaxera et te digérera pour te rejeter comme un excrément le vendredi soir ».
Au fil des pages, le lecteur passe ainsi d’une barbarie l’autre, tiède et aseptisée quand « tout va bien », fétide et glaçante quand tout se dérègle. Car tout part en fumée, et vite : firmes, magasins, approvisionnements, hôpitaux et pompiers, blocages mentaux en tout genre… puisque le ci-devant cadre finira, comme les autres, par se repaître de chair humaine. Clinique, la description de cette descente, qui est aussi une sorte de libération, est servie par un style d’une précision parfaite – pas un mot de trop. « Après avoir essayé de rivaliser avec les astres, les hommes seront désormais aveugles et trembleront de peur », « les défenseurs des droits de l’homme dépèceront des criminels afin de se nourrir de leur chair » : tel est le cruel destin de ces derniers hommes qui, malgré de pitoyables tentatives de résistance (sectes millénaristes, milices hollywoodiennes, sororités féministes, et tutti quanti), sombrent dans la guerre de tous contre chacun.
D’hommes, ils sont devenus moins que des chiens – « un instant insignifiant dans l’immensité du temps, un fragment de matière organique minuscule dans l’immensité de l’univers ».
Une apocalypse au sens premier de révélation – d’un écrivain de race comme d’une vision d’ampleur quasi cosmique.
Christopher Gérard
Denis Cheynet, Tu crèveras comme les autres, Editions rue Fromentin, 246 pages, 18€.
*Patrice Jean est l’auteur de L’Homme surnuméraire, un grand roman dont j’ai parlé naguère.
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03 août 2018
Avec Michel Lambert
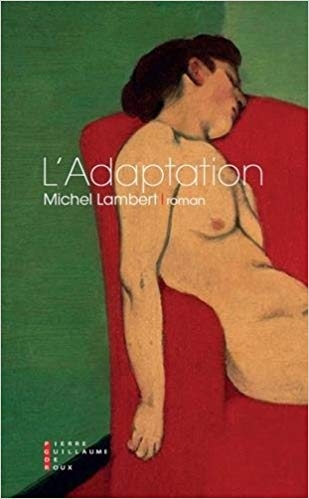
Placé haut par les regrettés Pol Vandromme, Bernard de Fallois et Vladimir Dimitrijevic, trois orfèvres en matière littéraire, Michel Lambert, écrivain, journaliste, un temps rédacteur en chef de la revue de la Promotion des Lettres belges, Le Carnet et les instants, est aujourd’hui l’un des auteurs « maison » de Pierre-Guillaume de Roux, qu’il a connu aux éditions du Rocher et qu’il considère comme « l’éditeur quasi idéal, c’est-à-dire un éditeur qui a les qualités de culture et de passion littéraire, mettant la littérature au-dessus de tout, comme Vladimir Dimitrijevic (…) S’ajoute à ce regard littéraire un certain recul éditorial par rapport aux risques commerciaux que l’on peut prendre ou non. »
Nouvelliste maintes fois primé, Michel Lambert revient au roman avec L’Adaptation, un livre d’une vertigineuse complexité pour qui se donne la peine de le lire avec attention. A partir de La Jeune fille brune, roman du Serbe Alexandre Tišma (que Michel Lambert a naguère préfacé), l’auteur bâtit un labyrinthe à l’issue duquel fusionnent littérature, cinéma et réalité.
Le narrateur de L’Adaptation est un réalisateur sur le retour qui rêve d’adapter La Jeune fille brune au cinéma et, de manière étrange, revit les mêmes péripéties, notamment amoureuses. Ceci nous vaut une plongée dans le monde des acteurs, et surtout dans l’âme tourmentée du réalisateur, dont le lecteur découvre une à une les riches facettes. En filigrane, le souvenir encore douloureux de la mort de l’épouse du narrateur, la hantise de la maladie, sur fond d’attentats sanglants – nous sommes dans la Bruxelles traumatisée par les tueries islamistes. Tout le roman baigne dans une atmosphère de nostalgie et de déclin, qu’il soit physique, professionnel ou sentimental.
De quête aussi, à l’instar de celle du Chevalier médiéval à la poursuite d’une Dame inaccessible.
Comme nous sommes dans les anciens Pays-Bas, nul ne s’étonnera que Michel Lambert joue des couleurs et des ciels, pareil à un peintre de l’ancien temps pour qui les nuages peuvent refléter des sentiments mouvants. Des sons aussi, et des odeurs tant sont omniprésentes, dans L’Adaptation, les synesthésies. De même, les mises en abyme scandent un récit où réalité et imaginaire interagissent en cercles concentriques, où les personnages se dédoublent, à l’image du narrateur et de ses compagnes : « Alors, à quoi bon m’obstiner à chercher un corps, celui de Marielle, ou un autre, celui de Betty, qui m’eût permis de soulager la faim née de mon effort de concentration, née de la solitude dans un appartement trop grand, née peut-être, j’y repensais parfois, un jour très lointain de mon adolescence quand s’était donnée à moi la jeune et éphémère maîtresse de mon père – et qui sait si mon aventure avec Betty ne reproduisait pas, inversée, cette première miraculeuse et culpabilisante aventure ? »
Christopher Gérard
Michel Lambert, L’Adaptation, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 250 pages, 20 €
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature belge, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







