10 décembre 2014
Keats, Keepsake
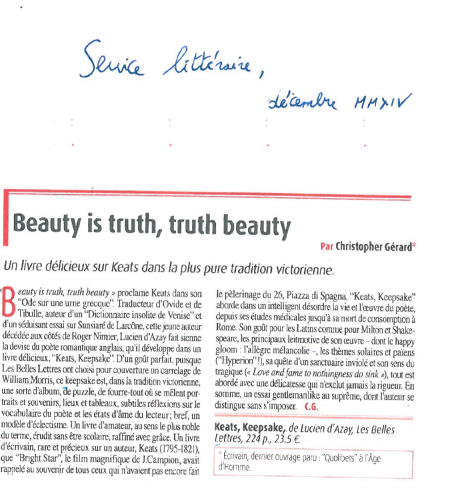
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01 décembre 2014
Avec Romain Slocombe

Mission accomplie pour le camarade Slocombe : son dernier roman, Avis à mon exécuteur, se place très haut dans le gotha du roman noir politique. Le sujet ? Les confessions posthumes d’un bolchevik de la première heure, un Juif polonais entré au service du Parti et qui, dix-sept ans durant, dans l’ombre, sert la Révolution… ou plutôt les idoles sanguinaires créées par cette nouvelle religion. Avec autant de maestria que de fine érudition, Romain Slocombe reconstitue l’atmosphère d’une époque, le climat mental d’une caste : l’URSS des années 30, les réseaux du Komintern et du NKVD – le bras armé de Staline. On songe au roman de J. Boyd, Restless, mais un Boyd autrement plus dense, plus ample, plus dur aussi. Et quelle tension, quel rythme, de la première à la dernière ligne !
Un manuscrit trouvé à Vevey chez un ancien du Vlast - les services soviétiques - livre au lecteur les confessions d’un officier supérieur de l’appareil clandestin du Parti, que nous suivons dans ses opérations, tour à tour cruelles et tortueuses, jusqu’à la dernière : la liquidation (ou liternoïe delo, « lettre spéciale » en code), sous peine de voir femme et enfant assassinés, de son ami d’enfance, un autre tchékiste, écœuré comme lui par la Terreur qui s’abat sur l’URSS. Slocombe s’est inspiré de la vie de Walter Krivitsky, l’un des premiers grands défecteurs, retrouvé suicidé dans une chambre d’hôtel de Washington en 1941 (vendu par Philby ?). L’homme avait choisi la liberté pour protester e.a. contre le massacre systématique des communistes russes par Iagoda et Iéjov, les âmes damnées du tyran (avant leur liquidation dans le cadre de ce que le NKVD appelait non sans humour la rotation des cadres), mais aussi contre le pacte Molotov-Ribbentrop.
Slocombe décrit à la perfection la perte progressive des illusions de ces hommes qui ont tout donné à un mythe, le salut par la révolution prolétarienne, et qui pour faire triompher une religion fondée sur le mensonge, en viennent à trahir tout ce qui fait d’eux des hommes de qualité : esprit critique, scrupules moraux, amitiés, fidélité … Dans le système instauré par Lénine, ne survivent, avec un peu de chance, que les cyniques et les dociles.
La description des crimes commis en Espagne, transformée en charnier par les tueurs du NKVD et leurs supplétifs (notamment français : Marty), glace le lecteur, qui pousse la porte des sinistres checas de Barcelone, où l’on extermine des milliers de pauvres types sous prétexte qu’ils appartiennent au POUM, à la CNT ou parce que, même encartés au PC, ils déplaisent aux cerbères de Moscou. De même, Slocombe reconstitue avec un joli sens de la mise en scène des réunions d’officiers supérieurs à la Loubianka, pressés de faire subir à l’URSS une saignée aux allures de cyclone.
L’Affaire Toukhatchevsky, de même que les Procès de Moscou (bruyamment approuvés par tant de progressistes occidentaux) et la grande terreur de 1938 sont interprétées comme une titanesque guerre interne entre l’Armée rouge, corps sain de l’empire soviétique, et le NKVD, la garde rapprochée du tyran. L’enjeu ? Un pouvoir qui risque d’échapper à Staline, qu’un dossier retrouvé dans un coffre de l’Okhrana, la Sûreté tsariste, accuse, preuves à l’appui, d’avoir été, de 1906 à 1913 un agent provocateur - nom de code Vassili - chargé de surveiller Lénine et le Comité central. L’Etat-Major de l’Armée rouge, mis au courant du passé sordide de Staline, conspire contre le tyran, mais se fait doubler par le NKVD… à la plus grande joie des services allemands, qui eux aussi jouent leur partie. Krivitsky fait défection avec femme et enfant, désespéré de voir souillée la cause d’une vie, et sans illusion aucune sur Trotsky et ses hommes, présentés dans le roman comme des monuments de naïveté. Interrogé à ce sujet, Slocombe m’a répondu n’avoir rien inventé à leur sujet : toutes les preuves de leur aveuglement se trouvent noir sur blanc dans les mémoires de J. Rosenthal, d’E. Poretski et même d’un certain Victor Serge, décidément bien maladroit face aux menées du NKVD.
Un excellent roman, subtil, à la langue ferme et charpentée, fondé sur une analyse approfondie de la psyché révolutionnaire, que l’auteur a connue de près, ayant milité très jeune au sein d’une secte progressiste.
Christopher Gérard
Romain Slocombe, Avis à mon exécuteur, Robert Laffont.
Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, espionnage | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11 septembre 2014
Sur un bel essai de Bruno Lafourcade

Mors voluntaria
Dans une de ses lettres, le peintre Pierre-Yves Trémois me citait ce que son ami Montherlant lui écrivait en septembre 1963 : « Il serait question de faire de la tentative de suicide un délit pénal. Comme si ce n’était pas une question entre soi et soi. Je vous écris cela en songeant à nos Romains, qui n’ont jamais été si grands que lorsqu’ils décidaient de faire cesser leur vie. »
Le suicide, la mors voluntaria de « nos Romains », est précisément le sujet d’un essai réussi, dû à la plume érudite autant que malicieuse d’un jeune professeur de Lyon. Dans Sur le Suicide, Bruno Lafourcade rappelle, pince-sans-rire, que l’homme est l’unique mammifère capable de mettre fin à ses jours. Son livre récapitule les raisons qui, chez un esprit libre et souverain, peuvent justifier le grand saut. Des plus nobles aux plus niaises (la faim dans le monde, une rupture amoureuse, les dettes aux banquiers, etc.), Lafourcade s’amuse, et nous avec lui, à décrire les mobiles de ce geste égoïste et solitaire. Au nombre de ces mobiles, dans le désordre, le bruit totalitaire, le déclin de la langue française, la vieillesse qui vient dans un monde brutal et infantilisé, les moutards et la famille, la maladie… Remarquons que la plupart de ces calamités justifieraient également le meurtre : le vacarme démoniaque d’un smartfaune ne suscite-t-il pas de légitimes envies de Mac modèle 1950, fût-il dépourvu de silencieux ? Le jeune philosophe O. Weininger, l’auteur de Sexe et caractère, se tua en expliquant que, de la sorte, il évitait un carnage. Avait-il raison ?
Vif et spirituel, d’une réjouissante incorrection face à l’imposture égalitaire, sans concession aucune pour la culture de l’aplatissement et de la haine de soi, Lafourcade conseille aux futurs suicidés de justifier leur geste par écrit afin d’éviter les récupérations familiales (« il nettoyait son Mac et puis, eh bien, le coup est parti ; oui, oui »), les interprétations plus ou moins intéressées, voire édifiantes (du genre : « Montherlant est mort chrétien ») et, tout simplement, le doute (Grossouvre, dans son bureau de l’Elysée – douteux, très douteux, surtout dans l’entourage mortifère de certain Président).
Les modèles de suicide sont abordés, de même que les derniers mots (celui, bouleversant, du cher Drieu : « laissez-moi dormir, cette fois » ; le ministre Salengro, qui s’excuse du dérangement). Une typologie des suicidés est aussi proposée : si les savants et les sportifs se tuent peu, en revanche, les soldats et les écrivains… Une pensée pour le colonel Jambon, 86 ans, ancien chef de maquis H’mong, qui se tue devant le monument aux morts de ses camarades indochinois pour protester contre l’abandon de ces braves. Une autre pour l’historien Dominique Venner, exemple de suicide conçu comme un acte de guerre. Lafourcade aurait pu citer Jacques Laurent, qui annonce la couleur dans son livre testamentaire, Ja ou la fin de tout.
La liste des penseurs est longue, depuis Empédocle qui se jette dans l’Etna, Sénèque qui se tue sur ordre du prince, Caraco qui s’ouvre la gorge comme promis après le décès de son père. Drieu bien sûr, et Montherlant – un exemple de virile détermination : le pistolet, le poison, l’heure précise (16 h), le jour de l’équinoxe d’automne.
Avant l’abécédaire des suicidés, instructif (mais incomplet, bien sûr : le dramaturge flamand Hugo Claus), Lafourcade passe en revue les apologies de la mors voluntaria, des Stoïciens, nos maîtres, qui soutiennent qu’il convient pour le sage de vivere quantum debet, non quantum potest aux docteurs de l’Eglise, hostiles au principe même du choix de mourir, l’homme chrétien n’étant que l’intendant d’une vie qui n’appartient qu’au seul Dieu jaloux. Si, pour les Païens, le suicide ne rabaisse jamais celui qui le commet pour éviter des calamités et partir en beauté, chez les disciples de Chrestos, le dolorisme semble l’emporter… quoique certains l’admettent du bout des lèvres. Une belle synthèse, qui vient compléter le superbe essai sur le suicide chez les Romains que composa naguère Gabriel Matzneff.
Christopher Gérard
Bruno Lafourcade, Sur le Suicide, F. Bourin, 224 p., 16€
On relira pour l’occasion Le Défi, de Gabriel Matzneff.
Sur mon ami Lafourcade, lire aussi

09 septembre 2014
L’Ange gardien, de Jérôme Leroy
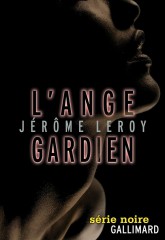
Joli montage que cet Ange gardien, où Jérôme Leroy récapitule des obsessions et des hantises qui n’ont guère changé depuis Monnaie bleue : il est vrai que la Vème République ne se porte pas mieux depuis les hideuses années 80, enlisée qu’elle est dans les égouts d’une mondialisation à marche forcée. Leroy n’a guère d’égal aujourd’hui pour décrire la faune de notre Bas Empire climatisé : journalistes à gages, flics stipendiés, éditeurs marrons, politiciens abrutis…
Les éditions originales recouvertes de papier cristal et les piquantes professeurs de lettres, les armes de poing et les vins non trafiqués, les anxiolytiques (stupéfiante, son érudition à propos de xanax & lexomil), le Rouen d’avant la catastrophe et les polices parallèles, tout un univers poétique ou glaçant revient sous la plume de notre révolté mélancolique.
Si dans Le Bloc, son précédent polar, il décrivait les coups tordus d’un gouvernement de droite qui pariait sur des émeutes ethniques pour se maintenir au pouvoir, aujourd’hui c’est à la gauche établie qu’il réserve quelques tirs tendus. Outre un climat proto-totalitaire, celui de notre décadence, on retrouve dans L’Ange gardien bien des personnages du Bloc, à commencer par Stanko, l’homme des basses œuvres du Bloc patriotique, le parti du tribun Dorgelles. L’Ange gardien passe pourtant un cran au-dessus du Bloc en raison de la plus grande densité de ses personnages, d’une critique sociale mieux intégrée au fil du récit et moins manichéenne, donc plus profonde, enfin d’un humour plus désespéré encore. Prenons le pivot de ce roman, Berthet, l’ange de la mort : sentimental samouraï d’un Occident décomposé, tueur méthodique (quoique parfois négligent : sa chair est faible) qui choisit des pseudonymes littéraires (Jacques Sternberg !) et collectionne les éditions originales de Toulet ou de Michaux. Cette (improbable) barbouze, qui a débuté sous Pompidou, a trempé dans bien des affaires, du meurtre de Pierre Goldmann à la noyade de tel activiste dextriste. Berthet appartient en fait à l’Unité, que d’aucuns appellent l’Etat profond, un service public occulte, invisible et omniprésent, spécialisé dans le nettoyage, y compris médiatique. Ses honorables correspondants se nichent partout, au CNRS comme dans les ministères et les grandes entreprises, et ses chefs, aux noms de cinéastes, nulle part. L’Unité ne fait pas de politique : elle l’influence en tirant le tapis d’un coup sec au bon moment, d’où quelques chutes regrettables. Au début de la Vème, l’Unité maintenait l’ordre national et républicain ; sous l’actuel président, elle ne fait plus que colmater les brèches, pour retarder le naufrage. Signe de nos temps de déréliction, l’Unité subit le même sort que l’école publique ou la poste : les contrats à durée indéterminée cèdent la place à des extras, incompétents et pressurés. La qualité s’en ressent ; Berthet en fait l’expérience dans la nuit lisboète. Il lui suffit de découper au bistouri l’oreille d’un collègue (une scène à la Dexter) pour apprendre que sa protégée, qu’il suit à son insu depuis vingt ans, la ravissante Kardiatou Diop, jeune Secrétaire d’Etat issue des quartiers de Roubaix, va faire l’objet d’une « opé » à la demande de son parti, celui de l’Exemple et du Changement. Non sans brio, Leroy inverse l’intrigue du Bloc : au complot interne à la droite nationaliste - vertueuse liquidation des affreux à la veille du grand soir - il substitue une double conspiration, autrement plus subtile : le sacrifice d’une martyre de la diversité et, cerise sur le gâteau, de la Walkyrie, la fille du tribun Dorgelles, et hop, « Liberté, égalité, fraternité ». Heureusement, il y a encore dans cette France crépusculaire des tueurs dont l’honneur s’appelle fidélité…
L’Ange gardien constitue une parfaite illustration de l’hétérotélie, quand de tortueuses manœuvres aboutissent au résultat inverse de celui recherché. Autre personnage attachant de ce roman où alternent douceur et noirceur, poésie et brutalité (des scènes de sexe trop appuyées, Série noire oblige), celui, récurrent dans l’œuvre du camarade Jérôme, de l’écrivain qui ne va pas trop bien, le lettré dépressif et drogué aux « benzos », l’amant précaire. Joubert est le nom de ce quinquagénaire désabusé, qui pige à droite toute malgré ses idéaux rosâtres et, au lieu de bâtir son œuvre, commet, pour boire, des romans pornographiques. La rencontre entre la barbouze et l’écrivain, un autre leitmotiv chez Leroy, est ici particulièrement réussie, car non dénuée d’un humour grinçant. Concluons. Notre « chardonnien sensuel et contrarié » n’a pas failli à sa mission : d’une belle ampleur, le montage tient la route, baigné d’une réelle poésie, celle des matins grecs et des bistrots parisiens, grâce au talent d’un de nos beaux écrivains*, qui sait, lui, « qu’il n’y a de vérité et de sens que dans la métaphysique ».
Christopher Gérard
Jérôme Leroy, L’Ange gardien, Série noire, 330 p., 18.90€
*L’honnêteté commande de déplorer, page 142, un « rentrer sur Paris » qui devrait me valoir une ou deux fillettes de Chinon sans soufre.
On dit du mal de Jérôme Leroy dans mon journal de lectures.

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, polar, série noire, jérôme leroy | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17 juin 2014
Un maître du Witz : Bernard du Boucheron

Enarque, ancien haut responsable dans l’industrie aéronautique, Bernard du Boucheron a décroché à 76 ans le Grand Prix du roman de l’Académie française avec Court Serpent, son premier roman - style au couteau et cruel raffinement. Six romans tout aussi pessimistes, publiés chez Gallimard, ont confirmé qu’il s’agissait d’un écrivain de haut parage et à rebours des modes. Voilà que, pour son huitième roman, il change d’éditeurtant il semble que Le Cauchemar de Winston ait effarouché la grande maison. Il est vrai que, dans le genre - difficile - de l’utopie mal-pensante, Boucheron atteint un sommet.
Mai 1941, Hitler, alias le Conducteur, échappant aux manœuvres de son médecin (zigouillé par la police secrète), retrouve un semblant de lucidité et annule l’opération Barbarossa. C’est le Grand Tournant, quand Ribbentrop et Molotov se partagent le continent (hilarant dialogue entre les deux prédateurs) dans le cadre d’une paix « perpétuelle ». Londres feint de reconnaître la prédominance allemande sur l’Europe en attendant son heure. Quant aux foules grisâtres de France, prises d’une frénésie de dénonciations, elles subissent bon gré mal gré la férule du Maréchal dans un fumet d’ail et de pieds mal lavés, faute de savon : « ce peuple indomptable qui a toujours accepté la servitude si même il ne recherchait pas, ce peuple artiste qui chante faux et a voué un culte à la laideur, cette nation généreuse que ne vit que pour son bas de laine, ces universalistes qui ignorent tout du monde, ces amateurs de grandeur pour qui le mot « petit » est un suprême éloge ». Au nom du Parti, Aragon chante le génie de Staline et d’Hitler, pendant que ses camarades passent en masse au service de la Grande Allemagne, « tant est grand le prestige de la tyrannie dans la patrie de la liberté où l’aplatissement va de pair avec l’insurrection ». Vichy s’installe à Versailles et Laval se suicide ( ?) pour céder la place à l’Ambigu, un avocat pourri d’ambition, ancien élève des Maristes - le genre à se faire limer les canines pour offrir un sourire plus enjôleur. Boucheron se surpasse dans la description de cet ambitieux qui « collabore sans ardeur et résiste sans conflits ». Avec Speer, l’Ambigu, que ses affidés surnomment Tonton, va négocier la Paix de Pantin, qui fait de la France, où renaissent des cultes naturistes, un modèle de décroissance. En 1951, rose à la main, l’Ambigu accueille la dépouille du Maréchal au Panthéon. Le même reçoit le Conducteur à Paris, sur la tombe du Soldat inconnu. Débarrassé d’une SS décidément encombrante, le Conducteur, dont Boucheron imagine une interview délirante avec un journaliste étrusque (en fait : albanais), prépare son triomphe dans une débauche de grands travaux tandis que la perfide Albion concocte sa terrible revanche. Du grand œuvre, qui laisse pantois.
Christopher Gérard
Bernard du Boucheron, Le Cauchemar de Winston, Editions du Rocher, 190 pages, 17€
PS: B. du Boucheron est l'un des 122 auteurs présentés dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, uchronie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







