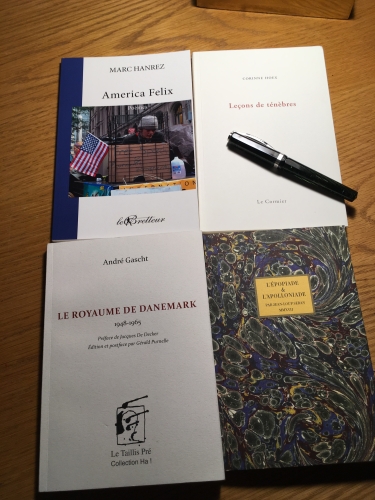18 mars 2019
Avec Pierre Joannon

La parution d'un joli recueil de textes dédié à la mémoire du cher Michel Déon est l'occasion rêvée de sortir de mes archives ce bel entretien accordé par Pierre Joannon en 2006 pour la défunte NRH.

- Christopher Gérard : Pierre Joannon, vous êtes le spécialiste incontesté de l’histoire de la Verte Erin et de ses habitants. On ne compte plus les ouvrages que vous avez rédigés, dirigés et préfacés sur ce pays qui fascine tant les Français. Vous publiez ces jours-ci aux Editions Perrin, une monumentale Histoire de l’Irlande et des Irlandais de près de sept cents pages. D’où vous est venue cette passion pour l’Hibernie ? Seriez-vous la réincarnation lointaine d’un barde gaël ?
- Pierre Joannon : Navré de vous décevoir ! Aucune goutte de sang irlandais ne coulait dans mes veines jusqu’à une date récente. En 1997, le Taoiseach (Premier ministre) de l’époque a dû sans doute estimer qu’il y avait là une lacune à combler, et il me fit octroyer la nationalité irlandaise, une reconnaissance dont je ne suis pas peu fier. On peut en tirer deux observations : que l’Irlande sait reconnaître les siens, et qu’on peut choisir ses racines au lieu de se contenter de les recevoir en héritage ! D’où me vient cette passion pour l’Irlande ? D’un voyage fortuit effectué au début des années soixante. J’ai eu le coup de foudre pour les paysages du Kerry et du Connemara qui correspondaient si exactement au pays rêvé que chacun porte en soi sans toujours avoir la chance de le rencontrer. Et le méditerranéen que je suis fut immédiatement séduit par ce peuple de conteurs disert, roublard et émouvant, prompt à passer du rire aux larmes avec un bonheur d’expression qui a disparu dans nos sociétés dites évoluées. L’histoire de cette île venait à point nommé répondre à certaines interrogations qui étaient les miennes au lendemain de la débâcle algérienne. Je me mis à lire tous les ouvrages qui me tombaient sous la main, tant en français qu’en anglais. Etudiant en droit, je consacrais ma thèse de doctorat d’Etat à la constitution de l’Etat Libre d’Irlande de 1922 et à la constitution de l’Eire concoctée par Eamon de Valera en 1937. Un premier livre sur l’Irlande, paru aux Editions Plon grâce à l’appui bienveillant de Marcel Jullian, me valut une distinction de l’Académie Française. A quelques temps de là, le professeur Patrick Rafroidi qui avait créé au sein de l’Université de Lille un Centre d’études et de recherches irlandaise unique en France, m’offrit de diriger avec lui la revue universitaire Etudes Irlandaises. En acceptant, je ne me doutais guère que j’en assumerai les fonctions de corédacteur en chef pendant vingt-huit ans. Je publiais, dans le même temps plusieurs ouvrages sur le nationalisme irlandais, sur le débarquement des Français dans le comté de Mayo en 1798, sur de Gaulle et ses rapports avec l’Irlande dont étaient originaires ses ancêtres Mac Cartan, sur Michael Collins et la guerre d’indépendance anglo-irlandaise de 1919-1921, sur John Hume et l’évolution du processus de paix nord-irlandais. J’organisais également plusieurs colloques sur la Verte Erin à la Sorbonne, au Collège de France, à l’UNESCO, à l’Académie de la Paix et de la Sécurité Internationale et à l’Université de Nice. Enfin, en 1989, je pris l’initiative de créer la branche française de la Confédération des Ireland Funds, la plus importante organisation internationale non gouvernementale d’aide à l’Irlande réunissant à travers le monde Irlandais de souche, Irlandais de la diaspora et amis de l’Irlande. Vecteur privilégié de l’amitié entre nos deux pays, l’Ireland Fund de France que je préside distribue des bourses à des étudiants des deux pays, subventionne des manifestations culturelles d’intérêt commun et participe activement à l’essor des relations bilatérales dans tous les domaines. Ainsi que vous pouvez le constater, l’Irlande a fait boule de neige dans ma vie, sans que cela ait été le moins du monde prémédité. Le hasard fait parfois bien les choses.
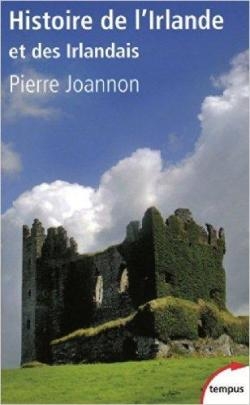
- C. G. : Pourquoi ce titre Histoire de l’Irlande et des Irlandais ? N’est-il pas un peu redondant ?
- P. J. : Nullement. On peut disserter sur l’Irlande, sur la France, et succomber par excès de conceptualisation aux idées reçues, aux stéréotypes. Revenir aux composantes de la population oblige à prendre en compte une réalité qui résiste aux simplifications abusives. Pour comprendre cette histoire pleine de bruit et de fureur, il faut restituer aux Irlandais la diversité et la complexité qui caractérise leurs origines : Gaels, Vikings, envahisseurs normands, Anglo-normands plus ou moins hibernisés, Vieux Anglais catholiques, colons cromwelliens et williamites, Ecossais d’Ulster, « mere Irish » soumis ou rebelles, catholiques inféodés au Château de Dublin, Anglo-irlandais convertis au nationalisme ou piliers de l’unionisme, descendants de Huguenots, fidèles de la Church of Ireland ou protestants non-conformistes, suppôts de l’Ordre d’Orange ou de l’Ancient Order of Hibernians, Irlandais de souche ou de la diaspora, nombreux sont les alluvions qui ont fait de ce peuple ce qu’il est devenu. Lorsqu’on parle des Irlandais, il convient toujours de se demander « Mais de qui parle-t-on exactement ? ».
- C. G. : Est-ce à cause de cette diversité que les Irlandais semblent traverser, à intervalles réguliers, une crise d’identité qui les pousse à chercher une réponse à cette lancinante interrogation « What does it mean to be Irish ? ».
- P. J. : Sans aucun doute. Et ce trait que vous soulignez n’est pas nouveau. Dans Henri V, pièce écrite aux alentours de 1599, Shakespeare fait dire au capitaine irlandais MacMorris : « What ish my nation ? » - Qu’est-ce que ma nation ? C’est la première expression littéraire de cette crise d’identité qui, sous des formes diverses, est une des constantes de l’histoire irlandaise. Le poète Seamus Heaney, Prix Nobel de littérature, ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit : « Notre île est pleine de rumeurs inconfortables ». Cette volonté de refuser l’embrigadement imposé par des définitions en forme de pièges réducteurs exprime une identité en perpétuelle recherche de nouvelles formes. Chemin faisant, les Irlandais d’aujourd’hui ont enfin tordu le cou à ce complexe d’ex-colonisé qui les figeait dans une posture victimaire et un syndrome de ressentiment qui bridait leurs énergies. C’est patent en République d’Irlande, même si cela est moins évident dans cette Irlande du Nord occupée à panser les plaies de trente années de guérilla urbaine et d’affrontements inter-communautaires qui ont laissé dans les esprits des séquelles difficiles à évacuer.

- C. G. : Vous soulignez qu’il existe en Irlande deux traditions historiographiques, l’une nationaliste focalisée sur les rapports conflictuels avec l’Angleterre, l’autre moins isolationniste et plus européocentrique. Laquelle vous semble la plus pertinente ? Votre approche de l’histoire irlandaise a-t-elle évolué depuis 1973, date de votre premier essai sur la Verte Erin ?
- P. J. : Il existe, en effet, deux lectures complémentaires de l’histoire irlandaise. Il y a d’abord la lecture « traditionnelle » narrant la destinée d’un peuple conquis et colonisé entre le XIIe et le XVIIe siècle, qui s’efforce de s’émanciper tout au long du XIXe, utilisant pour cela la voie parlementaire aussi bien que l’insurrection ou la guérilla, et qui finira par obtenir son indépendance politique dans le premier quart du XXe siècle, au terme d’affrontements qui préfigurent le grand mouvement de décolonisation qui devait sonner le glas des empires coloniaux au lendemain de la seconde guerre mondiale. Et il y a une lecture « européocentrique », mettant en lumière la dialectique qui sous-tend toute l’histoire irlandaise, la faisant s’éloigner de l’Europe à mesure qu’elle s’intègre davantage à un monde britannique dont elle ne parvient pas à se dégager, et la faisant au contraire se tourner vers l’Europe et même s’agréger à elle dans la phase de recherche de son indépendance et, à plus forte raison, dans la phase d’affirmation de cette indépendance chèrement payée. Quant à savoir où je me situe, il est clair que l’on ne peut écrire l’histoire de l’Irlande en 2006 comme on le faisait à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. il y a quarante ans, l’historiographie nationaliste, imprégnée de cette philosophie du ressentiment dont je parlais à l’instant, était toute puissante. On ne pouvait guère échapper à son influence. Aujourd’hui, les Irlandais ont pris du recul, des documents nouveaux ont été découverts et exploités, l’analyse d’éminents historiens comme Roy Foster ou Joseph Lee ont fait bouger les perspectives. En ce qui me concerne, peut-être suis-je moins crédule, moins naïf, moins déterministe dans mon approche. Je connais mieux l’Irlande. J’ai vieilli. Je pense être mieux armé intellectuellement pour restituer à cette histoire son épaisseur humaine et sa complexité sans tomber pour autant dans l’autre piège réductionniste du révisionnisme anti-nationaliste systématique qui a sombré dans le discrédit il y a une dizaine d’années environ.
- C. G. : Quelle est votre figure préférée de l’histoire irlandaise ?
- P. J. : Je suis bien en peine de vous répondre. Il existe tant de figures attachantes ou admirables : Parnell, Michael Collins, de Valera, John Hume aujourd’hui. Peut-être ai-je une prédilection pour Theobald Wolfe Tone, ce jeune avocat protestant qui fut, au dix-huitième siècle, « l’inventeur » du nationalisme irlandais après avoir échoué à intéresser les Anglais à un fumeux projet de colonisation. Il voulait émanciper les catholiques, mobiliser les protestants, liquider les dissensions religieuses au profit d’une conception éclairée de la citoyenneté, briser les liens de sujétion à l’Angleterre. Artisan de l’alliance franco-irlandaise il a laissé un merveilleux journal narrant ses aventures et ses intrigues dans le Paris du Directoire. On y découvre un jeune homme curieux, gai, aimant les femmes et le bon vin, fasciné par le théâtre et les défilés militaires, enthousiasmé par Hoche et beaucoup moins par Bonaparte. Capturé par les Anglais à la suite du piteux échec d’une tentative de débarquement français en Irlande, il sollicita de la cour martiale qui le jugeait la faveur d’être passé par les armes « pour avoir eu l’honneur de porter l’uniforme français ». Elle lui fut refusée : il fut condamné au gibet. La veille de l’exécution, il se trancha la gorge avec un canif et agonisa toute une semaine avant d’expirer le 19 novembre 1798.
- C. G. : James Joyce disait qu’il voulait, par son œuvre, « européaniser l’Irlande et irlandiser l’Europe ». N’est-ce pas ce qui se passe depuis une vingtaine d’année ?
- P. J. : Sans aucun doute. L’Irlande est devenue européenne. Et l’Europe lui a apporté beaucoup. Plus encore que des subventions, non négligeables, et la possibilité de dynamiser une économie en quête de débouchés, c’est le désenclavement des énergies et des mentalités, la fin d’un tête à tête oppressant qui se traduit par l’instauration d’une relation apaisée avec un voisin dont on se sent moins dépendant, le rattachement au continent d’une conscience libérée des pesanteurs de l’histoire et de la géographie, et la confiance que ce destin partagé finira par reléguer les violents soubresauts du Nord au magasin des vieilles querelles oubliées. Quant à l’irlandisation de l’Europe, elle va bon train. On fête la Saint Patrick du Nord au Sud du vieux continent. Les pubs irlandais fleurissent à tous les coins de rue. La littérature irlandaise est traduite en français, en italien, en espagnol. Les pièces de Frank Mc Guinness et de Brian Friel triomphent sur les scènes du monde entier. Neil Jordan décroche le Lion d’Or du Festival de Venise. Le groupe rock U2 se classe premier au hit parade international. Riverdance joue à guichets fermés à Paris, à Londres, à Nice. Wilde, Joyce, Yeats, Beckett continuent de dominer de leur haute stature le corpus littéraire de notre temps. On pourrait multiplier les exemples.
- C. G. : Votre ami Michel Déon qui a préfacé votre belle biographie de Michael Collins s’insurge contre cette prospérité « qui s’abat sur l’Irlande comme la pédophilie sur le bas clergé ». Etes-vous sensible à ce danger qui pèse sur l’Hibernie ?
- P. J. : Bien sûr, tout n’est pas parfait dans ce pays en pleine mutation qu’est devenu l’Irlande. Le Tigre Celtique a bien des taches sur son pelage. Le jeune cadre dynamique qui descend Dawson Street, un téléphone portable collé à l’oreille, n’a plus grand chose en commun avec le baladin du monde occidental de Synge. Mais, entre les plaintes de la tradition et les mirages de la modernité, les Irlandais qui ont déjà triomphé de la misère et de l’auto-flagellation, sauront rester fidèles à l’idée qu’ils se font d’eux mêmes et que nous nous faisons d’eux. Du moins est-il permis de l’espérer !
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17 janvier 2019
L'Apocalypse selon Denis Cheynet.

Magistral premier roman, que nous offre Denis Cheynet avec Tu crèveras comme les autres, sous la casaque noire des éditions rue Fromentin et avec une éclairante préface de Patrice Jean, auteur de la maison*, qui parle à bon droit de « grand roman sur les impasses technologiques et philosophiques du monde moderne ».
Le coup de génie réside dans l’usage quasi hypnotique de la deuxième personne du singulier, comme dans les Dix Commandements, qui donne au roman cet air incantatoire et prophétique, mais aussi de l’indicatif - mode de la réalité - futur simple. Le romancier vaticine ; il décrit ce qui adviendra : la terrifiante descente aux Enfers d’un cadre moyen de la région parisienne, et en fait de toute une civilisation, happés par l’effondrement subit du monde techno-marchand.
En quelques mois à peine, le petit-bourgeois post-moderne, insignifiant rouage d’une firme d’informatique (l’un de ces nouveaux métiers auxquels les diplodocus de mon âge ne comprennent rien), gavé de séries politiquement correctes et de week-ends cucul-la-praline, se trouve projeté dans l’univers nettement moins policé de The Road : finis l’appartement propret doté de l’écran extra-plat, le zoning industriel et sa cantine bio, le bolide de fonction et les cartes en plastique ! Place au struggle for life le plus féroce, décrit avec une minutie quasi sadique, non sans une once d’humour noir soigneusement celée (le ton macronien du Président qui, alors que tout flambe, en appelle encore, avant de prendre la fuite, à « aider tous les citoyens du monde »).
Tu crèveras comme les autres est bien un conte philosophique, en ce sens que l’auteur force son lecteur à prendre conscience de l’insondable vacuité, de l’égoïsme obscène et de la terrifiante dépendance de l’Occidental, soumis à son smarfaune, asservi par l’usure, crétinisé par d’ineptes obligations professionnelles : « Le travail t’absorbera au début de la semaine, te malaxera et te digérera pour te rejeter comme un excrément le vendredi soir ».
Au fil des pages, le lecteur passe ainsi d’une barbarie l’autre, tiède et aseptisée quand « tout va bien », fétide et glaçante quand tout se dérègle. Car tout part en fumée, et vite : firmes, magasins, approvisionnements, hôpitaux et pompiers, blocages mentaux en tout genre… puisque le ci-devant cadre finira, comme les autres, par se repaître de chair humaine. Clinique, la description de cette descente, qui est aussi une sorte de libération, est servie par un style d’une précision parfaite – pas un mot de trop. « Après avoir essayé de rivaliser avec les astres, les hommes seront désormais aveugles et trembleront de peur », « les défenseurs des droits de l’homme dépèceront des criminels afin de se nourrir de leur chair » : tel est le cruel destin de ces derniers hommes qui, malgré de pitoyables tentatives de résistance (sectes millénaristes, milices hollywoodiennes, sororités féministes, et tutti quanti), sombrent dans la guerre de tous contre chacun.
D’hommes, ils sont devenus moins que des chiens – « un instant insignifiant dans l’immensité du temps, un fragment de matière organique minuscule dans l’immensité de l’univers ».
Une apocalypse au sens premier de révélation – d’un écrivain de race comme d’une vision d’ampleur quasi cosmique.
Christopher Gérard
Denis Cheynet, Tu crèveras comme les autres, Editions rue Fromentin, 246 pages, 18€.
*Patrice Jean est l’auteur de L’Homme surnuméraire, un grand roman dont j’ai parlé naguère.
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03 août 2018
Avec Michel Lambert
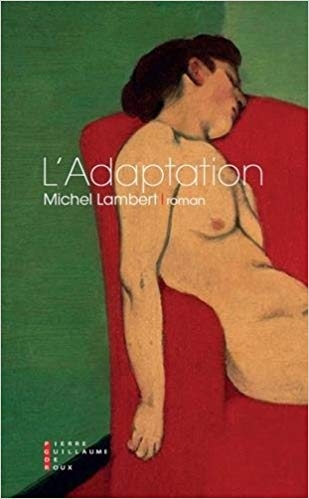
Placé haut par les regrettés Pol Vandromme, Bernard de Fallois et Vladimir Dimitrijevic, trois orfèvres en matière littéraire, Michel Lambert, écrivain, journaliste, un temps rédacteur en chef de la revue de la Promotion des Lettres belges, Le Carnet et les instants, est aujourd’hui l’un des auteurs « maison » de Pierre-Guillaume de Roux, qu’il a connu aux éditions du Rocher et qu’il considère comme « l’éditeur quasi idéal, c’est-à-dire un éditeur qui a les qualités de culture et de passion littéraire, mettant la littérature au-dessus de tout, comme Vladimir Dimitrijevic (…) S’ajoute à ce regard littéraire un certain recul éditorial par rapport aux risques commerciaux que l’on peut prendre ou non. »
Nouvelliste maintes fois primé, Michel Lambert revient au roman avec L’Adaptation, un livre d’une vertigineuse complexité pour qui se donne la peine de le lire avec attention. A partir de La Jeune fille brune, roman du Serbe Alexandre Tišma (que Michel Lambert a naguère préfacé), l’auteur bâtit un labyrinthe à l’issue duquel fusionnent littérature, cinéma et réalité.
Le narrateur de L’Adaptation est un réalisateur sur le retour qui rêve d’adapter La Jeune fille brune au cinéma et, de manière étrange, revit les mêmes péripéties, notamment amoureuses. Ceci nous vaut une plongée dans le monde des acteurs, et surtout dans l’âme tourmentée du réalisateur, dont le lecteur découvre une à une les riches facettes. En filigrane, le souvenir encore douloureux de la mort de l’épouse du narrateur, la hantise de la maladie, sur fond d’attentats sanglants – nous sommes dans la Bruxelles traumatisée par les tueries islamistes. Tout le roman baigne dans une atmosphère de nostalgie et de déclin, qu’il soit physique, professionnel ou sentimental.
De quête aussi, à l’instar de celle du Chevalier médiéval à la poursuite d’une Dame inaccessible.
Comme nous sommes dans les anciens Pays-Bas, nul ne s’étonnera que Michel Lambert joue des couleurs et des ciels, pareil à un peintre de l’ancien temps pour qui les nuages peuvent refléter des sentiments mouvants. Des sons aussi, et des odeurs tant sont omniprésentes, dans L’Adaptation, les synesthésies. De même, les mises en abyme scandent un récit où réalité et imaginaire interagissent en cercles concentriques, où les personnages se dédoublent, à l’image du narrateur et de ses compagnes : « Alors, à quoi bon m’obstiner à chercher un corps, celui de Marielle, ou un autre, celui de Betty, qui m’eût permis de soulager la faim née de mon effort de concentration, née de la solitude dans un appartement trop grand, née peut-être, j’y repensais parfois, un jour très lointain de mon adolescence quand s’était donnée à moi la jeune et éphémère maîtresse de mon père – et qui sait si mon aventure avec Betty ne reproduisait pas, inversée, cette première miraculeuse et culpabilisante aventure ? »
Christopher Gérard
Michel Lambert, L’Adaptation, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 250 pages, 20 €
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature belge, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16 janvier 2018
Quatre poètes belges
Quatre poètes, dont trois amis chers, illustrent chacun à leur façon la vitalité de leur art en Belgique romande, « terre de poètes » pour citer un cliché … usé jusqu’à la trame – mais pas entièrement faux. Quelques maisons d’édition, quelques revues, maintiennent le cap, souvent par la grâce du mécénat public ou privé et avec l’aide de quelques figures tutélaires, dont Fernand Verhesen, Jacques Izoard ou Yves Namur.
Commençons par une dame dont j’ai parlé ailleurs, dans mes Quolibets, la piquante Corinne Hoex (1946), historienne d’art et archéologue, romancière et l’auteur d’une quinzaine de recueils souvent elliptiques jusqu’à l’ascétisme. Je reçois, tristes et sombres, des Leçons de ténèbres qui m’évoquent les pièces pour viole de gambe de Marin Marais, où l’exquise Corinne, qui peut se montrer tantôt espiègle, tantôt cruelle, révèle ici sa part mélancolique, quasi désespérée :
Caveau transi.
Humide.
Crypte basse.
Eventrée.
Cierges fumeux.
Crucifix absent.
La suit Marc Hanrez (1934), ce romaniste qui eut l’audace, en dernière année d’études, de pousser la porte de Céline à Meudon et de faire parler celui que le regretté Pol Vandromme appelait Louis. Devenu l’ami de Nimier, puis de Dominique de Roux (excusez du peu), il rédigera le premier essai consacré à l’auteur du Voyage au bout de la nuit. L’homme a vécu aux Amériques ; il a chassé le daim dans les forêts du Wisconsin et enseigné Abellio, Drieu et Morand à des générations d’étudiants. Avec America Felix, il revient, en vers très libres, sur sa jeunesse américaine, baignée par le jazz et par le chant des moteurs de pickups sur les highways. La baie de San Francisco, les forêts giboyeuses, Manhattan et sa magie, Paul Newman lui inspirent une étrange mélopée.
Le troisième ami, Jean-Loup Seban (1748), est un drôle de pistolet : ancien professeur à Princeton, spécialiste du marquis d’Argens, le chambellan du roi de Prusse et l’ami de Voltaire (et le traducteur de l’empereur Julien), pasteur de l’Eglise réformée (qui ne jure que par Apollon), dandy suranné et bibliophile (rien de postérieur à Charles X, car ensuite…), Seban meuble ses loisirs en reconstituant une bibliothèque classique, par l’accumulation de volumes anciens et, surtout, par la composition de sonnets rédigés dans les règles telles qu’énoncées par César-Pierre Richelet (1626-1698).
Hors commerce, ses recueils sont édités à ses dépens avec un soin maniaque, qui va jusqu’à imiter les couvertures marbrées du XVIIIème. Dans L’Epopiade & L’Apolloniade, ce libertin au sens classique, cet érudit précieux avec délectation, chante, en alexandrins, Chénier et Napoléon, Marsyas et Narcisse… et même le dernier César :
Faut-il que pour la paix César se déshonore ?
Abandonner la ville au Dieu de l’Alcoran ?
Comme Jérusalem où règne le Turban ?
Faillir à la vertu de Rome et de la Grèce ?
Le quatrième, André Gascht (1921-2011), un Ardennais éduqué à Anvers à une époque où l’on y parlait français sans crainte, je ne l’ai guère rencontré que deux ou trois fois lors de mes débuts à la Maison des Ecrivains ou aux Riches Claires, ce haut-lieu littéraire de la capitale. L’homme était distant, immensément savant, ironique aussi – un monument de la critique littéraire avec son confrère Jean Tordeur. Spécialiste de Pieyre de Mandiargues, Gascht a, avec une piété qui l’honore, maintenu le souvenir d’un immense poète, Odilon-Jean Périer, que j’ai salué avec émotion dans Aux Armes de Bruxelles. En outre, Gascht a tout fait pour qu’un autre confrère, le lieutenant Auguste Marin, tué sur la Lys le 24 mai 1940, ne sombre pas dans un injuste oubli. C’est en effet André Gascht qui fut l’éditeur des œuvres de ce poète, proche de Périer. J’aime par-dessus tout cette manière de constituer le maillon d’une chaîne…
Quant au poète, pudique et discret, il a donné le meilleur de lui dans un recueil unique publié à quarante-cinq ans, Le Royaume de Danemark. L’ouvrage, réédité avec une préface enthousiaste de Jacques De Decker, traduit en alexandrins classiques l’amertume d’une âme raffinée, les amours impossibles et les désirs inassouvis. Comme souvent en Belgique romande, le poète se révèle syncrétiste, à la fois classique et romantique. Une voix sourde et profonde, qui ne cesse de résonner :
Désir de ta gorge entrevue,
de tes flancs tièdes et secrets,
de tes jambes qui, dans la rue,
lèvent des rêves indiscrets.
Mais tu t’en vas, à peine émue
de ce regard qui te suivait ;
et tu traverses l’avenue,
tu t’éloignes, tu disparais…
Christopher Gérard
Corinne Hoex, Leçons de ténèbres, Le Cormier.
Marc Hanrez, America Felix, Le Bretteur.
Jean-Loup Seban, L’Epopiade & L’Apolloniade,
chez Robert Clerebaut, imprimeur.
André Gascht, Le Royaume de Danemark, Le Taillis-Pré, collection Ha !
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature belge, poésie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14 juin 2017
Baudelaire au pays des Singes
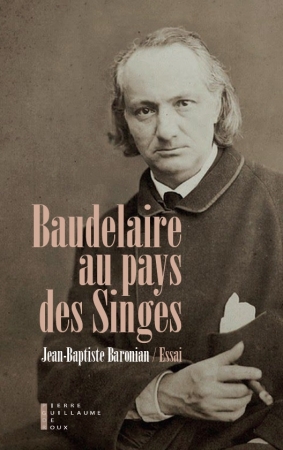
Après L’Enfer d’une saison (Editions de Fallois), où il imaginait les errances et les pensées du jeune Rimbaud dans une Bruxelles caniculaire, « au soleil des Hespérides », sur les traces de Baudelaire place Royale et à l’Hôtel du Grand Miroir, Jean-Baptiste Baronian s’est amusé à reprendre à zéro le dossier Baudelaire « au pays des Singes », i.e. dans la Belgique de Léopold II. Nombre d’essais ont été composés (et recopiés) sur ce séjour malheureux (1864-1866), qui se conclut par la crise d’hémiplégie de mars 1866, le début du calvaire, que le cruel destin lui inflige, ô ironie, dans l’église namuroise des Jésuites.
Avec ce livre aussi vif que plaisant, sans l’air d’y toucher, le très-érudit Jean-Baptiste Baronian met fin à quelques légendes tenaces. Ainsi, la belgophobie rabique du poète est d’emblée expliquée par la misanthropie avouée d’un écrivain qui se considère comme un paria, ulcéré de ne pas être reconnu par la critique … et fêté par de généreux éditeurs. « Ce livre sur la Belgique (…) est un essayage de mes griffes. Je m’en servirai plus tard contre la France. J’expliquerai patiemment toutes les rasions de mon dégoût du genre humain », écrit-il à Narcisse Ancelle dès le début de son séjour.
Malheureux en amour, horrifié par le monde industriel, écœuré par la comédie de Paris (et aussi terrifié à l’idée d’y affronter ses créanciers), déçu dans ses ambitions éditoriales (surtout quand il compare sa situation à celle du richissime Hugo), Baudelaire se réfugie en Belgique dans le but d’y faire un bon livre d’impressions sur le jeune royaume libéral, et dans l’espoir naïf d’y toucher le pactole. Cette excursion se métamorphose vite en enfer et, malgré le relatif succès de ses conférences au Cercle artistique et littéraire, Baudelaire sombre vite dans la dépression, faute de signer les mirobolants contrats qu’il avait imaginés. D’où, malgré l’amitié d’un Félicien Rops (qualifié de « seul véritable artiste »), sa rage pathétique à l’encontre de la « Grotesque Belgique » et de sa « capitale pour rire ».
Christopher Gérard
Jean-Baptiste Baronian, Baudelaire au pays des singes, Pierre-Guillaume de Roux, 19,50 €
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |