18 février 2014
Pour saluer Alain Bertrand

" Bien que myope, Alain Bertrand voit clair : sa petite musique est de celle qui s’impose avec une force discrète, celle d’un Marcel Aymé qui serait porté sur les bières d’abbayes."
C'est ainsi que je tentais de définir le cher Alain Bertrand, qui vient de mourir, trop tôt. Pour le saluer, voici l'entretien qu'il m'avait accordé en 2010. Tout l'homme, et quel homme : chaleureux, sensible, se révèle.
Que la terre te soit légère!
Entretien avec Alain Bertrand
Qui êtes-vous ?
Si je le savais, je n’écrirais pas. C’est précisément pour trouver une consistance que l’on écrit, au lieu de jouer aux castagnettes ou à la roulette russe. Les mots ont ce pouvoir de révélation ; ils nous créent et nous délivrent tout en nous dissimulant derrière la perfection de leur forme. Je crois qu’on n’existe vraiment qu’en relation. Avec soi-même, avec les autres, avec les mots, avec la nature. Pas d’existence possible sans ces ponts de corde que la littérature, dans son essence, tente de dresser au-dessus des gouffres.
Comment vous définir ?
Se définir, c’est planter les clous de son cercueil. Je préfère les perspectives forestières et les chemins de grandes randonnées. Donc, la question reste ouverte.
Les grandes lectures ?
Si vous étiez mon professeur, je vous livrerais la longue liste de ce qu’il faut avoir lu. J’insisterais sur Céline, Apollinaire ou Simenon. Vous m’accorderiez une note moyenne, sans plus. L’examen terminé, on évoquerait Blondin, Calet ou Vialatte, texte dans une main, crayon dans l’autre. Et le style nous occuperait toute la soirée, et même la nuit; on s’approcherait doucement des choses, le miracle viendrait ; le style, c’est l’aube du premier matin. Après quoi, on se ferait servir un café dans une grosse tasse de faïence, comme on en trouve dans les brasseries, à Genève. C’est alors que je vous livrerais le nom de celui qui a joué le plus grand rôle dans ma vie de lecteur : Georges Haldas.
Les grandes rencontres? Des écrivains? Des peintres ?
Si j’avais à construire ma biographie, j’évoquerais les rencontres. Avec des écrivains, des peintres, des anonymes. Le premier fut Gaston Compère ; il a été mon père intellectuel, m’apprenant la liberté du regard et l’exigence du style – son absolu. Il m’a rendu plus sensible à la musique et à ce qu’il appelait l’aristocratie de la sensibilité. Avec Jean-Claude Pirotte, j’ai pratiqué l’assouplissement de la phrase et la plongée dans la nuit de l’être. Adamek est un narrateur exceptionnel, doublé d’un styliste juteux et fraternel. Franz Bartelt est un frère en écriture ; grâce à lui, je me suis autorisé des angles inédits, des audaces de jeune homme, des pudeurs de jeune fille … Tous ces amis m’ont rapproché de moi-même en littérature, mais l’enjeu reste le même : marier la poésie, l’ironie, l’humanité et l’impertinence.
Gantois d'origine, Ardennais d'adoption, vous chantez la lumière des Polders. Synthèse singulière, n'est-il pas ?
Le simple fait que je sois né à Gand intrigue souvent les journalistes plus que le contenu de mes livres. C’est la preuve, je crois, que tout se termine quand tout n’a pas encore commencé. Il faut se refuser à toute illusion sauf à celle d’exister. J’ai vécu à Bruxelles une vingtaine d’années avant de venir travailler à Bastogne : c’est une réalité biographique. Mais il y a les paysages psychiques. Or, ceux-là, dans mes livres, ce sont des recréations de la Semois d’une part et des polders, de l’autre. Pourquoi ? Parce que ma sensibilité s’y retrouve, tout simplement, ainsi qu’une certaine douleur d’être au monde. J’aime la lumière par-dessus tout ; c’est le baume absolu, un équivalent de la tendresse. Dans Polders (Bernard Gilson éditeur), je tente de la glisser entre les mots, dans la respiration de la phrase : c’est une préoccupation première. Que tout respire, que la vie surgisse, afin que chacun, par la rencontre, puisse naître, malgré les détresses.
Vous sentez-vous, comme écrivain, citoyen de Ce Pays "où le rêve est la seule chance d'échapper à un trop maigre destin" ?
Mon travail littéraire est le résultat d’une fécondation : une sensibilité liée à la Flandre, l’usage de la langue française. Ce mélange fait-il un Belge ? Peut-être, mais alors un Belge qui rêve plus qu’il ne vit et songe à cette enfance où tout semblait s’ouvrir à l’espérance.
Pourquoi les Polders, et non la Campine ou la Gaume ? Leur lumière, leur ciel, un certain vide ?
Oui, il y a là-bas les noces de l’eau, de la terre et du ciel, et le vide que seule la phrase remplit comme le sel le sablier, avant le prochain livre, et le suivant, jusqu’à la fin des choses.
J'aime que les machines vous horripilent, comme vous l'illustrez avec esprit dans On progresse (Le Dilettante). Toutes ? Non, le vélocipède semble exercer sur vous une trouble fascination ...
C’est moins la machine qui m’horripile que ses utilisations. Et ses utilisateurs. Pardonnons ses utilisatrices lorsqu’elles se déhanchent à vélo. Le monde technique me fascine depuis que j’y enseigne, soit depuis une trentaine d’années. Si j’avais à écrire sur l’école, ce serait pour remercier mes élèves. Je crois d’ailleurs que le travail de l’écrivain commence et finit par la main. Le cerveau rationnel, celui qui juge, compte et contrôle, est l’ennemi d’une écriture inspirée. Quand j’écris, je rejoins l’ignorance profonde de tout et de tous. Dans On progresse, je m’élève avec humour contre une des aliénations de notre temps : la dictature des objets, manifestation de la bêtise consumériste et technologique. Une question me vient : pourquoi nos contemporains semblent-ils à ce point jouir de leur défaite ? Pourquoi collaborent-ils avec autant d’ardeur à un projet qui n’est pas celui de l’Homme ?
Vous publiez en ce mois d’octobre Je ne suis pas un cadeau … Une sorte d’autobiographie ?
Hélas, non, sauf à admettre que les livres tiennent lieu de biographie. Je ne suis pas un cadeau rassemble des chroniques consacrées aux cadeaux de bienveillance, aux cadeaux de courtoisie et aux cadeaux empoisonnés.
Lesquels préférez-vous ?
Dans la vie, les premiers ; en littérature, le cadeau empoisonné est une bénédiction. D’ailleurs, chaque texte a son dédicataire. Si l’épouse reçoit des fleurs, la veuve se voit octroyer une urne funéraire. La tête d’affiche va au politicien gauchement à droite, le rendez-vous chez le dentiste à son professeur de mathématiques. Le psy de service obtient, lui, un pèse-personne …
Pour quelle raison ?
La surcharge pondérale ne constitue pas le moindre des tracas, surtout dans les pays où l’on mange trop par manque d’amour. Je propose donc une méthode infaillible pour perdre les kilos superflus …
Thérapie par le rire ?
Je souhaite, en effet, que ce livre invite à l’humour, tout en permettant de méditer sur nos vies et nos travers, en offrant un certain plaisir esthétique.
Vous publiez ce livre chez un éditeur bordelais, Finitude. Pourquoi ?
Finitude me semblait le seul éditeur capable de fabriquer un aussi bel objet. De plus, j’ai beaucoup d’affinités avec les auteurs qui figurent à leur catalogue : Jean Forton, Raymond Guérin, Gilles Ortlieb, Marc Bernard, …
Vos projets (à part boire un Orval) ?
J’aimerais enfin réussir la pelure d’un seul tenant lorsque je pratique la pomme de terre. C’est un objectif concret et d’une portée sans doute supérieure à bien des sagesses orientales. Pour le reste, enseignement, nature, musique et amitiés …
Propos recueillis par Christopher Gérard, août 2010
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11 février 2014
Stay behind !
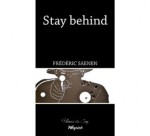
Stay behind ! A la fois injonction vitale et code désignant les réseaux dormants de la guerre froide, quand les services occidentaux organisaient une hypothétique résistance antisoviétique. Stay behind est le deuxième roman du Liégeois Frédéric Saenen, spécialiste de Céline et du pamphlet, remarqué avec La Danse de Pluton comme l’un des espoirs des Lettres mosanes. Je savais, pour avoir recueilli ses confidences entre deux Orval tempérés, que Frédéric Saenen s’était plongé dans l’histoire glauque des années 80, quand la Belgique servit - une fois de plus - de laboratoire dans le cadre d’une stratégie de la tension : groupuscules terroristes plus ou moins bidon, abjectes tueries dans les supermarchés, égorgements et pendaisons « érotiques » de témoins gênants, vols d’armes dans des casernes, ballets multicolores… Unités spéciales et polices plus ou moins parallèles s’en donnaient à cœur joie dans le bac à sable gluant qu’était devenu the Land of Confusion, pour citerle groupe Genesis : un vrai film noir dans le genre Romanzo criminale.
Entre son compatriote Georges Simenon et le rude Ian Rankin, Saenen utilise ce fumier pour bâtir l’étrange roman d’un membre du lumpenproletariat wallon embrigadé dans un groupe paramilitaire qui, pour sauver l’Occident, pratique une forme particulière de tir au pistolet en écoutant Michel Sardou. Sur son lit de mort, l’ancien tireur d’élite se confie à son filleul, qu’il a aimé et protégé comme un fils à la suite d’une promesse scellée par le sang versé. Saenen nous introduit dans les bas-fonds de Liège et de sa banlieue, chez les prolétaires frustrés d’une certaine Wallonie, corrompue jusqu’à l’os. Sa prose sans fioriture, minimaliste et même, à certains moments choisis, proche du slam ou du rap, fait parler ce quart-monde en perdition, où se croisent indicateurs et mythomanes, toqués et pauvres types. Surprenant roman, à mille lieues de l’autofiction (né en 1973, Saenen a donc un alibi en béton) ou des bergeries psychologisantes (même si l’amour s’y cache), le brutal Stay behind glace et désarçonne. Saenen ? Élément dangereux. À surveiller avec attention.
Christopher Gérard
Frédéric Saenen, Stay behind, Editions Weirich, 176 pages, 14€
*
**
Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,
aux éditions L’Age d’Homme
http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0
Frédéric Saenen, La Danse de Pluton, Ed. Weyrich, Neufchâteau 2011, 114 pages.
Qui êtes-vous ? Comment vous définir ?
Le périlleux exercice que voilà ! Au regard de la société civile – donc de la sphère qui, intimement, me connaît le moins – je suis un professeur de français langue étrangère qui officie à l’Université de Liège depuis 1997. Pour les cercles littéraires liégeois et de quelques autres localités belges, un énergumène qui, jusqu’à récemment, lisait à intervalles réguliers des textes personnels, relevant d’une oralité qui n’était pas encore du slam et dont on ne savait s’il fallait en rire, en pleurer, s’en scandaliser, s’en méfier ou s’en ficher.
J’espère, pour ma mère, être un fils aimant et pas trop décevant ; pour mes amours, d’une compagnie supportable ; pour mes amis, quelqu’un de totale confiance. Pendant quelques années, j’ai tenu un journal intime que j’avais intitulé Journal d’un inapte, car c’est bien ainsi que je me vois. En effet, je disparaîtrai de la surface de ce monde sans avoir jamais fait aucun effort pour apprendre à conduire une voiture ou nager. Je suis aussi irréductiblement rétif aux formes modernes de la « com’ » : je ne possède pas de téléphone portable ni ne figure sur aucun réseau social. Ce n’est pas de la pose, juste une incompatibilité majeure entre mon être et tout cela. Né en 1973, j’aurai vécu 27 ans au XXe siècle et, voyez-vous, j’ai du mal à me remettre de cet inconfortable enjambement sur deux ères. Je n’aime pas beaucoup voyager (faire des bagages, faire des démarches pour obtenir un passeport, m’habiller en touriste, très peu pour moi), par contre j’adore flâner, c’est pour ainsi dire le seul moment où je me sente parfaitement libre et en totale disponibilité.
Je ne vais pas m’aventurer sur le terrain des « qualités », car je n’ai comme tout le monde que celles de mes défauts. Certains me disent généreux, alors qu’en réalité je ne suis sans doute que dispendieux. Certains me croient indéfectiblement optimiste sous prétexte que j’ai le rire sonore et cascadant... Enfin, je dirais que je déteste être comptable (de mon temps, de mes faits et gestes). Difficile quand on est un modeste sujet du Règne de la Quantité !
Les grandes étapes de votre itinéraire intellectuel ? Les grandes lectures ? Céline ?
Si j’ai un quelconque « itinéraire intellectuel », il se rattache à mes lectures, que j’ai toujours menées « en dehors » des obligations scolaires ou professionnelles : je n’aurai fait aucune découverte bouleversante parmi ce qu’il me fut imposé de lire. Ma première grande révélation littéraire fut celle de Céline, un auteur à qui je suis venu par… Sartre, qu’adolescent je dévorais et dont la citation de L’Église en exergue de La Nausée avait éveillé ma curiosité. La voix qui s’exprime dans le Voyage… m’est entrée dans l’esprit et j’ai ressenti, bien avant de le lire dans ses interviews ou ses écrits ultérieurs, ce phénomène voulu par Céline lui-même, à savoir que son lecteur ait l’impression que le texte lui est énoncé « de l’intérieur ». Plus encore que la dimension « orale-populaire », c’est l’importance cruciale que Céline accorde à l’intériorité qui m’a fasciné. Une phrase toute simple, d’apparence banale même, et qui figure dans les premières pages de Voyage… m’a marqué à vie : « Tout est permis en dedans ». Cet aphorisme, plutôt ce constat, dépasse à mon sens de loin la pure revendication égoïste ou individualiste. Il m’a persuadé que là se situait la zone d’où tirer le plus de matière première, dans le « dedans ». Le dehors, c’est simulacre, déception ou pire, fade redite de ce que l’on porte déjà en soi.
Fréquentant très peu la poésie (à part Michaux et Pessoa que j’ai un peu plus pratiqués), je dirais que mes plus grandes expériences de lecture sont d’ordre romanesques : il y a l’immersion dans La Recherche de Proust, dans tout Faulkner, dans les monologues hypnotisant de Thomas Bernhard. J’aime ces figures d’infatigables travailleurs parce qu’ils ont forgé des œuvres totales et d’une grande force de cohésion (malgré les faiblesses du dernier Faulkner, dans le cycle des Snopes par exemple). Ce sont à mes yeux des textes fondateurs, en connexion avec une dimension universelle, manifestant une appréhension aiguë de la perception du temps, et qui procurent une espèce d’extase par la seule magie du langage qui y est déployé. Ces quelques-uns incarnent à eux seuls la Littérature majuscule, pour moi.
En outre, il y a une myriade de stylistes parfaits – comme Aymé, Morand, Bloy, Lorrain, Léon Daudet – ou de « tempéraments » magnifiques – Cossery, Meckert, Montherlant, Darien, Mirbeau – auxquels je reviens sans cesse. Je les cite en vrac, et j’en oublie forcément beaucoup (vu que je ne cite là que des auteurs du domaine français). Parmi les Belges enfin, je citerais en priorité André Baillon, parce qu’il est un des rares écrivains « d’ici » à rendre justement cette voix intérieure à laquelle je suis si sensible. En réalité, l’histoire des lettres belges m’intéresse plus que ses manifestations concrètes. À part quelques chefs d’œuvres comme Thyl Ulenspiegel et La Nouvelle Carthage, j’ai l’impression que la littérature belge nourrit plus ma mémoire que ma sensibilité proprement dite. Je m’en voudrais enfin de ne pas évoquer celui que j’ai vraiment découvert suite à quelques conversations avec l’ami Christian Libens, à savoir Simenon, qui a signé avec Les Complices le roman sur la paranoïa du coupable le plus abouti qui soit, et avec Lettre à ma mère la plus terrible des confessions de fils meurtri.
Les grandes rencontres ?
J’en retiendrai deux, même s’il serait tentant d’en évoquer des dizaines. La première, c’est celle de Jacques Izoard, qui a été déterminante pour moi dans la reconnaissance de ma « poésie ». J’ai rencontré Jacques en 1996, alors que, fraîchement diplômé, je faisais un bref remplacement dans l’école où il était lui-même professeur de français. Il a accepté de découvrir mes premiers textes, m’a encouragé à lire en public lors des soirées du « Jardin du paradoxe », le Cirque d’Hiver (une pratique de diffusion de la littérature que j’ignorais complètement à l’époque), m’a présenté à d’autres personnes, m’a conseillé de me rendre à l’annuel Marché de la Poésie de Paris et d’y déposer mon manuscrit… Jacques était un homme très complexe, cultivant un sens particulier du secret autant que celui, surdéveloppé chez lui, de l’entregent. Je ne sais pas si je peux me targuer d’avoir été de ses proches, quoi qu’il en soit je n’ai jamais été de ces courtisans ou saprophytes qui gravitaient autour de son imposante personnalité. J’adorais converser avec lui en tête à tête, il avait une culture phénoménale mais qu’il dissimulait modestement sous une image de poète un peu distrait, maladroit. Il adorait « jouer » en société, et là, il valait mieux ne pas être dupe de ses facéties, ou du moins rester prudent, parce que cela pouvait mener très loin. Jacques fut pendant pas moins de quatre décennies le pivot, pour ne pas dire le pilier, de l’activité poétique liégeoise. Sa disparition a laissé un grand vide qui, alors même qu’aujourd’hui les hommages locaux fleurissent, ne sera pas comblé de sitôt. Il me manque. Combien de rues, que j’emprunte quotidiennement à Liège, me le ramènent à la mémoire, pour les avoir sillonnées avec lui, à des heures souvent indues…
La seconde rencontre est celle de Frédéric Dufoing. En voilà un autre d’énergumène, et complexe, et atypique. Nous sommes amis depuis une bonne quinzaine d’années maintenant et je dois dire que l’aventure, si éphémère fût-elle, de la revue de critique Jibrile, que nous avons lancée en 2003 et qui a vécu le temps de six livraisons papier, m’a changé. Je n’aurais pu la mener avec personne d’autre que lui. Frédéric, philosophe de formation, est un érudit bouillonnant doublé d’un pédagogue hors pair. Il m’a ouvert, comme nulle source livresque, à l’histoire des idées et des systèmes politiques, et nous partageons, entre pulsions anarchistes et cabrements un tantinet réacs, maintes vues sur le monde moderne. Nos divergences sur le sujet arrivent tôt ou tard à se rejoindre, par un chemin ou l’autre, et nos positions respectives quant à des considérations d’ordre moral, parfois plus difficilement conciliables, se rapiècent dans un éclat de rire ou un de ces « bah ! » souverain comme lui seul peut en émettre. Il a de surcroît une écrasante culture cinématographique et musicale dans laquelle je puise allègrement pour combler mes lacunes en la matière – car, en dehors de ma culture de papier, j’ai longtemps été, et je reste en grande part, un homme de fort mauvais goût, ayant un penchant prononcé pour la daube commerciale des années 80 et les films d’action hollywoodiens.
Vous avez commencé par publier des recueils de poème. Quels furent vos initiateurs, vos modèles ?
Aussi présomptueux que cela puisse paraître, je ne pense pas vraiment en avoir. Au moment où j’ai commencé à gribouiller jusqu’à fort tard le soir des textes hermétiques, censés rendre mes malaises et mes angoisses d’adolescents, je ne lisais que très peu de poésie, mais des livres d’histoire ou, je l’ai dit, des romans. Les centaines de pages (parfois semées de quatre mots, guère davantage) que j’ai sécrétées pendant cinq ans, entre mes seize et mes vingt-et-un ans dirons-nous, je les ai jetées, non pas dans un mouvement de révolte à la Gainsbourg crevant ses toiles, mais bien parce que je me suis brutalement rendu compte que c’était affreusement nul et qu’il fallait tamiser. Les quelques pages qui survécurent à mon auto da fé en chambre et que je retravaillai ont servi de base au recueil qui deviendrait Seul Tenant, publié chez L’Harmattan en 1998.
Ce qui a par contre plus conditionné l’amplification de mon écriture poétique que la découverte d’un auteur, c’est le fait d’être passé de poèmes très serrés, destinés à la publication sur papier, à la pratique de plus en plus fréquente de la lecture en public, surtout vers 2000-2001, lorsque le Big Band de Littératures féroces s’est cristallisé autour d’un autre ami, Christian Duray. Pendant deux ans, j’ai écrit des proses mi-poétiques mi-pamphlétaires que je performais. Ces textes ont été en partie inclus dans le recueil Qui je fuis, publié en 2003 par les éditions de la revue liégeoise Le Fram. Mais beaucoup de ces textes n’ont existé qu’oralement, ou alors dans des revues disparates. J’en ai un recueil inédit complet, Delenda.
Vous publiez aujourd’hui un Dictionnaire du pamphlet. Quelle en est la genèse ? Quid de votre méthode ?
Comme je vous l’expliquais plus haut, mon écriture personnelle, a très souvent comporté des aspects relevant du pamphlet ou, plus généralement de la polémique. C’est en effet l’amour du style qui m’a poussé à m’intéresser à ce genre, qui peut être souvent très « poétique » et où le style se marie aux passions et aux idées, pour le meilleur comme pour le pire. En fait, je me suis aperçu qu’il existait peu de documents un tant soit peu « synthétique » consacré à ce genre, dont j’étais déjà un lecteur friand et dont je possédais de nombreux exemples dans ma bibliothèque. L’étude de Marc Angenot, publiée au début des années 80, reste incontournable à bien des égards, mais elle aborde, comme son titre l’indique, « la parole pamphlétaire » sous ses virtualités et ses réalisations stylistiques. Je voulais pour ma part réaliser une étude d’histoire littéraire, consacrée aux auteurs qui auraient commis un ou des pamphlets, parce que j’aurais aimé découvrir dans quelles circonstances de leur existence de grandes figures ressentaient soudain l’urgence d’écrire un pamphlet…
J’ai finalement adopté la forme dictionnairique dans un second temps alors que mon idée initiale étant de réaliser un essai sur le pamphlet. Je me suis rendu compte, après quelques mois de travail, qu’une présentation linéaire ne tenait pas la route, tout simplement parce qu’elle allait provoquer des redites très lourdes, forcément ennuyeuses pour le lecteur. Prenons un auteur comme Bernanos, qui a publié d’exemplaires « écrits de combat » avant et après la Seconde Guerre mondiale ; allais-je devoir parler de ses Grands Cimetières sous la lune en relation avec la Guerre d’Espagne, puis revenir à lui au moment de parler de La France contre les robots ? Je crois qu’un dictionnaire met mieux en évidence la dichotomie qui existe entre pamphlétaires « occasionnels » et « vocationnels ». C’est d’ailleurs cette distinction qui m’a aussi empêché d’intituler ce livre « Dictionnaire des pamphlétaires », parce qu’un Zola, un Hugo ne peuvent se réduire à cette dimension exclusive, leur pamphlet étant un domaine supplémentaire d’exercice de leur talent. On s’aperçoit bien, je crois, à la lecture des notices, que ce genre est très étroitement lié au contexte qui le suscite, mais aussi à la personnalité, au tempérament, de l’auteur qui le produit. Voilà pourquoi j’ai tenté d’équilibrer mon approche entre constats généraux (dans l’introduction) et « cas particuliers » (dans les notices)…
Quelles conclusions tirez-vous de cet impressionnant travail ? L’heure des grands imprécateurs est-elle (définitivement) passée depuis …? Qui ?
Je pense que, effectivement, le pamphlet, s’il n’est pas une genre mort, s’est en tout cas dilué dans le bavardage généralisé. Le point de basculement n’est pas marqué par une personnalité – qui aurait couronné le genre en le portant à un point de non-retour, à un horizon indépassable – mais bien par révolution dans notre rapport à l’écrit et à la communication, depuis l’avènement des téléphones portables et d’Internet. Ces technologies ont en effet ouvert la boîte de Pandore en « libérant » à outrance la parole, ce qui ne peut aller de pair qu’avec une dévalorisation (de son orthographe, de sa syntaxe, de son style, etc.).
Il n’y a plus de grands imprécateurs à la Bloy ou à la Céline, tout simplement parce que les propos d’esprits, si lucides et / ou si tonitruants soient-ils, sont emportés, tsunamisés en quelques heures, au mieux quelques jours, par le flux d’informations continues qui s’abat sur nous. Et puis, dire les choses en outrepassant un certain registre lexical peut considérablement vous nuire, sur le plan juridique s’entend, puis sur le plan social.
Les pamphlétaires ne sont jamais des à-quoi-bonnistes, ils sont animés par une foi rabique qui les porte dans leur croisade de mots. Or l’époque sécrète deux poisons qui contrecarrent un tel baroud : l’indifférence et la culpabilité. Comment ? Les indignations droits-de-l’hommistes, qui font les belles heures des JT, passent de mode en un éclair, ne s’ancrent plus dans les esprits. Ainsi, pendant quinze jours, l’on vous parle des Bouddhistes massacrés par les Chinois, puis on se focalise sur le Darfour pendant la quinzaine suivante, et la chanson de Dutronc passe en musique de fond de tout cela : « J’y pense et puis j’oublie, c’est la vie, c’est la vie… ».
Les médias provoquent ce double effet pervers, qu’ils nous rendent parfaitement indifférents à des causes majeures à force de les ressasser et dans le même temps font naître en nous la mauvaise conscience de ne plus nous en soucier (en général, « s’en soucier » signifie « verser de l’argent sur le compte bancaire qui apparaît en bas de l’écran et faire ainsi preuve d’un formidable élan de générosité »).
L’humanité actuelle a besoin en permanence, pour se distraire d’un quotidien anesthésiant, de scandales, de révélations, de buzz ; pour cela, les dépêches de Yahoo ! suffisent. Alors ingurgiter un livre (trop) bien écrit, avec des mots compliqués ou rares et des phrases à rallonge, et se casser la nénette à décrypter le réel, vous pensez si l’exercice n’a plus guère d’intérêt…
L’information ravage l’esprit critique. L’hyper-information ravage cette forme supérieure d’esprit critique (avec bien sûr ses outrances, ses dérives et ses aberrations) qu’est le pamphlet.
Vous vous êtes également lancé dans l’écriture de nouvelles que vous qualifiez curieusement de « taiseuses » ? Quid ?
Le recueil, publié en mars 2010 assez confidentiellement par les Editions Le Grognard de Stéphane Beau, s’intitule Motus, titre éponyme d’une des nouvelles. Les personnages en présence ont tous, de près ou de loin, partie liée avec un certain silence, soit imposé cruellement, soit assumé en résistance à l’agression du dehors ou du blabla généralisé. J’ai en effet qualifiées ces proses de « taiseuses », car j’aime ce belgicisme moins ténébreux à mon oreille que le « taciturne » français. En « taiseuses », je vois des incarnations de mes narrations brèves : des petites filles, sagement assises et qui tiennent les lèvres closes sur quelque chose qui les dépasse tant qu’elles ont du mal à l’exprimer.
Vous êtes enfin connu, mais oui, comme un critique littéraire exigeant. Quelle est votre ligne de conduite ?
La critique littéraire doit, à mon sens, rester un exercice de style autant que de précision.Pour ma part, je me fais un devoir de servir le texte que j’ai apprécié en abordant toutes ses dimensions (thème(s), narration, style, ton, etc.) et en le citant à bon escient pour en faire percevoir la « voix » unique que j’y ai perçue. Écrire à propos d’un livre me permet de l’intégrer bien plus en profondeur que si je le « bouquinais » pour mon simple agrément. J’essaie aussi, tant que faire se peut, de mettre en évidence le travail des préfaciers, des traducteurs, des éditeurs eux-mêmes. Un livre est un tout, qui vient coïncider, parfois de façon magique, au moment exact de notre vie où il s’agissait de le découvrir. C’est une rencontre dont j’aime à relater les moments les plus croustillants, les plus intenses. Pour une « descente en flammes », c’est plus complexe. J’accorde beaucoup d’importance à la bonne ou à la mauvaise foi que je crois déceler dans la démarche de l’écrivain, de l’essayiste, du biographe, etc. Rien de plus pénible que les œuvres de convenance ou de complaisance ; ce sont en général les cibles de mes courroux (rares, car le silence est un bien plus efficace agent de la destruction dans un monde où l’adage qui prévaut est « Il vaut mieux en parler en mal que pas du tout. »). Dans ce dernier cas donc, ma ligne de conduite est de lire intégralement le livre, et surtout de n’en rien laisser passer qui pourrait infirmer mes conclusions à son encontre. Je m’efforce de m’attaquer aux défauts du texte in se et pas à son auteur (quoique, parfois, la chose soit fort malaisée à débrouiller). À moins que l’ouvrage soit encensé par la grande presse, je me refuse en général à la gratuité qui consiste à torpiller le livre d’un écrivain débutant ou publié dans une structure éditoriale modeste. Par contre, quel plaisir de ne pas aller dans le sens des unanimités béates et des louanges fallacieuses que l’on trouve en quatrième de couverture, voire sous la plume d’autres éminences critiques !
Dernier détail : un travers que je tente à tout prix d’éviter parce qu’il m’horripile est celui qui consiste à comparer un auteur avec un autre, en général mort, et croire que le parallèle suffit à fonder la critique. Invoquer les mânes d’un grand ancien, comme cela se fait sur les plateaux de télé quand on est soi même à court d’idée, m’apparaît comme la dernière des facilités. S’il n’y a rien à dire d’autre d’un romancier qu’il se situe « entre Bove et Vialatte » ou qu’il évoque « un Kafka japonais », autant tout de suite déclarer forfait, non ? Le degré zéro de l’analyse est atteint.
Vos projets ?
L’un, en cours : un essai, toujours chez In Folio, sur les écrivains de la collaboration, et qui sera prêt, si tout va bien, d’ici un an et demi.
L’autre, rêvé : un roman.
Propos recueillis par Christopher Gérard
Février MMXI
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature belge, littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27 janvier 2014
Le retour de Camille Lemonnier
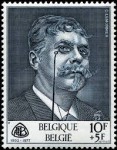
Tour à tour qualifié par ses jeunes confrères de Maréchal des Lettres et de « macaque flamboyant », le très prolifique Camille Lemonnier (1844-1913) se morfond depuis son trépas, juste avant le grand cataclysme, dans un purgatoire immérité. Celui que Flaubert, Huysmans et Zola saluèrent comme un maître passe encore pour un épigone. Paie-t-il, lui qui fut le premier écrivain belge à vivre de sa plume, une fécondité - plus de septante volumes de contes, de romans et d’essais - qui, dans une contrée étriquée, évoque l’ogre plutôt que le sacristain ? Est-il victime, l’auteur du scandaleux Un Mâle, de la cabale des spécialistes, ce colosse qui incarna successivement - quelle audace ! - le naturalisme le plus brut, l’exquise décadence et le primitivisme ? Sa sensualité sans fards, qui lui valut l’ire des puritains de son temps (au pouvoir avec le Parti catholique), a-t-elle laissé des traces dans l’inconscient belge ? Son style baroquisant, ce fameux belgimatias que dénonçait Jean Lorrain, son goût de l’excès agacent-ils nos délicats palais ? Mystère. Le fait est là : il existe un gisement Lemonnier, hélas ! ignoré du public lettré.
Deux livres remarquables de probité fêtent le centenaire de sa mort et annoncent peut-être son retour. Tout d’abord l’imposante biographie, d’une précision maniaque, que lui consacre le romaniste Philippe Roy après vingt ans de recherches - un travail de bénédictin. L’auteur, qui a dépouillé des tonnes d’archives souvent inédites, y suit pas à pas Camille Lemonnier, depuis ses premiers articles dans la presse bruxelloise jusqu’à sa production parisienne. Il étudie par le menu ses relations avec les artistes de son temps, qui fut aussi l’âge d’argent des Lettres belges, quand Bruxelles constituait en Europe un pôle de création dans tous les domaines. Car Lemonnier a connu tout le monde, de Victor Hugo (qui était à ses yeux un mixte de Pan, de Jéhovah et de Bouddha) à Emile Verhaeren.
Ensuite un recueil de 124 nouvelles (sur les 558 recensées), généralement publiées dans la presse parisienne et dont l’action se déroule à Paris, dans les Ardennes et les Flandres. Ces courtes fictions, très variées, où Lemonnier fait preuve d’un sens aigu de l’observation et d’une belle fantaisie, font songer à un Maupassant belge. Voilà peut-être la formule à retenir : Lemonnier ou le Maupassant belge.
Christopher Gérard
Philippe Roy, Camille Lemonnier, maréchal des lettres, préface de Jean de palacio, Académie royale, 370 p., 22€
Camille Lemonnier, La Minute du bonheur, textes réunis par Jacques Detemerman et Gilbert Stevens, préface d’André Guyaux, Académie royale, 430 p., 22€
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, belgique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27 février 2013
Qui se souvient d'Albert Cossery ? Frédéric Andrau.
Qui se souvient d’Albert Cossery (1913-2008), cet écrivain égyptien de langue française qui vécut 56 ans dans une chambre d’hôtel à Saint-Germain-des-Prés ? Un jeune écrivain au moins, Frédéric Andrau, qui lui adresse, d’homme à homme, un émouvant salut où il retrace une vie sédentaire à l’extrême, car bornée par le Café de Flore, la brasserie Lipp, la rue de Buci et les jardins du Luxembourg. Né au Caire d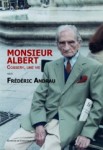 ans la bourgeoisie copte, Albert Cossery se découvre très jeune une vocation d’écrivain à laquelle il sacrifie tout : à part les huit livres qu’il publie en soixante-cinq ans, il refusera toute forme de travail et, non sans cohérence, tout statut social, toute propriété matérielle, puisque, à sa mort, ses biens - cravates, pochettes, chaussettes de luxe et vieilles photographies - seront empaquetés dans trois cartons. Après avoir fréquenté le Lycée français et les cercles surréalistes du Caire, Cossery s’installe à Paris en 1945, où, grâce au soutien précoce d’Henry Miller et d’Albert Camus, il se fait rapidement un nom. Noceur infatigable, séducteur aux yeux de braise, il choisit l’oisiveté absolue comme art de vivre et le bronzage comme discipline, pareil aux chats des temples de l’Egypte ancienne. Indifférent à la politique, il lit Stendhal, Céline et Gorki en menant une vie essentiellement nocturne, aux côtés de Genet et de Nimier, de Piccoli et de Greco. Pique-assiette, gigolo et écrivain des bas-fonds du Caire, qui inspirent tous ses romans, car par un plaisant paradoxe, cette légende du microcosme germanopratin n’écrit que des histoires égyptiennes ! Pas une ligne sur les boîtes existentialistes ! Pas un mot sur Sartre et consorts ! Une figure singulière du milieu littéraire, qu’il ignorait superbement. Une sorte de sybarite fasciné par la torpeur, adonné au culte - horizontal - du soleil. Un rêveur à l’élégance voyante, que l’on suit pas à pas, charmé par la musique lancinante de son fidèle biographe.
ans la bourgeoisie copte, Albert Cossery se découvre très jeune une vocation d’écrivain à laquelle il sacrifie tout : à part les huit livres qu’il publie en soixante-cinq ans, il refusera toute forme de travail et, non sans cohérence, tout statut social, toute propriété matérielle, puisque, à sa mort, ses biens - cravates, pochettes, chaussettes de luxe et vieilles photographies - seront empaquetés dans trois cartons. Après avoir fréquenté le Lycée français et les cercles surréalistes du Caire, Cossery s’installe à Paris en 1945, où, grâce au soutien précoce d’Henry Miller et d’Albert Camus, il se fait rapidement un nom. Noceur infatigable, séducteur aux yeux de braise, il choisit l’oisiveté absolue comme art de vivre et le bronzage comme discipline, pareil aux chats des temples de l’Egypte ancienne. Indifférent à la politique, il lit Stendhal, Céline et Gorki en menant une vie essentiellement nocturne, aux côtés de Genet et de Nimier, de Piccoli et de Greco. Pique-assiette, gigolo et écrivain des bas-fonds du Caire, qui inspirent tous ses romans, car par un plaisant paradoxe, cette légende du microcosme germanopratin n’écrit que des histoires égyptiennes ! Pas une ligne sur les boîtes existentialistes ! Pas un mot sur Sartre et consorts ! Une figure singulière du milieu littéraire, qu’il ignorait superbement. Une sorte de sybarite fasciné par la torpeur, adonné au culte - horizontal - du soleil. Un rêveur à l’élégance voyante, que l’on suit pas à pas, charmé par la musique lancinante de son fidèle biographe.
Christopher Gérard
Frédéric Andrau, Monsieur Albert. Cossery, une vie, Editions de Corlevour, 20€
PS : Deux erreurs à corriger dans le deuxième tirage: Le Grand d'Espagne, de Roger Nimier, n'est pas un roman; et Lipp ne sert heureusement pas de sodas.
PPS : Bravo à l'attachée de presse, Guilaine Depis, pour son enthousiasme communicatif !
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16 janvier 2013
Post Mortem, d'Albert Caraco
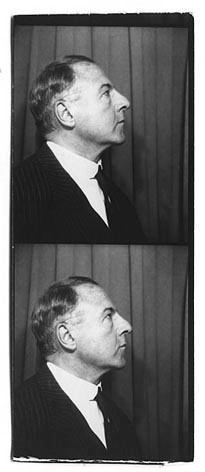
Des aphorismes tels que « La conservation d’un beau fauteuil m’importe plus que l’existence de plusieurs bipèdes à la voix articulée » ou « Les êtres nobles aiment rarement la vie ; ils lui préfèrent les raisons de vivre et ceux qui se contentent de la vie sont souvent des ignobles » donnent une idée du bois dont se chauffait Albert Caraco (1919-1971). Né à Constantinople dans une famille juive, Caraco vécut en Allemagne et à Paris avant de connaître un prudent exil en Uruguay pendant la guerre, où il apprit l’espagnol, perfectionna son anglais et se convertit au catholicisme. Revenu à Paris en 1946 et libéré de tout souci financier grâce à la fortune paternelle, il passa toute sa vie d’homme à écrire six heures par jour, à lire et à se promener avec Madame Mère et, surtout, à méditer sur sa haine de la vie et sa suite logique, le suicide. Car, contrairement à Cioran, à qui il peut faire penser, l’humour en moins, Caraco alla jusqu’au bout : quelques heure à peine après la mort de son père, il se trancha la gorge, couvrant les murs de son sang. Caraco laissait une malle de manuscrits à son ami Dimitri, le fondateur de l’Âge d’Homme, qui me confiait posséder encore le chapeau de Caraco alors qu’il m’offrait, dans sa librairie mythique de la rue Férou, l’édition originale de Post Mortem.[1]
C’est précisément Post Mortem que réédite L’Âge d’Homme dans sa collection Revizor[2] : la couverture bleue s’orne d’un portrait de ce gentleman sépharade, tiré à quatre épingles et d’allure sud-américaine. L’homme connaissait à la perfection la fine fleur de quatre littératures, ne se nourrissant que de gelée royale : Shakespeare et Montesquieu, Nietzsche et le Siècle d’Or espagnol. Dimitri découvrit Caraco en 1959 alors que, jeune libraire à Neuchâtel, il avait remarqué ses premiers essais, publiés à la Baconnière. Par une heureuse coïncidence qui joua un rôle dans son destin d’éditeur, il devint l’ami de Caraco, qu’il comparait à Schopenhauer ou à Spengler, « des penseurs, pas des philosophes professionnels ; des témoins d’une crise grave de l’Occident, (…) excessifs et contradictoires ». Bien que « cordial et malicieux », Caraco lui apparut comme possédé par un dégoût absolu de la vie.
Rien de construit ni de feint chez ce pessimiste glacial qui, dans une langue d’une sobriété monastique, traduisait par une œuvre pléthorique son amer dédain, son dégoût du sexe (« ni mignon ni maîtresse ») et sa religion de la continence, son mépris général, de l’Arabe (« le Coran est la honte de l’esprit humain ») au Juif (« parasite nécessaire et grouillant dans les plaies de ceux qui l’ont dévoré » mais aussi « colonne vertébrale de la race blanche ») en passant par le Chrétien : « L’Eglise, l’Islam et le Judaïsme, je les appelle trois poisons ; les divers paganismes m’agréent davantage, celui des Grecs fut admirable, celui des Celtes charmant ». Réactionnaire sans complexe, mais anticlérical comme Voltaire (« l’Eglise est le cancer moral de la race blanche »), nostalgique de la monarchie comme Joseph de Maistre, gnostique et puritain, Caraco incarna la troublante figure du Sémite judéophobe, à la fois lecteur hilare des pamphlets de Céline et prophète du salut de la race blanche par les Juifs. Bref, l’un des authentiques maudits de notre littérature, brutal et sans concession pour la comédie sociale (sans parler de celle du milieu des lettres) - et servi par un style classique, sans précautions ni fioritures (« les ombres de la mort sont les épices de l’amour »). Un astre noir.
Post Mortem est un livre à part dans cet étrange corpus : le fils fait ses adieux à Madame Mère, qu’il vient de perdre, victime d’un cancer. Cette femme qui invoquait la lune tous les mois en tenant de l’or ( !) lui inculqua dès son plus jeune âge un mépris abyssal des femmes et de leur corps, toutes traîtresses et intéressées, des Mélusine fermées à l’Esprit (mais Caraco ne nourrissait pas la moindre illusion sur les mâles, qui « se situent aussi bas, quand ce n’est au-dessous »). S’il avoue quelques émois, vite réprimés, Caraco tient à ce qu’il appelle « sa vie sombre et militante », car, écrit-il, « j’avais un pan de muraille à garder ». Castré par Madame Mère, Caraco fit de sa chasteté une religion, qu’il justifiait par son horreur de soi, du monde et de la vie. Aima-t-il Madame Mère ? Il semble fléchir, se laisse aller un instant à ce qui peut sembler de la tendresse pour se reprendre avec vigueur : nulle sensiblerie dans cet adieu, rien de convenu non plus, mais l’autopsie d’une relation fusionnelle qui dura quarante-quatre ans. Post Mortem est le cénotaphe qui arrache la défunte au néant et qui fait d’elle de son auteur.
Post Mortem peut se lire comme l’aveu d’un interminable inceste cérébral (« elle me fit un devoir de rester enfant »), comme le retour sur des embrassements d’ampleur « statistique », voire comme une propédeutique précédant la mort volontaire : « vous m’avez refroidi, c’était le plus grand des services à me rendre ».
Une dernière citation, pour la route : « Les mères servent à nous affranchir des femmes, les œuvres servent à nous libérer des mères ».
Christopher Gérard
Albert Caraco, Post Mortem, L’Age d’Homme, 12€.
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







