26 février 2008
Guy Dupré, clandestin capital
Concernant cet écrivain, voir mon Journal de lecture,
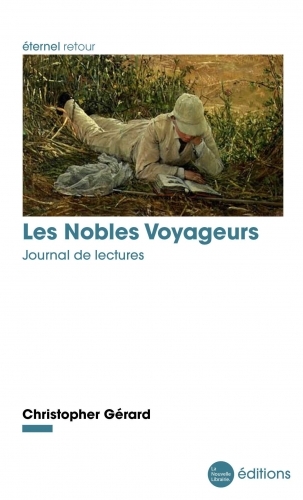
Entretien avec Guy Dupré
Christopher Gérard: Qui êtes-vous? Toute votre œuvre, essais et romans confondus, témoigne d'une puissante nostalgie, celle d'un Ordre mystique et guerrier. Quelles sont les racines de cette double vocation sacerdotale et militaire?
Historiquement parlant, j’appartiens à la première génération française d’anciens non combattants. J’étais de l’une des trois classes exemptées du service militaire pour avoir été touchées, pour ceux qui n’étaient pas étudiants, par le S.T.O. À l’âge de Guy Môquet j’étudiais l’Énéide au lycée Henri IV dans la classe de Georges Pompidou. Un de mes camarades de seconde, au collège de Saint-Germain-en-Laye, Marco Menegoz, rejoignit un maquis en 44 : fusillé sans qu’on ait donné son nom à une station de métro. Autre condisciple, Pierre Sergent, engagé en 44 et devenu capitaine dans la Légion étrangère ; lors du putsch d’Alger, il rallia ceux que le général de Gaulle a appelé les « officiers perdus ». Un autre, Michel Mourre, affilié à dix-sept ans au francisme de Marcel Bucard, entra au séminaire, y perdit la foi, et se retira d’une autre façon du siècle en s’attelant à son monumental Dictionnaire d’Histoire universelle. J’avais dû, pour ma part, mes rations de survie aux Baudelaire et Rainer Maria Rilke, aux Normands Flaubert et Barbey d’Aurevilly, aux Apollinaire et Milosz qui n’avaient pas une goutte de sang français dans les veines. Sans prétendre à substituer la satiété à la disette, j’entrai dans l’après-occupation avec la volonté de me revancher sur les années de rationnement et dénutrition qui avaient menacé mes sources vives. A mon aversion pour les sectateurs de l’absurde, sartreux et camusards, se liait mon rattachement intérieur à l’ordre militaire mort à Hiroshima, où naquit la mère de mon père. Une sorte d’obligation de participer au Vème acte de l’armée sur les théâtres d’opérations extérieures, en supplantant dans son ton le souffleur. D’exprimer à ma façon « le trouble de l’armée au combat » selon l’expression du général de Gaulle, dont le général Weygand, qui lui non plus n’avait pas une goutte de sang français dans les veines, me disait qu’il « n’avait pas trop de deux églises à Colombey pour s’y confesser de ses péchés ». Au croa-croa des corbeaux au col Mao ce serait préférer le chant du cygne de l’antique honneur militaire. Chant du cygne qui me mettait dans tous mes états – ces états qui me feraient remonter jusqu’aux débuts de la guerre franco-française, commencée avec la dégradation du capitaine Dreyfus pour finir avec l’exécution du colonel Bastien-Thiry. L’honneur du capitaine Dreyfus est de n’avoir jamais été dreyfusard. Le péché de Barrès, comme celui du Bernanos de La grande Peur des Bien-Pensants, est de n’avoir pas compris que Dreyfus était de leur bord, lié par le secret professionnel, et qu’il importait de l’isoler, de le détacher de son parti, pour honorer en lui l’officier perdu, l’officier sauvé d’un chapitre inédit de Servitude et grandeur militaires.
Parmi les constantes de votre œuvre, il y a cette loi de Sainte-Beuve. Comment s'est-elle imposée à vous?
C’est dans son unique roman, Volupté, que Sainte-Beuve, qui fit Hugo cocu, a placé dans la bouche de son héros Amaury l’énoncé de ce que j’ai appelé la « loi de Sainte-Beuve ». Amaury, né dans les dernières années da la monarchie, raconte à un jeune ami les souvenirs de jeunesse de sa propre mère : « Comme les souvenirs ainsi communiqués nous font entrer dans la fleur des choses précédentes et repoussent doucement notre berceau en arrière ! » Pour nous, retourner vers la mémoire d’avant, ce serait le temps que nos mères apprirent à épingler de petits drapeaux sur la carte des départements envahis. Trop jeunes pour devenir veuves, elles correspondirent avec le promis dont elles étaient les marraines de guerre. Entre la communauté des « morts pour la patrie » et nos esseulements, une transfusion s’opérait. Nous n’aurions pas trop de cette jeunesse souterraine pour réchauffer l’hiver de la feue France. Quant à la querelle entre maréchalistes et généralistes, comment aurions-nous pu opposer le général me voici au maréchal nous voilà ? Pareils à ces tritons barbus, ces monstres marins que Marcel Proust entrevoyait à l’Opéra, dans l’ombre transparente de la baignoire de la princesse de Guermantes, et dont on n’aurait su dire s’ils étaient en train de pondre, nageaient ou respiraient en dormant. Comment les jugerions-nous, les opposerions-nous, quand, à nos yeux, leur justification secrète était de nous entretenir dans le mystère douloureux et glorieux d’où tout découle et qui s’appelle le mystère du temps ?
Votre premier roman, Les Fiancées sont froides, s'inspire du romantisme allemand bien plus que du surréalisme. Thanatos me paraît la figure tutélaire de ce livre ensorcelant, et la désertion l'un de ses thèmes principaux. Après vingt-huit ans de retraite, vous publiez Le grand Coucher, un peu votre Guerre civile. Avec Les Mamantes, vous développez le thème de la Mère (si possible veuve), préférable à la Fille (si possible vierge). Peut-on y voir le reflet d'une obsession, celle du refus d'engendrer? En fin de compte, l'écrivain n'est-il pas souvent fils et père de personne?
Dans chacun de mes trois romans le narrateur s’adresse à l’autre : dans Les Fiancées sont froides le hussard devenu écrivain public s’adresse à un hussard qui pourrait être son fils et qui a lui-même déserté ; dans Le Grand Coucher le récitant dédie son mémoire à la veuve qui servait d’appeau au colonel recruteur ; l’amant en deuil des Mamantes explique à une jeune vivante pour quelles raisons occultes il a si longtemps refusé de lui faire l’amour « à la papa ». Il y a chez les trois désertion, abandon de corps, refus de reconnaître le père comme le fils – trahison de l’histoire humanoïde au profit d’une affiliation d’ordre extra-mondain. Il leur faut transgresser la loi naturelle, substituer à la loi du sang qui régissait l’ancien pacte social la règle d’une transmission elle-même garante d’une filiation élective.
Quel regard jetez-vous sur les Lettres françaises d'aujourd'hui? Quelles lectures conseilleriez-vous à un impétrant?
Même en littérature, disait Barrès, il y a avantage à n’être pas un imbécile. Nuançons le propos : « Il y a avantage, en littérature, à ne pas entrer dans la descendance de Monsieur Homais » - avantage à ne pas prendre les lampions du 14 juillet pour les lumières du siècle. « Je m’ennuie en France, disait Baudelaire, parce que tout le monde y ressemble à Voltaire ». Aujourd’hui comme avant-hier la référence aux « lumières » est un cache-misère et le laïcisme dévot la canne blanche dont les mal-voyants se font un gourdin. A l’âge où je ne voyais pas très clair, trois livres m’avaient aidé à remettre la pendule à l’heure : Les Sources occultes du romantisme, d’Auguste Viatte ; L’Âme romantique et le rêve, d’Albert Béguin ; La Poésie moderne et le sacré, de Jules Monnerot. A ce trio salvateur, permettez-moi d’ajouter le théologien allemand H. Urs von Balthasar, dont Albert Béguin m’avait cité ce passage sur le temps que j’aimerais choisir comme épigraphe et épitaphe : « Des temps et des destins antérieurs reçoivent leur sens de temps et de destins ultérieurs, les temps antérieurs sont si peu enfermés dans le moment de la durée qu’ils ont occupé et si peu irrévocablement passés qu’ils restent au contraire directement accessibles en tout temps. Et cet accès est de telle nature qu’il détermine leur essence – passée seulement en apparence – et qu’il les transforme continuellement avec le progrès du temps. »
Paris, le 13 novembre 2006
Publié dans La Presse littéraire, décembre 2006.
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, guy dupré, nimier, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05 septembre 2007
Bruno Favrit
Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,
aux éditions L’Age d’Homme
http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0
Grand voyageur devant les Immortels, Bruno Favrit est un adepte de la haute montagne, l’un de ces esprits solitaires qui aiment à méditer du haut des cimes. Dans son premier roman, qui fait suite à plusieurs essais (dont un rafraîchissant Nietzsche aux éditions Pardès), il entraîne le lecteur des sommets balkaniques aux vignes de Provence sur les traces d’un proscrit, un reître en cavale, rescapé d’une guerre perdue. Fanatiquement rebelle au monde techno-marchand, ce ksatriya égaré fuit le siècle et ses tentations, vivant comme un animal traqué et pratiquant une méditation sans rien de transcendantal. Il s’agit bien d’un périple spirituel, une peregrinatio, aventure autant intérieure qu’extérieure, et d’une leçon de liberté. L’homme recourt aux forêts et aux rochers pour s’immerger dans une nature divine, la seule loi qu’il accepte encore. Pour dépeindre cet éreintant parcours, B. Favrit use d’une prose anguleuse comme une paroi, dont l’âpreté souligne son indocilité foncière, celle du desperado. Disciple de Diogène et de l’empereur Julien, le héros nous convie à le suivre dans sa guerre sainte, celle qu’il mène contre les Infidèles – et contre lui-même. A lire ce récit abrupt, comment ne pas songer au fragment XVIII d’Héraclite : « Qui n’espère pas n’atteindra pas l’inespéré, qui est au-delà de toute recherche et à l’écart de toutes les routes » ?
Bruno Favrit, Criminel de guerre, Editions ACE, 126 p., 15€
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, montagne | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16 janvier 2007
Les 40 ans de l'Age d'Homme
« La littérature représente pour moi une dimension intemporelle qui complète la vie » Vladimir Dimitrijević
S’il y a deux substantifs qui s’appliquent à Vladimir Dimitrijević, le fondateur des éditions de L’Age d’Homme, ce sont bien l’inassouvissement et l’insoumission. Celui que ses amis appellent Dimitri est un bourreau de lecture, l’un de ces hommes de l’ancien monde, qu’un livre élève et métamorphose. Un homme pour qui lire s'apparente à prier. Cette soif-là jamais ne sera apaisée, et Dimitri lira jusqu’à son dernier souffle tant est dévorante sa passion de découvrir une voix originale entre les lignes d’un manuscrit. A l’entendre parler, l’œil en feu, d’un de ces Russes, de ces Suisses ou de ces Anglais encore inconnus, je comprends combien Dimitri est resté l’explorateur qui jamais ne renoncera à boucler son paquetage pour une expédition lointaine.
D’avoir grandi en dictature – la Yougoslavie des années 40 et 50 – fut pour lui un traumatisme : les bons livres prohibés et la mélasse imposée, les imposteurs portés au pinacle alors que les vrais écrivains croupissaient en taule ou en exil. En réaction contre la censure, Dimitri s’est adoubé éditeur, à treize ans, par dégoût pour toutes les polices. Mais qu’est-ce qu’un éditeur ? Quelqu’un qui lit et fait lire, dixit Dimitri. D’abord libraire, et un libraire célèbre à Lausanne, il est devenu, en 1966, éditeur ayant pignon sur rue. Quarante ans et 4000 titres plus tard, dans un système techno-marchand soumis à une mise au pas autrement plus efficace que celle des démocraties populaires, un pareil homme ne peut manquer d’ouvrage. Au contraire, depuis la chute du Mur, j’ai l’impression qu’il a dû mettre les bouchées doubles pour compenser, avec ses maigres moyens, la prudence "citoyenne" de maints confrères. En outre, il doit aujourd'hui comme hier faire face à ce que le regretté Philippe Muray nommait "la fièvre cafteuse" et "l'envie du pénal": dans tous les régimes, les apparatchiks font payer leur talent et leur solitude aux artistes. Nihil novi sub sole.
Le plus remarquable est que cet anniversaire, ce soient les éditions du Rocher qui le fêtent, avec Les Caves du Métropole, étonnante chrestomathie: quarante auteurs choisis en toute subjectivité par le maître d'œuvre du volume, le critique Augustin Dubois. Conseillé par Samuel Brussel, le directeur de la collection Anatolia (et héritier hérétique de Dimitri), A. Dubois a sélectionné des extraits d'auteurs maison, précédés d'une brève introduction non dénuée d'humour ni de courage: si Bloy se voit comparé au capitaine Haddock, Léontiev est qualifié de profond et Nougé, le surréaliste belge, préféré à Breton, Crevel, Tzara et consorts. L'ouvrage se termine par un court texte où Dimitri évoque sa passion en termes imagés: "je cherche dans chaque livre la pièce manquante de cette immense mosaïque qu'est l'existence". Voilà de l'excellent travail, et un beau geste: un éditeur salué par son confrère, n’est-ce pas seigneurial ?
© Christopher Gérard
La figure de Dimitri est évoquée dans Les Nobles Voyageurs
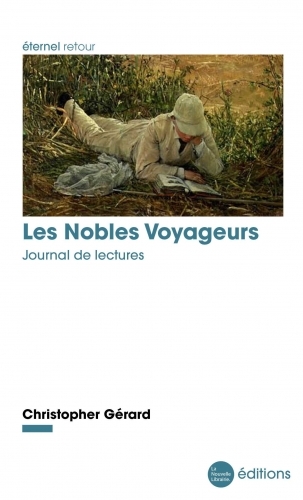
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16 novembre 2006
Entretien avec Dimitri, directeur de L'Age d'Homme
Entretien avec une légende vivante du monde de l'édition
Christopher Gérard: Depuis très longtemps, vous éprouvez pour la Belgique une profonde tendresse, à la fois personnelle et littéraire. Pouvez-vous nous en parler?
Vladimir Dimitrijevic: En 1954, au moment où j'ai quitté clandestinement la Yougoslavie communiste pour l'Occident, je ne savais quasiment pas où se trouvait ma ville de naissance, étant donné que le passeport - belge - que j'utilisais n'était pas tout à fait le mien: j'étais né à Anvers, j'y habitais Moretuslaan, j'avais 39 ans et les cheveux blonds. En réalité je n'avais que 19 ans … Quant aux cheveux, il faut croire que les blonds mûrissent plus lentement que le noiraud que je suis! J'avais eu le culot de prendre un billet d'avion pour Zürich à l'aéroport de Zagreb, en me disant qu'aucun policier n'imaginerait une fuite pareille, et cela a marché. Donc je suis belge, mon nom est Jacques Booth. Depuis trente ans, depuis la première foire du livre de Bruxelles - où je viens tous les ans -, dès que j'ai une interview comme celle-ci, je dis: "Jacques Booth, écrivez-moi! Je voudrais savoir qui vous êtes, vous remercier et m'excuser pour les ennuis que vous avez pu avoir avec la police yougoslave étant donné que votre passeport avait disparu de l'hôtel où vous séjourniez." Appel fraternel est donc lancé à Jacques Booth. La première fois que je suis allé à Anvers, j'ai immédiatement cherché la Moretuslaan, numéro 22, pour voir la maison. Chose extraordinaire: c'était un terrain vague! Je suis donc arrivé ici avec un faux passeport belge, habitant un terrain vague! Cela m'a fait un effet belge. Et voici pourquoi: dans la littérature belge, dans le fantastique belge, les changements de maisons, de rues sont fréquents. On les trouve chez Jean Ray, chez Thomas Owen par exemple. On pourrait ainsi écrire l'histoire de quelqu'un qui cherche celui qui l'a aidé et qui se rend compte que tout est à refaire, que tout est à revivre.
Muni de ce "faux passeport" - une tradition bien belge - et domicilié avenue Moretus - un lointain confrère des XVII Provinces -, vous pouviez impunément vous intéresser à notre littérature…
Exactement. J'ai commencé à lire Ghelderode, quelques surréalistes belges et cela m'a plu. Les surréalistes belges sont les seuls vrais, car les surréalistes français, trop cérébraux, arrivent à détruire l'image, le texte ou même le récit. Je les trouve surfaits. C'est une tendance qui aboutit dans la publicité moderne. La télévision est un avatar de ce surréalisme. Dans une certaine mesure, il y a une correspondance entre les littératures slave et belge: elles partent du réel, sont enracinées et surtout, les écrivains sont très différents les uns des autres. Il existe de grandes tendances, bien sûr, mais ils restent des individualités, comme Muno, que j'aimais beaucoup, comme beaucoup d'autres. Parmi eux, je citerai Jacques Henrard, un auteur très particulier, qui lui aussi fait son chemin, je dirais: son souterrain littéraire. Cela me plaît. J'ajouterai ceci: on ne refait pas sa vie, mais si je devais être un éditeur enraciné quelque part, je préférerais être un éditeur belge que français. En Belgique, je me serais senti chez moi, à l'aise, car un éditeur, s'il peut toujours créer des collections, doit avant tout avoir un terreau. Je suis un éditeur établi en Suisse depuis 1966, mais ici, je crois que j'aurais mieux réussi grâce au terreau justement, à tous ces gens curieux, qui me plaisent, qui suivent leur propre chemin. J'espère qu'ils continueront, car on sent aujourd'hui une tendance à l'uniformité. Par mon travail, j'espère donner un peu d'espoir et d'ambition aux écrivains, et leur permettre de durer.
Plus de cinquante auteurs belges existent et durent grâce à vous, comme le montre le beau catalogue 2002: La Belgique à l'Age d'Homme. L'Age d'Homme est bien "nach dom", notre maison. Mais, puisque nous parlons de littérature belge, quels en sont pour vous les points forts?
L'indépendance! Comme mon pays natal, la Belgique est un pays-frontière: vous avez les Flandres et la latinité. Surtout, la peinture joue un très grand rôle dans la formation du goût et de la sensibilité en Belgique. Et cette peinture, je ne vais pas dresser de catalogue mais je pense tout de suite à Ensor, eh bien, elle est bonne! Cette peinture est aussi une pensée…
Vous nous avez compris! La peinture comme pensée!
Oui, elle n'est pas qu'un décor, mais bien une pensée. Prenez Hugo Claus, qui est à la fois peintre, dramaturge et romancier: il a cette fougue, ce trait du peintre dans sa poésie, dans sa littérature. C'est très particulier à l'espace belge et il faut que ceux qui cultivent cet héritage pictural comptent ici. Quant à la langue, ce n'est "la langue française", tout comme en Suisse. Des Suisses comme Haldas ou Ramuz sont de grands écrivains français, mais leur génie ne réside pas dans la suavité de l'expression ni dans la rhétorique. Leur langue est une langue arrachée, proche du pays et de ses gens, de leur accent, cela se sent. Pour moi, c'est essentiel: sans ce terreau, la littérature n'existe pas vraiment. En fait, il y a parmi les écrivains, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors peuvent produire des textes fantastiques, extraordinaires, étincelants, tout ce que vous voudrez, mais ils ne touchent pas. Ils ne sont pas dedans! L'essentiel est de tirer tout le suc d'un pays, sa musique et cela demande un grand travail. Voyez Ramuz, qui a publié jadis Deux Lettres, l'une adressée à son mécène suisse, l'éditeur suisse Mermod, l'autre à Bernard Grasset, sans doute le plus grand éditeur de sa génération. Grasset était attentif à cela: il avait senti que le sort de la littérature française se jouait dans la profondeur, dans…
… dans les marges?
… dans les marges, oui. Enracinée comme chez Poulaille, ou l'œuvre colossale d'un Ramuz, d'un Giono, des écrivains qui ont fait coïncider la langue et la réalité. Chez Ramuz, vous entendez hésiter les personnages; des silences s'installent. Même chose chez Céline, très proche du monde des artisans du Passage Choiseul dont il a le parler dans l'oreille et qu'il transfigure en grande littérature. Tout ce courant était une réaction à une littérature assez conventionnelle, qui avait ses stylistes, mais qui me touche peu. La Belgique, avec un Ghelderode, c'est ma littérature!
Parlez-nous des grands écrivains belges que vous avez lus.
Depuis toujours, j'ai une passion pour Simenon comme pour Tchékhov et Toilstoï. Ce sont des médiums. Le style de Simenon est très personnel: quand vous essayez de le traduire dans une autre langue, vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. J'ai pu le vérifier en lisant des essais en serbe ou en russe, si vous traduisez Simenon mot à mot, ce n'est plus du Simenon. Vous n'avez qu'une histoire, mais vous perdez les silences. Le silence d'un Simenon est particulier, mystérieux même. Le théâtre de Ghelderode m'a beaucoup marqué et j'espère qu'il existe encore des metteurs en scène capables de représenter ce Moyen Age qui entre sans frapper, ce Moyen Age exubérant, que l'on trouve dans la peinture de l'époque. Alors, comment cette exubérance a-t-elle été perdue dans la civilisation européenne, c'est un autre sujet…
Vaste problème…
Oui, vaste problème!
Et parmi les écrivains belges que vous avez rencontrés…
J'aime beaucoup Jacques Henrard, un homme qui semble sortir des nouvelles de Tchékhov, simple et effacé. Il y a chez lui une compassion qui vous serre le cœur, sans volonté directe d'émouvoir. Pour moi, c'est un auteur très important. Je ne parlerai pas d'autres contemporains, ou alors une autre fois.
Et comme éditeur en général, de quoi êtes-vous le plus fier?
Du catalogue! Vous voyez, quand on me demande de parler de métier, je réponds que je ne sais pas. Quand suis-je devenu éditeur? A treize ans? Au moment où, en classe, dans le dénuement qui était le nôtre au sortir de la guerre, nous étions graves? Graves et pleins d'énergie, parce que, malgré la guerre et les familles décimées, régnait une sorte d'exubérance… Et puis il y avait la censure qui s'est abattue sur ma famille tout d'abord, ensuite sur mes goûts intérieurs. Comment se fait-il que je me suis toujours trouvé à côté des choses admises, sans le vouloir? Voilà une question qui me préoccupe: pourquoi ai-je toujours été à côté de ce qu'"on" attendait de moi? Je ne sais pas. Je ne suis absolument pas marginal, comme certains de mes confrères qui se situent explicitement "dans la marginalité". Je ne suis pas contre, mais ailleurs. Là où je peux réparer les torts, laisser les gens parler quand ils sont brimés. Je me suis intéressé au futurisme italien, à la littérature anglo-saxonne, à Wyndham Lewis, l'un des plus grands écrivains anglais, un homme complet, peintre et inventeur de formes, constamment mis dans les marges. Il n'est pas "marginal", il est mis dans les marges: les journaux ne parlent pas de lui. Même chose pour l'étonnant Caraco, dont j'ai publié plus de vingt livres. Je pense aussi à un autre homme complet, l'un de mes préférés, S. Witkiewicz. Tous ces gens sont autodidactes comme moi. Les formations restreignent la curiosité. Or, pour moi, la connaissance est une sorte de métastase permanente. Tout m'intéresse, même les insectes exotiques…
Ce serait donc le secret de votre métier: une curiosité tous azimuts?
Oui, une curiosité tous azimuts, mais pas dispersée. Passionnée. Je ne mélange pas les genres. A un moment donné, se construit dans ma tête la mosaïque du catalogue. Vous voyez, quand je suis invité chez quelqu'un, la première chose que je fais, c'est impératif pour moi, c'est de regarder sa bibliothèque. On a beau me tendre un apéritif, tenter de m'asseoir de force, je regarde les livres. Et je regarde ce qui manque. C'est instinctif. Ainsi, ici à la Foire, je regarde partout et je me dis: "hou, là, il manque…" Ou bien: "ah, il a rempli la case". Cette mosaïque est pour moi essentielle: j'interroge ceux que je rencontre, mes amis, mes auteurs pour savoir où va le théâtre, où va le cinéma, etc. Ce que j'aime, c'est de recevoir un coup, a blow, disent les Anglais. La gifle en pleine figure. Qu'on me dise: mais, mon Dieu, regarde! Rozanov, Caraco, Witkiewiecz me donnent ce genre de choc. De ces chocs naît la mosaïque. Le catalogue. En fait, je suis très attaché à la transmission de la vie.
Je suis un grand pessimiste, mais qui croit à la transmission de la vie.
Bruxelles, le 14 février 2004
Cet entretien a d’abord paru dans la Revue générale de mars 2004 (Bruxelles).
*Le catalogue des auteurs belges peut être demandé à la librairie parisienne de L'Age d'Homme, 5 rue Férou, F-75006 Paris, tél. (33) 1 55427979.
* Vladimir Dimitrijevic est l'auteur d'un livre où il décrit sa deuxième passion: le football, La vie est un ballon rond, Ed. de Fallois, Paris 1998.
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10 novembre 2006
Sur Céline

Entretien avec Marc Laudelout, directeur du Bulletin célinien
Quiconque s’intéresse à Céline – au « miracle Céline » (Julia Kristeva) - rencontre un jour ou l’autre Marc Laudelout, pour qui rien de ce qui est célinien n’est étranger. N’oublions pas Dame Arina, sa sémillante épouse, qui l’assiste dans son labeur quotidien, car Marc Laudelout, inlassablement, avec une exactitude helvétique, publie son Bulletin tous les mois… et parvient à surprendre ses lecteurs grâce à des trouvailles, des entretiens, une iconographie, et toujours ce ton de bonne compagnie qui n’empêche ni l’ironie ni l’humour. Prenons le numéro de mai 2006 : un admirable dossier consacré à Robert Denoël, l’éditeur du Voyage, assassiné en 1945 dans des circonstances qui font penser à un « contrat » digne d’un film de gangsters (voir à ce sujet le site très complet du libraire liégeois Thyssens http://www.thyssens.com/). Dans le numéro de novembre 2006, mes compatriotes Marc Hanrez et Frédéric Saenen évoquent les rapports entre Céline et mon cher Morand. Bref, le Bulletin propose une foule de documents rares, des informations précieuses, souvent introuvables ailleurs. Ce qui frappe avant tout, c’est la liberté de ton et l’ouverture d’esprit du Bulletin, dont témoigne le courrier des lecteurs. Et comme nombre de collaborateurs sont des écrivains, de Claude Duneton à Jacques d’Arribehaude, on prend plaisir à lire ce cahier mensuel. Dieux merci, Laudelout n’a jamais voulu que son Bulletin devînt celui d’une paroisse, car il a fait siennes les paroles de son ami Pol Vandromme : « il ne s’agit pas de réhabiliter l’homme Céline, les hommes sont ce qu’ils sont, hélas ! mais de s’abstenir enfin de l’utiliser pour réduire l’écrivain en bouillie ».
Qui êtes-vous et comment est née cette passion qui vous permet de publier, depuis 25 ans, un bulletin exclusivement consacré à Céline ?
Tout a commencé par la découverte d’un exemplaire de l’édition originale du Voyage au bout de la nuit dans la bibliothèque paternelle. Mon père – feu le professeur Henri Laudelout (Université de Louvain) – avait lu ce roman à la fin des années trente grâce à un jeune enseignant intérimaire qui en avait parlé avec enthousiasme en classe. Recommander ce brûlot dans un collège catholique était très audacieux à l’époque ! Bien des années plus tard, la lecture de ce livre fut aussi un grand choc pour moi (j’avais alors une quinzaine d’années) et j’ai ensuite lu tous ses autres livres, dont Mort à crédit que je ne suis pas le seul à considérer comme un pur chef-d’œuvre. Si je suis enseignant de profession, j’ai toujours eu une vocation rentrée de journaliste ; aussi, j’ai décidé de créer, en 1979, une revue semestrielle entièrement consacrée à l’écrivain. C’est ainsi qu’est née La Revue célinienne qui, après avoir publié trois numéros (dont un numéro double, en 1981, à l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort), a édité les livres que mon ami Pol Vandromme a entrepris d’écrire sur un sujet qu’il n’avait qu’effleuré en 1963 avec l’une des premières monographies sur Céline. Vinrent donc ensuite : Robert Le Vigan, compagnon et personnage de L.-F. Céline ; Du côté de Céline, Lili (sur le personnage de sa femme dans son œuvre romanesque) ; et Marcel, Roger et Ferdinand (sur les relations croisées entre Marcel Aymé, Roger Nimier et Céline). La Revue célinienne ayant disparue en tant que telle, je décidai de poursuivre la recension de l’actualité célinienne avec un modeste bulletin, d’abord trimestriel, puis mensuel. Il est aussi passé de 8 à 24 pages. Son seul titre de gloire est d’être sans doute la seule publication mensuelle consacrée à un écrivain. En ce qui me concerne, je me considère comme un simple publiciste célinien, rien de plus.

Quelles sont les grandes étapes de l’histoire du Bulletin célinien ?
Au début, ce fut un petit bulletin bien sobre qui se limitait à rendre compte de l’actualité autour de Céline (publications, échos de presse, conférences et colloques, etc.) Ensuite, le bulletin s’étoffa et publia aussi des témoignages sur l’homme, des études sur l’œuvre, des recensions, des documents et de la correspondance inédite. Nous avons aussi publié des numéros spéciaux sur quelques figures ayant croisé l’existence de Céline : Robert Denoël, Léon Daudet, Éliane Bonabel, Henri Mahé, Lucien Rebatet, etc. Récemment, nous avons publié des entretiens avec quelques grands céliniens : François Gibault, Philippe Alméras, Serge Perrault, Frédéric Vitoux, Henri Thyssens,... Un événement marquant fut sans doute cette dédicace d’Elizabeth Craig (la dédicataire du Voyage) aux lecteurs du Bulletin que nous avions reproduite en première page de couverture. On croyait avoir perdu sa trace depuis les années trente. C’est le professeur Alphonse Juilland qui l’a retrouvée après de longues recherches aux États-Unis. Au total, nous avons donc publié près de 300 numéros qui constituent, je le pense, une mine de renseignements pour ceux qui s’intéressent à cet écrivain. Parallèlement à la publication du périodique, nous avons créé un site Internet qui propose une somme aux étudiants ou tout simplement à ceux qui veulent en savoir plus sur cette œuvre considérable du XXe siècle.
Les grandes rencontres ?
Je dis parfois que j’ai contracté une double dette envers Céline puisqu’il m’a permis de faire la connaissance d’une série de personnes que je n’aurais jamais rencontrées autrement. Les énumérer toutes est impossible. Laissez-moi citer tout de même Arletty, Pierre Monnier (qui vient de nous quitter à l’âge de 94 ans), Paul Chambrillon, Robert Poulet, Pierre Duverger, Frédéric Vitoux, Alphonse Juilland, mon compatriote Marc Hanrez, sans oublier celle qui devint mon épouse, Arina Istratova, qui eut l’audace de traduire Mea culpa à Moscou en août 1991 lors du premier putsch contre Gorbatchev.
Vous fréquentez donc les « céliniens » depuis un quart de siècle. Quel genre de tribu est-ce ?
Il y a autant de céliniens que de variétés de plantes d’appartement ! Ce n’est pas du tout un groupe homogène : les céliniens plutôt « de gauche » (Sollers, Godard, Vitoux,...) cotoient les céliniens plutôt « de droite » (Gibault, Alméras, Hanrez,…). Cela fait partie de l’aspect pittoresque des choses mais tout le monde se réunit, notamment au sein de la Société des Études céliniennes, dans une même admiration pour l’écrivain. C’est Henri Godard, éditeur de Céline dans La Pléiade, qui m’écrivait un jour que « nous avons en commun de travailler à donner à Céline, en dépit des handicaps, toute la place qui est la sienne ». La ligne de fracture se situe peut-être dans l’appréciation des textes qu’on appelle erronément « pamphlets » (ce terme désigne, en principe, des textes courts) et qui sont, en réalité, des sortes de satires. Tout serait beaucoup plus simple si ces textes étaient littérairement médiocres. Mais ce n’est pas le cas. Je veux dire que les « pamphlets » ne sont pas à l’œuvre de Céline ce qu’est, par exemple, Le Péril juif à l’œuvre de Marcel Jouhandeau. Céline est assurément un grand écrivain de combat qui ne perd pas du tout son talent lorsqu’il s’attaque à ceux qu’il a dans sa ligne de mire. On peut le déplorer mais c’est ainsi. D’autant qu’il n’existe pas deux Céline : le bon romancier et le mauvais pamphlétaire. Son œuvre forme un tout indivisible. Certes, on trouve dans les textes polémiques des choses insupportables ou odieuses, mais on y voit aussi un Céline visionnaire fustigeant, par exemple, en 1937 la standardisation du livre, la société du spectacle, la pollution des villes et surtout une communauté (la nôtre) qui est en train de perdre son âme et son identité.
Mais en fin de compte, qui est Céline ?
Céline, né sous le signe des Gémeaux, est une personnalité très ambivalente. Aussi, il est tour à tour misanthrope et compatissant, généreux et avare, courageux et pusillanime, etc. Il a souvent donné une image de lui qui n’était pas conforme à ce qu’il était : « Il faut noircir et se noircir », disait-il en tant que romancier fuyant les bons sentiments. C’est aussi ce qu’il a fait pour ce qui le concerne. Marcel Aymé a sans doute évoqué avec le plus de justesse sa vraie personnalité : « Ce n’était pas un homme au cœur dur », disait-il. Et il le connaissait bien.
Quel livre de Céline conseilleriez-vous à un novice ? Et sur Céline ?
La grande part de son œuvre est très accessible puisque tous ses romans sont à présent disponibles en collection de poche. Son premier roman, Voyage au bout de la nuit, est un classique indémodable qui doit faire partie de la bibliothèque de tout honnête homme. Il ne faut pas se fier aux apparences : loin d’être le roman populiste qu’on a dit, c’est un grand livre métaphorique et poétique. Son chef-d’œuvre demeure, pour moi, Mort à crédit, où le tragique côtoie le comique d’une manière irrésistible. Il faut lire aussi D’un château l’autre dans lequel il raconte l’épopée foireuse des rescapés de la collaboration française en Allemagne. Un monument ! Mea culpa, libelle anticommuniste et antimatérialiste, est ce qu’on a écrit de mieux dans le genre. Voilà quatre titres que je recommanderais au béotien. Sur Céline, je conseille la lecture des monographies de Pol Vandromme et de Pierre Lainé (éd. Pardès) pour une première approche. Pour mieux connaître la personnalité de l’homme, il faut lire Ferdinand furieux de Pierre Monnier (livre hélas épuisé que L’Age d’Homme devrait rééditer) et les biographies de François Gibault (Mercure de France) ou de Frédéric Vitoux (Grasset). C’est dans l’édition critique de La Pléiade que l’on trouve les commentaires les plus pénétrants sur l’œuvre. Nombreux sont les essais de qualité qui ont paru sur lui : le Céline d’Anne Henry (éd. L’Harmattan) ou celui de Paul del Perugia (Nouvelles Éditions Latines), sans oublier l’essai de Philippe Muray disparu prématurément (Gallimard).
Parlant de Céline, il est en effet impossible de passer sous silence ses textes polémiques, ceux qu’on appelle à tort les « pamphlets ». N’est-ce pas Gripari qui avait raison en parlant de « littérature anticolonialiste » ? Peut-on séparer Bagatelles du Voyage ?
C’est, en effet, Pierre Gripari qui, d’une manière très pertinente, a évoqué ainsi Bagatelles. Son argumentation mérite d’être citée tel quelle : « La partie anti-juive, violente, brillante, extrêmement drôle, ne constitue nullement un appel au meurtre. Elle appartient, très banalement, à ce qu’on appelle aujourd’hui la littérature anticolonialiste. (...) Son motif unique, c’est un refus horrifié de la croisade antifasciste, de cette guerre civile européenne qu’on est en train de nous préparer sous couleur de Front populaire, avec le tout le camouflage d’optimisme et de progressisme bêtifiant que l’on retrouve dans les films français des années trente. Cette guerre, prophétise-t-il, ne sera qu’une guerre juive, faite pour le seul profit des juifs et des staliniens. Nous autres, indigènes d’Europe, nous n’avons rien à gagner, et tout à y perdre. » Je conçois que cette analyse puisse choquer, même si Gripari s’empressait d’ajouter que Hitler a évidemment sa part de responsabilité dans le suicide de l’Europe. Ces textes de Céline, écrits pour la plupart d’entre eux dans les années trente, sont difficilement incompréhensibles aujourd’hui car ils sont jugés à travers le prisme des atrocités qui se sont passées pendant la guerre. Et c’est notamment pour cette raison que l’ayant droit n’autorise pas leur réédition. C’est jusqu’au titre du premier « pamphlet » antisémite – Bagatelles pour un massacre – qui est de nos jours pris à contresens. Céline, héros médaillé de la Grande Guerre, voulait absolument éviter un nouveau conflit franco-allemand qu’il jugeait fratricide. Comme il n’était pas démocrate, peu lui importait qu’une alliance se fît avec l’Allemagne nationale-socialiste si c’était pour prévenir la guerre. Son pacifisme absolu a autorisé tous les excès, toutes les dérives. Il faudra sans doute attendre que Céline entre dans le domaine public pour que cette partie sulfureuse de son œuvre soit rééditée. Officiellement… car il existe de nombreuses rééditions non autorisées.
Céline a inspiré (inspire encore) d’autres écrivains : lesquels vous semblent les plus intéressants ?
En effet, Céline a inspiré de nombreux écrivains avec certaines réussites (Frédéric Dard, Alphonse Boudard) mais bien des tentatives moins concluantes. Le piège étant bien entendu de vouloir s’inspirer directement de son style. Comme Proust, Céline est inimitable. Certains romans sont céliniens dans le ton (je songe, par exemple, au récent Cave canem de François Gibault) mais il évitent heureusement de l’être dans la forme. L’originalité de Céline réside aussi dans la façon à la fois lucide et cruelle de voir le monde et d’exprimer les sentiments inavouables. Mais Céline, c’est avant tout une grande leçon de liberté et d’invention stylistiques. C’est en cela qu’il a permis à beaucoup d’écrivains d’être eux-mêmes et de se libérer d’une forme d’académisme. C’est notamment le cas du Sartre de La Nausée où l’influence célinienne est perceptible. Ce livre comporte d’ailleurs une phrase de Céline en exergue. Il y a aussi toute une génération de journalistes qui a été directement influencée par son écriture. « Enfin Céline vint ! », pourrait-on dire.
Bruxelles, le 12 juin 2006.
Voir aussi :
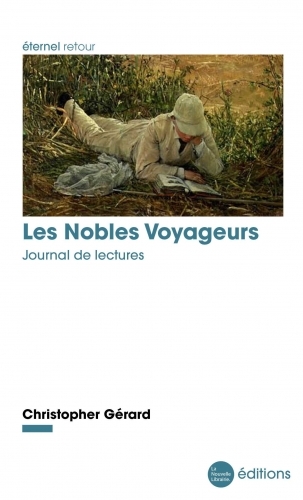
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |








