24 novembre 2025
Ecrivains de Wallonie ?
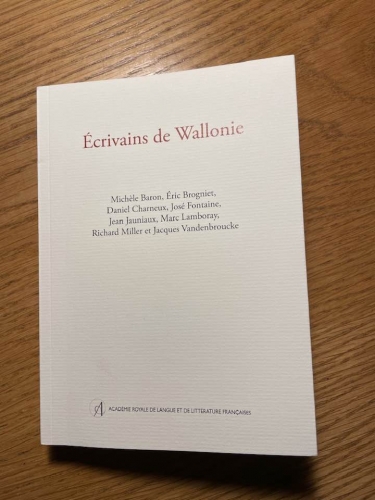
« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » déclarait à juste titre, en avril 2025, Éric Brogniet, poète, éditeur, fondateur de la Maison de la Poésie à Namur. Ce membre de l’Académie royale introduisait en ces termes le colloque consacré aux écrivains de Wallonie, tenu au Palais des Académies, joyau de l’architecture néo-classique et jadis résidence du Prince d’Orange.

Ce colloque, dont les actes viennent de paraître sous l’élégante casaque de l’Académie royale, est singulier à deux titres. D’une part, il met en valeur quelques écrivains dits « régionalistes » ou « wallons » du XXème siècle belge, et ce dans le temple de la langue et de la littérature dites « françaises » ; de l’autre, y sont évoqués deux authentiques maudits des Lettres belges, occultés depuis des années.
Éric Brogniet commence par retracer les étapes du mouvement wallon, qui apparaît comme inspiré de son homologue flamand, antérieur et d’une autre cohérence (le mouvement wallon oscillant pour sa part entre velléités d’autonomie et rattachement à la grande France). Si le nationalisme flamand, d’esprit néo-romantique (fondé sur l’inepte sophisme « La langue est tout le peuple ») et devant beaucoup à l’aide tout sauf désintéressée du Reich (deuxième et troisième du nom), peut être vu comme un sous-produit de l’état unitaire belge, le nationalisme wallon apparaît lui comme un sous-produit… de ce même nationalisme nordiste°.
Se pose la question de l’identité, belge, wallonne, « française » de notre littérature francophone. Pour ma part, je pense depuis longtemps qu’il conviendrait de parler non de communauté française de Belgique, mais bien de Belgique romande, comme il existe une Belgique flamande et une allemande. Les écrivains de langue française de ce pays sont-ils « wallons » ? « Français » ? Pourquoi pas « romands » ? Vaste problème.
Le colloque évoque des auteurs tels que Thierry Haumont, Hubert Krains ou Jean Tousseul. Particulièrement intéressante est la contribution consacrée à une série d’écrivains ardennais (et non wallons ?) un peu oubliés, qui transmettent une vision panthéiste de l’Ardenne.
Les deux contributions les plus sensibles traitent de deux maudits, Constant Malva et Pierre Hubermont, deux écrivains majeurs du courant prolétarien, salués par A. Barbusse et H. Poulaille, membres un temps du Parti communiste (belge) puis passés, qui au trotskisme, qui au socialisme révolutionnaire. Tous deux provenaient du milieu ouvrier du Borinage ; tous deux connurent le travail dans la mine, dès l’adolescence.

Ces deux autodidactes, relativement peu scolarisés, ignorés par les grandes maisons d’édition, ont livré des témoignages parfois bouleversants sur la vie des mineurs et de leur famille. Ma Nuit au jour le jour (manuscrit refusé quinze ans durant par des éditeurs) ou Histoire de ma mère, de Constant Malva, Treize hommes dans la mine, de Pierre Hubermont sont des livres forts et qui resteront. Leur vision du mineur, et du prolétaire en général, ne donne jamais dans le romantisme niais de la littérature engagée – d’où sa puissance d’évocation.

Constant Malva
Sous l’Occupation, ces deux écrivains de sensibilité antifasciste, et même surréaliste pour Malva, basculent, sans doute en raison de leur pacifisme et d’une ahurissante naïveté. Malva, qui crevait de faim, accepte des causeries à la radio et un poste de concierge au syndicat unique. Hubermont, lui, s’engage davantage dans la presse sous contrôle allemand et même dans la Communauté Culturelle Wallonne – une opération des services du Reich en vue de la fragmentation du royaume. Crime suprême, Hubermont, l’ancien communiste horrifié par ce qu’il avait vu de l’URSS de Staline (il participa à une conférence d’écrivains révolutionnaires à Kharkov en 1930), se rendit à Katyn pour témoigner du massacre d’officiers polonais par les bolcheviques. Sa brochure J'étais à Katyn ne lui fut jamais pardonnée.

Pierre Hubermont
A la lecture des pages pondérées et bien informées sur ces deux destins brisés, je me suis souvenu des conversations que j’eus naguère avec le regretté Jean-Pierre Canon, anarchiste et pacifiste pur sucre (un pacifiste dénommé Canon !) qui, dans sa merveilleuse librairie La Borgne Agasse, proposait un rayon très complet sur la littérature prolétarienne, grande oubliée de notre histoire littéraire, que l’Académie sort aujourd’hui d’un injuste oubli.
Christopher Gérard
Éric Brogniet dir., Écrivains de Wallonie, Académie royale, 202 pages, 19€
° Une bourde de taille dans la présentation d’E. Brogniet, qui confond, page 39, deux mouvements flamands, le VNV et le Verdinaso et fait de Joris Van Severen, un « indépendantiste et membre de la SS flamande ». Van Severen, qui était plus grand-néerlandais que flamingant, s’était converti en 1938 à la défense du royaume. Il fut exécuté de façon sommaire avec vingt autres prisonniers, dont des communistes belges et des antifascistes italiens, par des soldats français à Abbeville en mai 1940, bien avant les débuts de la collaboration flamande en Belgique occupée.
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20 janvier 2025
Avec Luc Dellisse

Dans nombre de ses essais, dont Libre comme Robinson. Petit traité de vie privée, Luc Dellisse livre d’ impertinentes réflexions sur la « ruche planétaire » et sur les manières de gagner ces maquis qui résistent à la grande mise au pas. Moraliste sceptique, Dellisse fait ainsi preuve d’une belle vigilance face au Léviathan moderne. Comme il le dit fort bien sur son blog, L’Inconnu, « Il n’est presque plus possible de faire un geste, un mouvement, de vivre un seul moment personnel, sans tracer un sillage phosphorescent. Notre liberté s’est restreinte en profondeur et il n’en reste que la surface et le mot. »
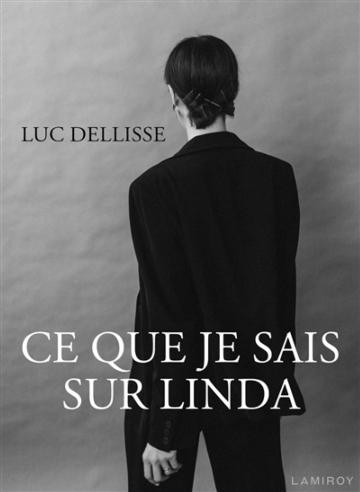
Le voici qui revient au roman avec Ce que je sais sur Linda, où son narrateur mène une double vie : écrivain reconnu (et même académicien) trois semaines par mois dans la capitale de l’Europe, consultant (sic) sous un nom d’emprunt quelque part en Champagne le reste du temps. Ces deux existences sont théoriquement étanches, de manière à lui permettre, tout simplement (car l’homme n’est en rien malhonnête) de respirer un autre air. Dans sa seconde vie, il évite de laisser la moindre trace (cartes de crédit, etc.) et, pour parachever une couverture digne d’un agent « illégal » en territoire hostile, habite en colocation avec un Guillaume qui ignore tout de son existence bruxelloise. C’est grâce à ce Guillaume qu’il rencontre la mystérieuse Linda, une femme hors du commun, ô combien complexe, qui le battra à plate couture en ce qui concerne ce que les services de renseignement appellent « légende ». Le narrateur et Linda sont liés par une amitié sans rien d’équivoque ni de convenu : « L’amitié naît parfois du désir contenu. L’amitié nous allait bien. Dans un monde où tout est commerce, même le rire, même le sommeil, même le jardinage, même la promenade, même la création, même l’amour (…), l’amitié est peut-être la seule forme de relation humaine dont la gratuité est le moteur. »
Inutile de dévoiler le dénouement de ce roman allègre qui a quelque chose de cavalier au sens le plus nerveux, quasi pétulant, du terme, à la prose sèche, d’une belle efficacité. Si les étranges accidents qui arrivent à Linda introduisent une tension bienvenue, Dellisse évite avec maestria l’écueil (attendu) du polar.
Joli coup de maître !
Christopher Gérard
Luc Dellisse, Ce que je sais sur Linda, Lamiroy, 236 pages, 20€
Entretien
Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre itinéraire ?
Un itinéraire assez bousculé. Voyager, lire, étudier, être amoureux, gagner sa vie de plusieurs manières successives comme la direction d’un magazine d’art, les jeux de la bourse et du hasard, la consultance en entreprise ou l’enseignement du scénario. Sans parler des sports solitaires et de la philosophie. Tout cela aurait pu suffire à m’occuper et à monopoliser mes forces. Pourtant, il me semble que j’ai toujours agi, aimé, souffert parfois et pris ma part d’activités sociales dans les intervalles de ma vie véritable. Je dérobais du temps à mes devoirs et même à mes plaisirs, pour me retrouver libre d’écrire et d’inventer des mondes personnels. J’ai toujours été persuadé que les journées étaient bien assez longues et foisonnantes et qu’on pouvait en dilapider sans crainte la plus grande partie : il restait toujours assez d’or excédentaire. Mes livres sont faits de cette poussière impalpable.
Les grandes lectures ?
Elles sont fonction des époques et des circonstances, elles se superposent en couches géologiques, parfois je les oublie, ou je les renie, mais certaines ont la vie dure et ressurgissent : ce sont mes classiques, qui ne sont pas forcément issus des âges classiques, mais se reconnaissent, simplement, à leur richesse et à leur perfection. Que Montaigne, Pascal, Saint-Simon, Stendhal, Rimbaud, Proust, Valéry, Nabokov aient existé, et aussi Morand, Verlaine, Colette, Rilke, Fargue, quelques autres et qu’il suffise de tendre la main pour les tenir, les ouvrir, les saisir ! C’est un miracle permanent. Leur œuvre et leur personne donnent du prix à la vie.
Les rencontres importantes ?
Des femmes bien sûr ; pas à cause de l’amour que je leur portais, mais à cause de leur grandeur, de leur noblesse, de leur dépassement de soi. Des amis d’hier et d’aujourd’hui : de ceux qu’on se réjouit de revoir, chaque fois que la roue du temps nous remet en présence. Un professeur de latin nommé Servais, savant et passionné, qui s’est suicidé comme un Romain de la Haute époque. Le philosophe Henri Van Lier, l’intelligence la plus féconde et la plus joyeuse que j’ai connue : on s’aimait bien. Je lui ai consacré dernièrement un tout petit livre, où je dis ce que furent nos rencontres éblouies. D’autres personnes, plus célèbres, ont croisé ma trajectoire. Mais elles ne m’ont marqué en rien. Leur célébrité même les capitonnait.
Ce que je sais sur Linda marque votre retour au roman après quelques volumes de nouvelles ou de poésie. Quel a été le déclic ?
Un livre de nouvelles, c’est une nébuleuse, avec des vides et des pleins romanesques. Mais un vrai roman, c’est une trajectoire au long cours, une expédition qui vous mène loin du point de départ. Je sentais grandir en moi cette fusée, il fallait bien qu’elle parte, tôt ou tard, sans esprit de retour. Au départ, je pensais centrer mon récit sur un homme épris de liberté qui cache sa vie et change de nom une semaine par mois, pour se livrer aux joies de l’anonymat et de la jouvence. J’avais prévu des rôles secondaires importants, sur lesquels je prenais des notes. Arrivé à celle qui devait s’appeler Linda, en voyant s’allonger la liste des choses que je découvrais à son propos, j’ai compris que c’était elle le vrai centre de l’histoire, et toute l’écriture a bifurqué, pour se mettre à raconter un être, une époque, une relation, une beauté, un secret, un charme qui m’ont fasciné et m’ont tiré en avant.
« Je rêvais d’être invisible » affirme votre personnage principal (enfin, le second après la très-mystérieuse Linda). N’est-ce pas une constante chez vous que cette fascination pour la marge discrète, la fuite furtive et une sorte de camouflage ?
C’est vrai. Je trouve que la société est intrusive, l’État de plus en plus inquisiteur, la morale de plus en plus punitive. Il nous faut des zones d’ombre, des portes de secours, pour s’échapper, se concentrer, se taire, et se livrer ailleurs à ses jeux secrets. Les miens ne sont pas très mystérieux. Le travail, le plaisir et l’intimité amoureuse suffisent à me tenir en haleine, mais si possible, sans devoir rendre de comptes à personne. Je hais la transparence et j’aime partir sans prévenir, revenir en douce, ne laisser d’autre trace de moi que mes livres. Le reste est faux-semblant.
Propos recueillis par Christopher Gérard, novembre 2024.
Il est question de Luc Dellisse dans
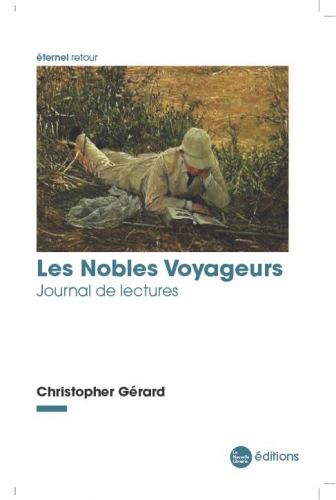
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04 août 2024
Avec Georges Thinès
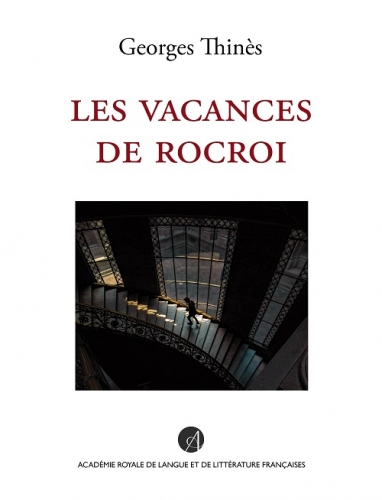
Si le mot génie a un sens, Georges Thinès (1923-2016) l’incarna sa longue vie durant. J’eus le privilège de le rencontrer à la Foire du Livre de Bruxelles grâce à Dimitri, mon éditeur, dont il était lui aussi l’ami. Je l’y croisai à plusieurs reprises ainsi qu’à l’une ou l’autre soirée de la Maison des Écrivains. L’homme impressionnait par son étonnant pedigree : engagé volontaire dans la Royal Navy à la fin de la guerre (d’où une élégance British du meilleur aloi), professeur de psychologie expérimentale à l’Université de Louvain couronné par le Prix Francqui, le plus prestigieux prix scientifique du royaume, savant de renommée internationale capable de donner cours en quatre langues, violoniste hors pair et créateur d’orchestre, poète dans la lignée de Valéry, romancier salué par la critique (Prix Rossel pour Le Tramway des officiers, un grand roman sur la guerre), membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises (il occupait le fauteuil du grand Marcel Thiry), traducteur des Poèmes anglais de Pessoa.
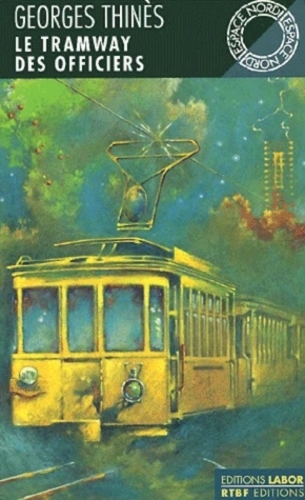
Profondément marqué par l’héritage gréco-romain, platonicien à sa manière cérébrale et raffinée, Georges Thinès détonnait dans le monde compassé des Lettres et de l’Université belges. Une seule preuve : lors des signatures, la file de ses anciens étudiants qui lui redisaient sans arrière-pensées leur gratitude et leur admiration. Son premier roman, Les Effigies, est mémorable : une méditation inspirée de l’Anabase de Xénophon. Son essai Le Mythe de Faust et la dialectique du temps suffit à lui assurer une belle renommée. Saluons donc avec effusion la réédition par l’Académie, dans une volume d’une parfaite sobriété (et qui est aussi un bel objet), de son roman Les Vacances de Rocroi. Comme dans Le Tramway des officiers, c’est le temps de l’Occupation qui ressuscite, un temps obscur et ambigu, lourd de menaces et qui force à la prudence, à la méditation aussi. Georges, un jeune lycéen bruxellois, est envoyé par ses parents chez une tante (qui n’en est pas vraiment une, plutôt une proche de la famille) à Rocroi, dans une vaste demeure patricienne dont les escaliers recèlent un secret, découvert ou plutôt pressenti dès son arrivée par l’intrus. L’immédiate disparition de cette tante, la rencontre avec la troublante Alberte, qui sera l’initiatrice du jeune homme, les errances dans la campagne sillonnée de patrouilles allemandes, l’implacable couvre-feu, le souvenir d’un René disparu sans laisser la moindre trace, un vélo de la Belle Époque, tous ces éléments s’emboîtent avec maestria dans ce roman, méditation sur le temps… sous la protection de l’Ange aux deux visages. L’œuvre d’un maître, à la langue ciselée, d’une éblouissante densité.
Christopher Gérard
Georges Thinès, Les Vacances de Rocroi, 212 pages, 18€

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature belge | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08 juin 2023
Michel Lambert, dans les nuages
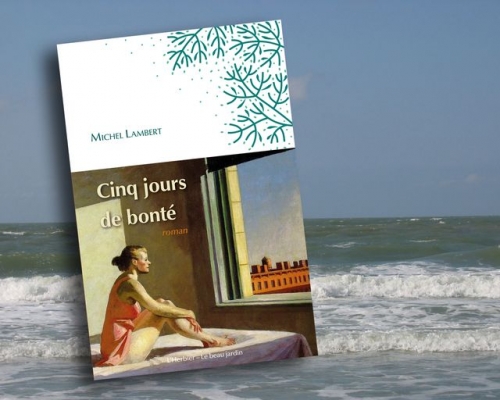
Placé haut par les regrettés Pol Vandromme, Bernard de Fallois et Vladimir Dimitrijevic, trois orfèvres en matière littéraire, Michel Lambert est un nouvelliste maintes fois primé, doublé d’un romancier raffiné comme l’illustrait naguère L’Adaptation, un livre d’une vertigineuse complexité qui baignait dans une atmosphère de nostalgie, de déclin tant physique que sentimental, et de quête - celle du Chevalier médiéval à la poursuite d’une Dame inaccessible.
Virtuose du style, Michel Lambert y jouait avec les couleurs et les ciels, pareil à un peintre des anciens Pays-Bas, pour qui les nuages peuvent refléter des sentiments mouvants.
Dans Cinq jours de bonté, son dernier roman, ses pérégrinations le mènent à Ostende, la ville, ô combien nuageuse, du grand peintre James Ensor, station balnéaire décatie de la Mer du Nord, avec son monumental Kuursaal, le plus grand casino d’Europe, et son mythique Bal du rat mort, où se presse une faune cosmopolite. Curieusement, et sans doute à dessein, Kuursaal, qui se traduit en français par casino, signifie en réalité « salle de cure » - la cure que suit plus ou moins l’épouse du narrateur.
C’est donc là, à Ostende, qu’échoue le couple étrange que forme Thomas Noble ( !), le narrateur et Raya, son épouse, qui profite ainsi d’une permission de cinq petites journées, accordée par son psychiatre, qui soigne ( ?) ses troubles dépressifs, voire pire.
Les époux, qui ne sont plus amants depuis longtemps (une Charlotte a fait son apparition avant de plus ou moins disparaître), vont, non sans maladresse, tenter de réapprendre à se connaître. Tout le poids des non-dits (la maladie de Raya, les liaisons de Thomas et sa dégringolade sociale, etc.) les écrase tous deux. Les comparses du récit, un couple de nobliaux en déroute, un pilote alcoolique et sa maîtresse, incarnent, sous le ciel changeant de la côte belge, les masques d’une vie désaccordée, comme dans les toiles d’Ensor.
Disciple de Tchékhov, Michel Lambert se révèle une fois de plus, et à sa manière inimitable, l’un de nos peintres de race.
Christopher Gérard
Michel Lambert, Cinq jours de bonté, L’Herbier – Le beau jardin, 252 pages, 20€.
Voir aussi ma chronique antérieure :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2018/08/03/avec-michel-lambert-6070353.html
Il est question de Michel Lambert dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures, XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07 juin 2023
Princesse Hoex

J’ai parlé naguère de Corinne Hoex, dans mes Quolibets (L’Age d’Homme) comme dans diverses chroniques de Service littéraire ou de la Revue générale.
Corinne Hoex est l’auteur (l’autrice, si vous insistez) de romans, de nouvelles ; elle est aussi poète - une voix qui compte en notre bel aujourd’hui. Unique est son ton, tour à tour cruel et coquin, grave et loufoque. Comme je l’ai dit ailleurs d’un précédent titre : « Entre Bosch et Rabelais, car jamais la farce n’est loin, l’un de ces livres qui ne ressemblent à rien. »
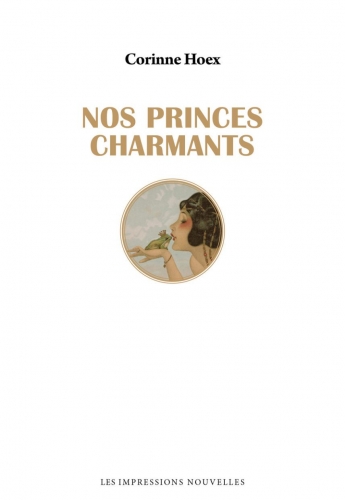
Avec Nos Princes charmants, un recueil de dix-huit nouvelles aux allures de roman tant les mêmes personnages (des mouches, par exemple), les mêmes éléments s’y retrouvent d’un chapitre à l’autre (comme dans les aventures de Tintin et Milou), elle récidive dans le genre ironique - et surtout vengeur - en dépeignant une belle galerie de mufles, casse-pieds & autres butors, victimes de revanches féminines. Qu’il soit collectionneur d’animaux empaillés, macho de synthèse, époux volage, cycliste obsessionnel ou satrape d’appartement, le type (si j’ose dire) d’homme dépeint parmi ces mâles ô combien odieux reçoit la monnaie de sa pièce. Point n’est besoin d’être féministe, ni même masochiste, pour jubiler au fil des pages et pour se divertir de la riche cruauté de Dame Corinne, dont le porte-fantasme, Françoise, écrit des polars. La morale de ces Princes charmants ? Ne jamais, au grand jamais, exaspérer un écrivain, mâle ou femelle, en qui, avouons-le une fois pour toutes, sommeillent des instincts meurtriers qui ne demandent qu’à être, enfin, assouvis.
Christopher Gérard
Corinne Hoex, Nos Princes charmants, Les Impressions nouvelles, 128 pages, 14€
Voir aussi :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2014/04/29/decollations-5358456.html
Il est question de Corinne Hoex dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures, XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







