09 juin 2016
Les libres mémoires de Jacques Franck

Légende vivante de la vie culturelle belge, le baron Jacques Franck (1931) livre enfin ses « libres mémoires » aux milliers de lecteurs, qui, parfois depuis des décennies, le suivent au fil des pages de La Libre Belgique, le prestigieux quotidien dont il fut naguère le rédacteur en chef.
Né dans une vieille lignée d’Anvers - l’un de ses aïeux ne fut-il pas, au XVVIIIème siècle, amiral de la flotte espagnole ? - , Jacques Franck incarne le patricien du pilier catholique… et, en même temps, une figure atypique de l’intelligentsia belge, en tout cas l’une des plus attachantes. Journaliste dans l’âme depuis la fin de la guerre, passionné par l’acte de comprendre au point d’avoir fait de l’impératif latin Intelligite (« Comprenez ! ») sa devise nobiliaire, Jacques Franck est aussi un critique fort écouté (l’un des derniers, je le crains) pour qui le monde des livres, du théâtre et du ballet ne recèle plus guère de secrets. Depuis soixante ans, l’homme a connu tout le monde, du leader socialiste Guy Spitaels à la Princesse Lilian, de Marguerite Yourcenar à Maurice Béjart, de Philippe Beaussant à Bernard de Fallois. Il a fréquenté les théâtres, les bars et les salons ; il a hanté le Sénat et la Maison du Peuple avant sa démolition ; on le croise le soir au Cercle Royal Gaulois artistique & littéraire ou à l’Opéra de la Monnaie. Il a connu Tournai en flammes à l’été 40 et le fracas des V1 tombant sur Anvers, l’Affaire royale et la décolonisation, le service militaire (bel éloge du drill : « danseur ou soldat, même beauté, même combat !») et cette fameuse crise d’un jour durant laquelle Baudouin le Catholique, par une « imprudence royale », se plaça dans l’impossibilité de régner, pour ne pas signer la loi dépénalisant l’avortement.
Justement, Jacques Franck dirigeait alors le principal quotidien catholique, auquel il fit prendre un tournant libéral, car cet homme de conviction se méfie des utopies comme des blocages mentaux, en subtil disciple de Machiavel et de Tocqueville, en bon élève des Jésuites aussi, dont il subit la férule à Namur avant de terminer son droit à Louvain, à l’époque francophone. Toute un Belgique, de jadis et de naguère, d’aujourd’hui et de toujours, apparaît au fil d’un récit rédigé comme un roman d’aventures, tant l’écrivain parvient à transcrire son inlassable curiosité, servie non seulement par une mémoire phénoménale, mais aussi et surtout par une culture éblouissante. Des moralistes du Grand Siècle aux Romantiques allemands, qu’il connaît par cœur, des cadets dont il salue les premiers livres (j’en sais quelque chose) aux grands historiens français, Jacques Franck a beaucoup lu et assimilé, et davantage réfléchi, tel un petit-fils d’Erasme. De Stendhal aussi, quand il évoque son premier voyage en Italie vers 1956, suivi de nombreux autres. L’Allemagne de Goethe et d’Hölderlin lui est aussi une patrie, et Berlin sa ville préférée.
La Vie est un voyage se révèle bien plus précieux qu’un livre de mémoires, car à l’érudition se joint l’essentiel, la sensibilité, exprimée avec tact, toute en nuances. Esthète et moraliste, l’homme cultive la probité et pratique l’amitié avec élégance. Saluons !
Une citation pour la route : « on ne bâtit pas sur l’improvisation, même inspirée, ni sur les sentiments, même généreux. Une pensée procède d’un dialogue toujours renouvelé entre la raison et le cœur, entre l’acquis et l’innovation. Enfin, un grand journaliste doit avoir le sens de l’Etat. »
Christopher Gérard
Jacques Franck, La Vie et un voyage. Libres Mémoires, Ed. L. Wilquin, 344 pages, 25 €
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : belgique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29 décembre 2015
Compagnons d'aventure
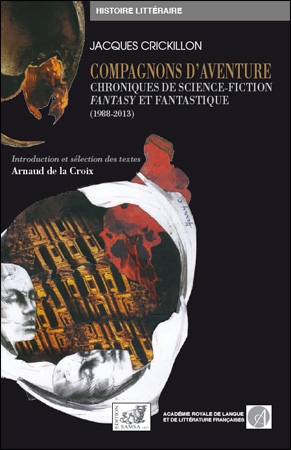
Romaniste ayant marqué des générations de lycéens et d’étudiants du Conservatoire royal de Bruxelles, Jacques Crickillon (1940) est l’une des voix majeures des lettres belges. Voyageur passionné de mythes, poète exigeant, prosateur inclassable (donc intéressant), il a aussi mené une carrière de critique littéraire passionné dont les avis parfois tranchés étaient attendus avec inquiétude par les impétrants comme par les vieux briscards.
Indifférent au qu’en dira-t-on, rétif aux conformismes des gens de lettres, l’homme s’est intéressé, aussi, aux littératures dites de marge, de genre, voire aux paralittératures. C’est précisément ce qu’illustre le joli volume concocté pour l’Académie royale par Arnaud de la Croix, le spécialiste des livres maudits. De 1988 à 2013, Jacques Crickillon a rédigé pour la revue belge des bibliothécaires des notes de lecture d’une rare liberté d’esprit et de ton. Aujourd’hui, c’est un recueil de ces chroniques qui paraît sous une élégante jaquette, toutes consacrées à la science-fiction, à la fantasy et au fantastique.
Science-fiction ? Par les mânes de Sainte Beuve ! Prévoyant les moues crispées des uns et des autres, le poète et critique met d’emblée les point sur les i : « ce genre méprisé par les peigne-culs de la pseudo-culture véhicule depuis plus d’un demi-siècle les seules interrogations qui comptent, celles de la morale et de la métaphysique ». Pour Jacques Crickillon, toute forme de paresse et de refus de l’imaginaire est à bannir. A bon lecteur, salut.
Van Vogt, l’immense Dick, le très-subversif Spinrad, Ballard et Zelazny font l’objet d’éloges mémorables. De même, les maîtres du fantastique, les Belges Owen, Prévot, le trop méconnu, et Muno, sont à juste titre encensés. Et Tolkien, et Lovecraft, et Machen, et Dunsany…
Ewers et Kubin ne sont pas oubliés, ce qui en dit long sur le goût et la science du critique !
Christopher Gérard
Jacques Crickillon, Compagnons d’aventure. Chroniques de science-fiction, de fantasy et de fantastique (1988-2013), SAMSA-Académie royale, 276 pages, 22€
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature, fantastique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26 novembre 2015
Noble Belgique
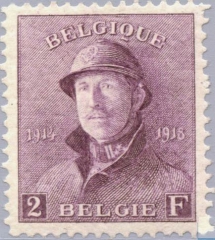
Les bons Dictionnaires amoureux tiennent davantage de l’autoportrait que de l’encyclopédie, d’où leur charme et leur intérêt. Cette règle, le Dictionnaire amoureux de la Belgique l’illustre à la perfection : gourmand jusqu’à la boulimie, d’une précision parfois maniaque, érudit jusqu’au vertige, surprenant autant qu’original avec une touche d’excentricité « bien belge », passionné comme un jeune homme, tel se révèle Jean-Baptiste Baronian. Oui, vous avez bien lu : il aura fallu un Arménien d’Anvers pour composer cette si bienvenue défense et illustration de la Belgique.
D’Académie (pour ne pas débuter par Adamo) à Yourcenar, cette somme de sept cents septante pages aborde mille domaines, des plus prévisibles (« art nouveau, tarte à la crème de la culture en Belgique ») aux plus farfelus (Agathopèdes & Bollandistes). Chicon (endive belge), crevettes grises, speculoos, anguilles au vert, waterzooi combleront les gourmets (de même qu’un hommage à Gaston Clément, qui régna naguère sur les cuisines belges); balle pelote, billard et cyclisme amuseront les sportifs. L’ahurissante érudition de l’auteur lui permet de brosser un tableau de la musique en Belgique, notamment contemporaine, car Jean-Baptiste Baronian ne brime jamais son inlassable curiosité : s’il connaît Grumiaux, Beaucarne et Grétry, il n’ignore rien des compositeurs actuels les plus pointus. Les écrivains, on s’en doute, sont à la fête, d’Owen à Prévot, sans oublier Simenon, une autre passion de l’auteur, et Gevers, et Froissart. Intarissable sur les peintres (bel éloge de James Ensor), Baronian connaît aussi le folklore et la bière. Et les belgicismes, qu’il défend avec courage. Une synthèse donc, savoureuse et stimulante – comme la Patrie des Arts et de la Pensée.
Christopher Gérard
Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire amoureux de la Belgique, Plon, 772 pages, 25€.
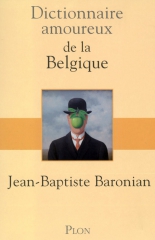
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : belgique, littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12 mai 2014
Avec Jean-Baptiste Baronian

L’Ecole belge de l’étrange
Paradoxal Jean-Baptiste Baronian ! Ce fils d’exilé arménien, né à Anvers et installé tout jeune à Bruxelles, s’est rapidement révélé, dès les années 70, comme l’un des plus fins connaisseurs de ce qu’il a justement appelé l’école belge de l’étrange. Il a donc fallu à la Belgique littéraire un outsider complet, lui-même éditeur et écrivain, pour révéler l’une de ses plus étonnantes facettes, car le fantastique et le réalisme magique, très présents chez les écrivains belges, constituent l’un des fondements - sans rien de marginal - de leur paysage mental. C’est le sujet d’une lecture publique qu’il a donnée à l’Académie royale, et qu’il reprend dans une synthèse bienvenue.
Depuis La Jeune Belgique au moins, depuis les années 1880, les « fantastiqueurs », comme disait Théophile Gautier, sont légion dans la Patrie des Arts et de la Pensée. En témoignent nombre d’œuvres de Ghelderode et de Jean Ray, de Gérard Prévot et de Franz Hellens, et plus près de nous d’Anne Richter et de Jean Muno, voire de Bernard Quiriny et de l’auteur de ces lignes. Dans sa causerie, Baronian repère les influences du symbolisme (Bruges-la-Morte !) et du naturalisme expressionniste sur les auteurs fantastiques d’hier et d’aujourd’hui. De même, la double culture latine et germanique a joué un rôle dans l’éclosion d’une sensibilité sans rien de régionaliste.
Baronian qualifie à juste titre ces écrivains d’insurgés : « des francs-tireurs, des rebelles, des frondeurs … n’acceptant pas la pesante tyrannie du réel ». Longtemps ignoré des faux puristes et des « petits profs de français dénués de discernement » (dont quelques académiciens que Baronian égratigne au passage… au sein même de leur compagnie), le fantastique a reçu sa légitimation littéraire d’en bas, des vrais lecteurs et non des machines à lire. Faut-il dire et répéter que le seul adoubement qui compte est celui des passionnés, des amateurs, au contraire de l’indulgence trafiquée des tâcherons, stérilisés par les dogmes ?
Christopher Gérard
Jean-Baptiste Baronian, La Littérature fantastique belge. Une affaire d’insurgés, Académie royale de Belgique, 64 pages, 5€
*
Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,
aux éditions L’Age d’Homme
http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0
Entretien
Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre itinéraire?
J’ai toujours eu du mal à me définir, à m’analyser, à admettre que je serais peut-être ceci ou peut-être cela. Sans éluder la question, je songe à ce que dit Valery Larbaud, une des principales figures de mon panthéon. À ses yeux, l’essentiel de la biographie d’un écrivain consiste dans l’histoire de ses livres et de ses lectures. Mon histoire à moi, mon itinéraire, c’est donc tout ce que j’ai publié depuis le début des années 1970 jusqu’à ce jour : plus de soixante livres, des dizaines de préface, des milliers d’articles… Et c’est également toute ma bibliothèque dont mon entourage prétend qu’elle est des plus imposantes. Mais ce sont aussi mes disques qui sont innombrables, presque tous des disques de musique dite classique et de musique dite contemporaine, mes dilections couvrant un spectre très large, de Bach à Kagel, en passant par Beethoven, Verdi, Brahms, Debussy, Strauss, Britten ou Chostakovitch.
Quelles ont été pour vous les lectures qui vous ont le plus durablement marqué ?
Il y a en plusieurs. La première, c’est sans conteste L’Ile au trésor de Stevenson que je considère comme un des plus beaux romans jamais écrits, peut-être même, du point de vue formel, comme le roman le plus parfait. Je l’ai lu et relu plus de dix fois, et chaque nouvelle lecture m’a conforté dans mon enthousiasme. Je vous citerai ensuite les romans de Dostoïevski et de Faulkner ainsi que les nouvelles de Poe, de Kipling et de Borges… Et puis, dans le désordre, Le Capitaine Fracasse de Gautier, Madame Bovary de Flaubert, l’admirable Dominique de Fromentin, les Histoires désobligeantes de Bloy, Fermina Marquez de Larbaud… Je n’oublie pas non plus Chesterton, Céline, Bernanos, Morand, Greene et Guérin. Ni, bien sûr, Simenon que je relis sans cesse et dont chaque livre constitue une prodigieuse et perpétuelle redécouverte. Ni James Cain, Horace McCoy, David Goodis et Charles Williams dans le vaste domaine de la littérature policière… Je reste aussi « durablement » marqué par des poètes : Villon, Baudelaire Verlaine, pour moi le plus grand poète français, Apollinaire, Elskamp, Fargue que j’adore, Pessoa, Thiry, Follain… Bon Dieu, tous ces noms que j’évoque me donnent le tournis !
Les grandes rencontres?
Je vais me contenter de ne citer ici que trois personnes : un artiste, un écrivain et un libraire. L’artiste, c’est le peintre abstrait Jo Delahaut dont la rigueur intellectuelle m’a toujours fasciné, un homme ouvert à tout, à toutes les formes de la création, à toutes les aventures de l’esprit. L’écrivain, c’est Jean Muno. J’ai fait sa connaissance vers les années 1973 ou 1974, alors que je travaillais à mon anthologie La Belgique fantastique. J’avais lu dans des revues quelques-uns de ses nouvelles et je m’étais tout de suite rendu compte qu’elles avaient un ton différent, qu’elles étaient pour ainsi dire subversives, ne serait-ce que par rapport à celles, plus classiques, de Thomas Owen. Malgré notre différence d’âge, nous sommes rapidement devenus des amis – je préciserais des amis rares par notre métier. Ensemble, nous parlions surtout des problèmes inhérents à la création romanesque : comment mettre en scène un personnage, comment développer un chapitre, comment équilibrer la structure d’une histoire, bref tout simplement comment écrire, et le faire chaque jour… La disparition brutale de Jean Muno en 1988 m’a laissé littérairement orphelin… Quant au libraire, il se prénomme André, un Flamand pétri de culture française. Il travaillait à la librairie Corman à Knokke lorsque je n’étais encore qu’un jeune homme. Il m’a initié à toute une série d’auteurs dont on ne m’avait jamais parlé au collège et dont on ne trouvait pas à l’époque les œuvres dans les collections de poche : Gracq, Borges, Calet… Je lui dois beaucoup, beaucoup d’émotions littéraires. Je lui ai d’ailleurs rendu hommage dans mon discours de réception de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.
D'où vous est venue cette passion - car vous êtes un homme de passions, n'est-ce pas? - pour le roman policier?
Je n’ai pas une réponse toute faite à cette question. Je sais que j’ai le goût du mystère et de l’étrange, que j’aime les histoires énigmatiques, celles qui tiennent en haleine et vous incitent à tourner les pages, sans presque jamais lever les yeux. En un mot, j’aime le suspense, et même dans des romans qui ne reposent pas sur une intrigue criminelle. En réalité, je suis extrêmement sensible à la construction d’un roman et je dois reconnaître que les auteurs de policiers sont d’ordinaire de très habiles architectes et de formidables meneurs de jeu. Voyez Agatha Christie, sa mécanique est prodigieuse… Sans compter qu’elle a du style et qu’elle manie l’ironie avec brio. C’est ce qui explique en grande partie pourquoi elle échappe au purgatoire des lettres… Et puis ce que j’aime dans le roman policier, c’est qu’il sacralise d’emblée et sans détours des tensions, des crises, des situations tragiques ou violentes, souvent jusqu’au paroxysme. C’est particulièrement le cas dans les romans noirs anglo-saxons, par exemple aujourd’hui chez des auteurs comme Dennis Lehane, Ken Bruen, Michael Connelly ou Daniel Woodrell.
Passion que vous illustre aujourd'hui avec Le Bureau des Risques et Périls, du nom de cette mystérieuse officine dépendant directement, si mes informations sont exactes, du Premier Ministre. Roman d'une conjuration, pastiche de crime parfait, version quelque peu subversive du Cluedo … Mais qu'est-ce que ce livre en fin de compte?
Qu’est-ce que ce livre ? Peut-être un OLNI. Entendez : un objet littéraire non identifié. Il ressortit à la fois au roman d’énigme, au vaudeville, à la parodie, au jeu de rôles, au roman humoristique, à la parabole genre Chesterton, au roman unanimiste puisque aussi bien aucun des personnages mis en scène n’en est réellement le héros… Je ne vous cache pas que j’ai éprouvé du plaisir à l’écrire, mais sans trop savoir si ce plaisir serait partagé ou non. On est toujours seul et égoïste quand on écrit – seul et égoïste avec ses idées, y compris ses idées fixes, avec sa façon de voir et de concevoir son livre.
Vous y maniez un humour noir, fataliste même…
Je vais enfoncer une porte ouverte : l’humour n’est jamais rose, il est toujours noir et fataliste, quand bien même il se dissimulerait derrière de jolis sourires enjôleurs et des pitreries. En quoi sans doute mon Bureau des Risques et Périls n’est pas seulement, je crois, un simple entertainment, mais aussi une charge contre un certain modus vivendi dans le monde actuel. Mais je m’empresse d’ajouter que je ne suis pas pour autant un donneur de leçons, et encore moins un moraliste. Mon humour noir, au fond, il est naturel, ou presque. C’est à peine si dans mon livre, j’accentue les traits de caractère et me moque de mes personnages.
Bruxelles n'est-elle pas l'un des principaux personnages de votre roman?
Vous avez raison, Bruxelles est partout présent dans ce livre. Il l’est du reste dans la très grande majorité des œuvres de fiction que j’ai publiées au point, me semble-t-il, qu’on peut en parler comme un personnage récurrent. Je me demande même si on ne pourrait pas regrouper tous mes romans sous un seul titre générique : Les Mystères de Bruxelles.
Vos projets?
J’en ai plusieurs. Je mets actuellement la dernière main sur un nouveau roman, un roman noir dans la veine un peu sombre de Matricide, de Rase campagne et de L’Apocalypse blanche. Je travaille aussi sur un essai consacré à Verlaine. Après avoir écrit sa biographie et, par la suite, celle de Rimbaud, je me suis rendu compte que le cadre même de la biographie, qui est un genre en soi, m’empêchait de m’attacher à tel ou tel aspect de mon personnage et de faire état de commentaires circonstanciés sur ses œuvres. Ce sera également l’occasion de mettre à bas diverses idées reçues le concernant. La plupart des exégètes de Verlaine prétendent ainsi qu’après Sagesse qui date de 1881, il n’a plus rien produit d’important et que sa poésie s’est desséchée. C’est absurde !
Propos recueillis par Christopher Gérard
Bruxelles, février 2010.
Lire aussi :
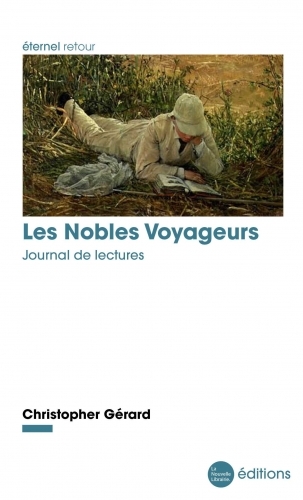
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature, belgique, fantastique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10 octobre 2013
Le Monde de Charles Bertin

Paradoxal Charles Bertin : écrivain secret (surtout en France, puisqu’il était belge et l’on connaît la condescendance de mise à l’égard des écrivains belges), pourtant couvert d’honneurs (prix en rafales, Académie royale, postes multiples), l’homme a laissé, outre des pièces de théâtre, des poèmes et des romans, deux bijoux à découvrir d’urgence : Le Voyage d’hiver * (L’Age d’Homme) et La petite dame en son jardin de Bruges (Actes Sud). Un roman d’amour, un récit de l’enfance, tous deux bouleversants et rédigés d’une plume ferme, adamantine. Deux classiques, appelés à durer, même si la critique universitaire, toujours aussi docile aux modes, semble les négliger - et n’est-ce pas mieux ainsi ?
Neveu de Charles Plisnier (le premier Goncourt belge, en 1937, avec Faux passeports), Charles Bertin (1919-2002) fréquenta dès son plus jeune âge les grands noms des Lettres belges : Roger Bodart, Dominique Rolin, Marcel Thiry, Suzanne Lilar, Georges Sion… Très tôt encouragé par Paul Valéry, Bertin fut donc une sorte de surdoué des Lettres, un enfant du sérail à qui tout réussit. Avocat, puis apparatchik du pilier socialiste bruxellois, militant de la cause francophone, l’homme dépassa par le haut tout ce qui aurait pu le réduire au rang de notable d’une certaine gauche caviar, comme en témoignent les deux chefs-d’œuvre évoqués plus haut. Bibliophile, il se disait écrivain français, ou plutôt picard, fidèle en cela au Manifeste du Groupe du Lundi (1937) selon lequel la Belgique faisait partie intégrante « de cette entité, indépendante de toutes les frontières, qu'est la France littéraire ». Vieux débat entre écrivains français de Belgique et belges de langue française. Le regrette Pol Vandromme, par exemple, se rattachait aux premiers. Mais peut-on qualifier Joyce d’écrivain anglais… même si Cioran, pour n’en citer qu’un, est clairement un écrivain de France ? Vaste problème, mon général. Ce qui est amusant, c’est de constater à quel point Bertin était, comme nombre de ses compatriotes, mêmes francolâtres, marqué par l’univers germanique : Le Voyage d’hiver ne fait-il pas référence au Winterreise de Schubert ?
L’élégant volume que lui consacrent les Archives et Musée de la Littérature, quoique scolaire et inégal, offre une belle occasion de mieux connaître cet écrivain de haut parage qui, toute sa vie, se mit en quête d’un au-delà poétique qui n’est pas celui des dévots.
Christopher Gérard
L. Pieropan dir., Le Monde de Charles Bertin, AML Editions, coll. Archives du futur.
*Amélie Nothomb (prononcer le b final) a, paraît-il, publié un roman sous le même titre. De même, La Souille, le chef-d’œuvre de l’incivique Paul Werrie, publié naguère au Mercure de France, a inspiré un géant des Lettres parisiennes, Franz von Giesbert.
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : bertin, littérature belge | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







