26 février 2008
Guy Dupré, clandestin capital
Concernant cet écrivain, voir mon Journal de lecture,
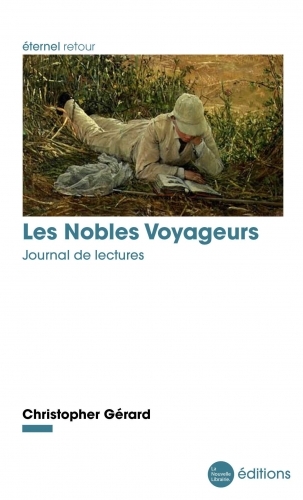
Entretien avec Guy Dupré
Christopher Gérard: Qui êtes-vous? Toute votre œuvre, essais et romans confondus, témoigne d'une puissante nostalgie, celle d'un Ordre mystique et guerrier. Quelles sont les racines de cette double vocation sacerdotale et militaire?
Historiquement parlant, j’appartiens à la première génération française d’anciens non combattants. J’étais de l’une des trois classes exemptées du service militaire pour avoir été touchées, pour ceux qui n’étaient pas étudiants, par le S.T.O. À l’âge de Guy Môquet j’étudiais l’Énéide au lycée Henri IV dans la classe de Georges Pompidou. Un de mes camarades de seconde, au collège de Saint-Germain-en-Laye, Marco Menegoz, rejoignit un maquis en 44 : fusillé sans qu’on ait donné son nom à une station de métro. Autre condisciple, Pierre Sergent, engagé en 44 et devenu capitaine dans la Légion étrangère ; lors du putsch d’Alger, il rallia ceux que le général de Gaulle a appelé les « officiers perdus ». Un autre, Michel Mourre, affilié à dix-sept ans au francisme de Marcel Bucard, entra au séminaire, y perdit la foi, et se retira d’une autre façon du siècle en s’attelant à son monumental Dictionnaire d’Histoire universelle. J’avais dû, pour ma part, mes rations de survie aux Baudelaire et Rainer Maria Rilke, aux Normands Flaubert et Barbey d’Aurevilly, aux Apollinaire et Milosz qui n’avaient pas une goutte de sang français dans les veines. Sans prétendre à substituer la satiété à la disette, j’entrai dans l’après-occupation avec la volonté de me revancher sur les années de rationnement et dénutrition qui avaient menacé mes sources vives. A mon aversion pour les sectateurs de l’absurde, sartreux et camusards, se liait mon rattachement intérieur à l’ordre militaire mort à Hiroshima, où naquit la mère de mon père. Une sorte d’obligation de participer au Vème acte de l’armée sur les théâtres d’opérations extérieures, en supplantant dans son ton le souffleur. D’exprimer à ma façon « le trouble de l’armée au combat » selon l’expression du général de Gaulle, dont le général Weygand, qui lui non plus n’avait pas une goutte de sang français dans les veines, me disait qu’il « n’avait pas trop de deux églises à Colombey pour s’y confesser de ses péchés ». Au croa-croa des corbeaux au col Mao ce serait préférer le chant du cygne de l’antique honneur militaire. Chant du cygne qui me mettait dans tous mes états – ces états qui me feraient remonter jusqu’aux débuts de la guerre franco-française, commencée avec la dégradation du capitaine Dreyfus pour finir avec l’exécution du colonel Bastien-Thiry. L’honneur du capitaine Dreyfus est de n’avoir jamais été dreyfusard. Le péché de Barrès, comme celui du Bernanos de La grande Peur des Bien-Pensants, est de n’avoir pas compris que Dreyfus était de leur bord, lié par le secret professionnel, et qu’il importait de l’isoler, de le détacher de son parti, pour honorer en lui l’officier perdu, l’officier sauvé d’un chapitre inédit de Servitude et grandeur militaires.
Parmi les constantes de votre œuvre, il y a cette loi de Sainte-Beuve. Comment s'est-elle imposée à vous?
C’est dans son unique roman, Volupté, que Sainte-Beuve, qui fit Hugo cocu, a placé dans la bouche de son héros Amaury l’énoncé de ce que j’ai appelé la « loi de Sainte-Beuve ». Amaury, né dans les dernières années da la monarchie, raconte à un jeune ami les souvenirs de jeunesse de sa propre mère : « Comme les souvenirs ainsi communiqués nous font entrer dans la fleur des choses précédentes et repoussent doucement notre berceau en arrière ! » Pour nous, retourner vers la mémoire d’avant, ce serait le temps que nos mères apprirent à épingler de petits drapeaux sur la carte des départements envahis. Trop jeunes pour devenir veuves, elles correspondirent avec le promis dont elles étaient les marraines de guerre. Entre la communauté des « morts pour la patrie » et nos esseulements, une transfusion s’opérait. Nous n’aurions pas trop de cette jeunesse souterraine pour réchauffer l’hiver de la feue France. Quant à la querelle entre maréchalistes et généralistes, comment aurions-nous pu opposer le général me voici au maréchal nous voilà ? Pareils à ces tritons barbus, ces monstres marins que Marcel Proust entrevoyait à l’Opéra, dans l’ombre transparente de la baignoire de la princesse de Guermantes, et dont on n’aurait su dire s’ils étaient en train de pondre, nageaient ou respiraient en dormant. Comment les jugerions-nous, les opposerions-nous, quand, à nos yeux, leur justification secrète était de nous entretenir dans le mystère douloureux et glorieux d’où tout découle et qui s’appelle le mystère du temps ?
Votre premier roman, Les Fiancées sont froides, s'inspire du romantisme allemand bien plus que du surréalisme. Thanatos me paraît la figure tutélaire de ce livre ensorcelant, et la désertion l'un de ses thèmes principaux. Après vingt-huit ans de retraite, vous publiez Le grand Coucher, un peu votre Guerre civile. Avec Les Mamantes, vous développez le thème de la Mère (si possible veuve), préférable à la Fille (si possible vierge). Peut-on y voir le reflet d'une obsession, celle du refus d'engendrer? En fin de compte, l'écrivain n'est-il pas souvent fils et père de personne?
Dans chacun de mes trois romans le narrateur s’adresse à l’autre : dans Les Fiancées sont froides le hussard devenu écrivain public s’adresse à un hussard qui pourrait être son fils et qui a lui-même déserté ; dans Le Grand Coucher le récitant dédie son mémoire à la veuve qui servait d’appeau au colonel recruteur ; l’amant en deuil des Mamantes explique à une jeune vivante pour quelles raisons occultes il a si longtemps refusé de lui faire l’amour « à la papa ». Il y a chez les trois désertion, abandon de corps, refus de reconnaître le père comme le fils – trahison de l’histoire humanoïde au profit d’une affiliation d’ordre extra-mondain. Il leur faut transgresser la loi naturelle, substituer à la loi du sang qui régissait l’ancien pacte social la règle d’une transmission elle-même garante d’une filiation élective.
Quel regard jetez-vous sur les Lettres françaises d'aujourd'hui? Quelles lectures conseilleriez-vous à un impétrant?
Même en littérature, disait Barrès, il y a avantage à n’être pas un imbécile. Nuançons le propos : « Il y a avantage, en littérature, à ne pas entrer dans la descendance de Monsieur Homais » - avantage à ne pas prendre les lampions du 14 juillet pour les lumières du siècle. « Je m’ennuie en France, disait Baudelaire, parce que tout le monde y ressemble à Voltaire ». Aujourd’hui comme avant-hier la référence aux « lumières » est un cache-misère et le laïcisme dévot la canne blanche dont les mal-voyants se font un gourdin. A l’âge où je ne voyais pas très clair, trois livres m’avaient aidé à remettre la pendule à l’heure : Les Sources occultes du romantisme, d’Auguste Viatte ; L’Âme romantique et le rêve, d’Albert Béguin ; La Poésie moderne et le sacré, de Jules Monnerot. A ce trio salvateur, permettez-moi d’ajouter le théologien allemand H. Urs von Balthasar, dont Albert Béguin m’avait cité ce passage sur le temps que j’aimerais choisir comme épigraphe et épitaphe : « Des temps et des destins antérieurs reçoivent leur sens de temps et de destins ultérieurs, les temps antérieurs sont si peu enfermés dans le moment de la durée qu’ils ont occupé et si peu irrévocablement passés qu’ils restent au contraire directement accessibles en tout temps. Et cet accès est de telle nature qu’il détermine leur essence – passée seulement en apparence – et qu’il les transforme continuellement avec le progrès du temps. »
Paris, le 13 novembre 2006
Publié dans La Presse littéraire, décembre 2006.
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, guy dupré, nimier, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12 septembre 2007
Les Demoiselles du Taranne
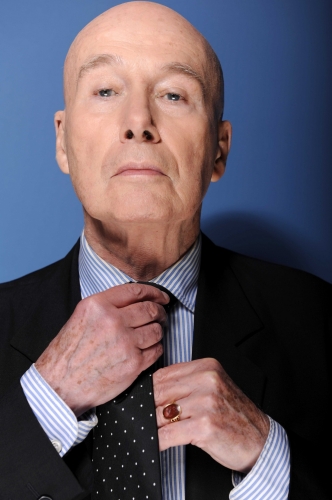
Harem Saint-Germain
La lecture de ce volume du Journal 1988 de Gabriel Matzneff sera pleine d'enseignements pour tous ses aficionados: cette année faste ne vit-elle pas la parution (impensable en 2007) d'Harrison Plaza, roman des tumultueuses amours avec "Allegra", la tendre souris que le fauve avait attirée dans ses griffes? Largué par la nymphette peu avant la sortie du livre qu'elle avait inspiré, l'écrivain se lance alors dans un galop d'enfer qui donne le tournis: les demoiselles se bousculent dans le plume de l'hôtel Taranne comme les prénoms s'accumulent sous la plume du diariste. De nombreux crochets témoignent du recul des libertés en vingt ans: les avocats veillent au grain, les éditeurs retranchent l'ivraie … et l'écrivain en est pour ses frais. Il est vrai que, in illo tempore, toutes les victimes du Monstre n'avaient [peut-être] pas l'âge requis. Cette valse rose entraîne notre Don Juan dans les affres d'une jalousie, ô combien incongrue, qu'il noie dans le bon vin, celui qu'il lampe chez Lipp - quelle fortune il aura claquée dans cette célèbre brasserie! - ou en compagnie d'amis fidèles (Cioran, Vrigny, Giudicelli, Pierre-Guillaume de Roux…). Au fil des pages, le lecteur attentif reconnaîtra l'intrigue d'un roman à venir, Les Lèvres menteuses, à paraître en 1992. Matzneff a donc mille fois raison d'affirmer que ses passions nourrissent son œuvre: même en gamahuchant Marie-Ségolène et Nicoletta, il note le détail pathétique ou hilarant, la répartie qui fait mouche. Une telle conscience professionnelle mérite d'être soulignée! Sa quête effrénée du plaisir, qui prend ici des allures de travaux forcés, dicte ces mots à ce chasseur jamais en repos: "Quelle comédie, l'existence! Quelle pitoyable et ridicule et toute-puissante prison, les passions!". Amoureux d'un plaisir donné et reçu comme d'un français servi de façon seigneuriale, le styliste Matzneff ne célèbre jamais que les passions d'un homme atteint de ce que Marsile Ficin, cité à la dernière ligne du Journal, nommait la rabies venerea, la rage vénérienne. Curieusement, peu de visages féminins émergent réellement de ce harem Saint-Germain: la plupart des demoiselles sont décrites à la hussarde, séduites et remplacées en cinq sec. Ce carpe noctem, entonné sur tous les tons, est-il sincère? Mystère. En revanche, lorsqu'il évoque un endroit disparu, un ami emporté par la maladie, Matzneff bouleverse son lecteur. Ainsi, Guy Hocquenghem est salué avec émotion par un débauché devenu pudique comme une jeune fille. Une phrase de Maupassant, que Matzneff découvre avec une joie communicative, me paraît révélatrice: "Je n'ai pas eu, en toute ma vie, une apparence d'amour, bien que j'aie simulé souvent ce sentiment que je n'éprouverai sans doute jamais".
Christopher Gérard
Gabriel Matzneff, Les Demoiselles du Taranne, Gallimard, 396 p., 22 euros.
Paru dans La Presse littéraire 10, été 2007.
Voir aussi Les Nobles Voyageurs
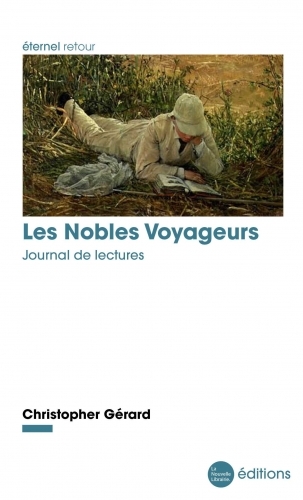
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, matzneff | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06 septembre 2007
Jean-Loup Seban
Otiose ou l’ociosité vengée
Tel est le titre d’un curieux opuscule qui se lit sous le manteau de Paris à Amsterdam et de Genève à Bruxelles. L’ouvrage, somptueusement édité par Magermans à Andenne, se présente comme « un préservatif contre l’éthique protestante du travail » : il s’agit bien d’un brûlot contre « l’infernale religion du labeur », mais aussi, horresco referens, contre « les négriers du Dieu terrible ». Le piquant de l'affaire est que son auteur est professeur de théologie et pasteur de l’Eglise Protestante Unie de Belgique! Lecteur de Bayle et du divin marquis (je veux dire Boyer d’Argens), Jean-Loup Seban est issu d'une vieille lignée alasacienne, qui a donné à la France des rabbins, puis des pasteurs et des officiers. L'homme est un érudit raffiné qui a tout lu en édition originale jusqu’à 1789 en dégustant du thé de Chine et des brioches au cacao. Ce théologien est un sybarite qui ne dédaigne ni les vins de Bourgogne ni un pâté de héron, qui a lu Sénèque et Pyrrhon avant d’enseigner à Oxford et à Princeton. Un homme singulier, auteur d'une œuvre qui ne ressemble à rien: Otiose ou l’honnête ociosité vengée, lequel se présente comme un roman philosophique tel que l’affectionnaient les moralistes du XVIIIè siècle. J.-L. Seban y développe avec grâce sa vision de la théologie rationnelle, de la bibliophilie (-manie ?), de l’amitié, et même des chats,… Manifeste déiste et pamphlet aristocratique, l’essai est rédigé dans « la langue des Quarante », pétrie de latinismes et de termes archaïques pêchés chez Scarron ou Rabelais. L’humour n’en est jamais absent, juste sous-entendu à l’anglaise (Maître Seban me pardonnera de ne point écrire « angloise ») : je songe à la parabole des abeilles, par exemple. Je l’ai lu (et découpé, puisque le volume n’est pas massicoté) avec une jubilation constante tant son allégresse est communicative, à mille lieues du jargon académique ou des autofictions triviales. J’en ai apprécié le libertinage intellectuel et spirituel, par exemple à propos de « Mahome », « le chamelier péninsulaire » ou de l’indispensable indocilité par rapport à la créance officielle. En vérité je vous le dis, la République des Lettres compte un écrivain de plus, et un écrivain de haut parage.
Questions à Jean-Loup Seban
Qui êtes-vous ?
Rejeton hybride d’une couple de traditions séculaires et antagonistes, la sépharade et la huguenote, j’ai longtemps suivi la foi ancestrale en son sillon orthodoxe, enduré son dogmatisme, son puritanisme et son intolérantisme. Aujourd’hui, dessillé, détrompé, émancipé, je me complais dans l’empyrée de la créance hétérodoxe, au panthéon duquel figurent notamment Uriel da Costa, Spinoza et Mendelssohn du côté judaïque ; Aubert de Versé, Tyssot de Patot, Dippel et Kant du côté chrétien, sans omettre François Hemsterhuis, l’Hellène. Les libertins érudits et les libres-penseurs exercent sur moi une fascination diabolique ! « Les vieux fous sont plus fous que les jeunes » disait La Rochefoucauld, le lucide. En ce repaire d’hérétiques, havre hospitalier, je me nourris d’une pensée éclectique, féconde et radiante, puisée aux sources du Grand Siècle et du siècle des Lumières.
Les grandes lectures et les grandes rencontres ?
Outre la pléiade académique de rigueur – Platon, Horace, Sénèque, Montaigne, Calvin, La Mothe Le Vayer, Bayle, d’Argens et Voltaire – une foison de minores, théologiens ou littérateurs, souvent moralistes, qui se révélèrent dans l’instant d’ensorcelants « maîtres muets. » Fors mes maîtres aux Hautes Etudes à Paris et quelques savants de renom, croisés au cours de mes voyages ou lors de colloques, aucune rencontre conséquente, à l’heureuse exception d’un érudit, chantre du Sublime, qui m’inocula la dilection bibliophilique, j’ai nommé : Daniel Berditchevsky. Comme l’ambition m’a négligé régulièrement et l’indocilité flatté avec autant de régularité, je n’ai jamais éprouvé ce désir, ni ressenti ce besoin, qui pressent ordinairement l’opportuniste à s’agréger à une école philosophique en vogue ou à s’inféoder à une secte maçonnique influente.
Qui est donc ce mystérieux Otiose que nous voyons évoluer, discourir et faire bombance en amicale compagnie ?
Un patricien d’autrefois, un protestant baptisé à l’Eglise Wallonne des Pays-Bas, qui demeure dans une cité marchande à la veille du grand basculement qui va transsubstantier la société et ruiner l’art de vivre. Nous sommes à l’automne de l’an 1765. Bientôt le travail perdra, au sein de la Res publica, son caractère de malédiction divine pour revêtir celui de bénédiction sociale. Otiose est un homme de loisir, hypocondre et un tantinet misanthrope. En religion, c’est un déiste ; en éthique, un épicurien discrètement teinté d’hédonisme et un thériophile ; en épistémologie, un pyrrhonien qui adopte, selon son besoin, le platonisme, le cartésianisme ou l’empirisme. Mais c’est avant tout un sage qui a eu la prudence de substituer l’amour intellectuel à l’amour sensuel, l’amitié à la passion charnelle ; un solitaire qui vit avec Anacharsis, son chat confucien, et Jeannot, son jeune protégé, et qui s’est entouré d’une poignée d’amés complices avec lesquels il disserte : un papiste, un juif, un athée et un mahométan.
Qu’appelez-vous ociosité ? Comment distinguez-vous cette ociosité du quiétisme voire du nihilisme ?
L’honnête ociosité (honesta ociositas), distinguée des autres formes d’otium, comme catégorie du temps social et privé, c’est d’abord le refus du travail rémunéré, de l’enrichissement, de l’action, du pouvoir comme entéléchies de l’étant (libido dominandi) ; c’est ensuite une philosophie pratique qui livre la manne céleste à la concupiscence intellectuelle de l’âme (libido sciendi) - la contemplation de la nature, la méditation du divin et la création poétique - sans renier pour autant les œuvres de la chair, si toniques. Il se pourrait bien que l’honnête ociosité occupât une place médiane entre le quiétisme du Grand Siècle, qui participe du salutaire retirement du monde, et le nihilisme du siècle des idéologies mortifères.
Votre personnage est tout sauf tendre pour les diverses confessions abrahamiques qu’elles soient hébraïques, papistes ou parpaillotes, ceux que vous appelez « les négriers du Dieu Terrible » en prennent pour leur grade. Peut-on lire votre essai comme une sorte de manifeste déiste ? Pastiche du livre du XVIIIème siècle, amusement d’érudit…ou confession d’un solitaire ?
Certes, Otiose vit à l’ombre de Voltaire. Vous avez parfaitement raison : c’est un manifeste en faveur du déisme, cette panacée philosophique qui prétendait guérir, au dix-septième siècle comme au dix-huitième, les maux sociaux et politiques engendrés par les querelles religieuses. A mon estime, le déisme est, aux côtés de la mystique, une voie de la transcendance qui affranchit le sujet pensant de la bibliolâtrie, du sectarisme et du communautarisme, fléaux d’aujourd’hui. Je vous concède volontiers que cet essai est un amusement de lettré, peut-être même un radotage d’érudit. Dans la clairière du soi, le bibliophile danse avec le moraliste. Ce nonobstant, je me rebecque contre la suggestion qu’il s’agirait d’un pastiche, bien que quelques pastiches l’embellissent. Car, au siècle des Lumières, personne n’écrit de cette manière. Ce style, perfidement archaïsant et précieux, latinisant parfois, pédantesque toujours, je le revendique hautement comme mien.
Puis-je aussi y voir un manifeste du dandysme, car il y a du Des Esseintes chez votre héros ?
Le rapprochement que vous proposez me surprend. Rassurez-vous, cette parenté accidentelle ne me gêne aucunement ! En vérité, le héros vit à l’image des gens de condition de son époque. En ce qui concerne ma posture littéraire, je ne crains point d’être taxé d’antiquomanie, ni d’ailleurs d’être stigmatisé pour mon amphigourisme, voire conspué comme esthète du verbe. Il me convient que ma posture soit résolument à contre-courant. Notre langue étant si élégante et opulente, et le sabir contemporain si vulgaire et indigent, c’est lui rendre hommage que d’exhumer des vocables choisis, de les rédimer de la désuétude où ils croupissent ! Le troupeau des litterati se divise, me semble-t-il, en deux classes : les brebis qui suivent le berger du « politiquement correct » et celles qui s’en écartent. Pour mon salut, j’appartiens à la seconde catégorie. Surtout qu’aucun berger ne s’avise à me contraindre à rentrer au bercail ! « On renonce plus aisément à son intérêt qu’à son goût » de l’aveu même du sapientissime duc et pair. D’une certaine manière, votre inquiétude philosophique rejoint la mienne. Mais que j’eusse aimé posséder ce courage qui est le vôtre, pour oser proclamer urbi et orbi l’horreur que l’anti-culture contemporaine m’inspire ! Elle a sur mon cœur l’effet d’un émétique. Au demeurant, si ma pensée et ma parlure avaient l’heur de déplaire aux coryphées de la bien-pensance et de la bien-jactance, thuriféraires stipendiés de la néo-barbarie, croyez bien que j’en serais fort satisfait. Une vocation, que je n’ai point, se trouverait magistralement justifiée, avant même que j’eusse à m’inquiéter de l’utilité éventuelle de mes lucubrations intempestives de petit savantas en robe de chambre.
Jean-Loup Seban, Otiose ou l’ociosité vengée, Ed. Magermans, Andenne, 20 €. Se trouve chez Touzot à Paris.
Lire aussi Les Nobles Voyageurs
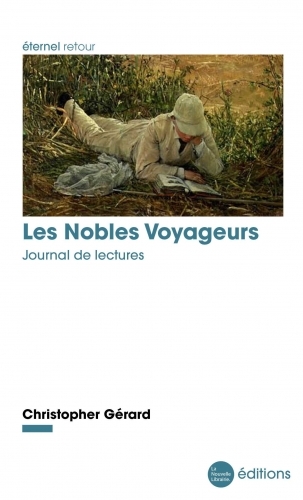
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05 septembre 2007
Bruno Favrit
Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,
aux éditions L’Age d’Homme
http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0
Grand voyageur devant les Immortels, Bruno Favrit est un adepte de la haute montagne, l’un de ces esprits solitaires qui aiment à méditer du haut des cimes. Dans son premier roman, qui fait suite à plusieurs essais (dont un rafraîchissant Nietzsche aux éditions Pardès), il entraîne le lecteur des sommets balkaniques aux vignes de Provence sur les traces d’un proscrit, un reître en cavale, rescapé d’une guerre perdue. Fanatiquement rebelle au monde techno-marchand, ce ksatriya égaré fuit le siècle et ses tentations, vivant comme un animal traqué et pratiquant une méditation sans rien de transcendantal. Il s’agit bien d’un périple spirituel, une peregrinatio, aventure autant intérieure qu’extérieure, et d’une leçon de liberté. L’homme recourt aux forêts et aux rochers pour s’immerger dans une nature divine, la seule loi qu’il accepte encore. Pour dépeindre cet éreintant parcours, B. Favrit use d’une prose anguleuse comme une paroi, dont l’âpreté souligne son indocilité foncière, celle du desperado. Disciple de Diogène et de l’empereur Julien, le héros nous convie à le suivre dans sa guerre sainte, celle qu’il mène contre les Infidèles – et contre lui-même. A lire ce récit abrupt, comment ne pas songer au fragment XVIII d’Héraclite : « Qui n’espère pas n’atteindra pas l’inespéré, qui est au-delà de toute recherche et à l’écart de toutes les routes » ?
Bruno Favrit, Criminel de guerre, Editions ACE, 126 p., 15€
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, montagne | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06 juillet 2007
Contre les Galiléens
Le Contre les Galiléens de l'empereur Julien (Ousia, 1995)
et Julianus redivivus (Antaios, 2002)
"La présentation et la traduction de Gérard sont d'une élégante érudition." Jacques Franck, La Libre Belgique
"Aisance du style, clarté de présentation, subtilité des analyses, tout est réuni pour permettre au lecteur avisé ou totalement néophyte de se sentir en pays de parfaite connaissance." André Murcie, Alexandre
"J'ai beaucoup plus apprécié la belle édition procurée par Christopher Gérard que l'imprécation elle-même". Marcel Conche, Antaios
"Comme vous l'aviez deviné, j'ai une certaine affection pour Julien et je trouve votre livre - traduction et commentaire - réellement tonique." Claude Imbert
"Julien est pour moi une figure mythique." Michel Maffesoli
"J'ai une particulière amitié pour l'Empereur Julien. C'est dire si votre petit livre m'a intéressé." Jean Dutourd
"Ces quelques pages montrent bien la ferveur de votre érudition. Le sujet, Julien, est admirable. Il y a toujours des moments dans la vie où son exemple fait chanceler." Michel Déon
"Merci pour votre jolie et intelligente plaquette sur notre ami Julien. C'était un type bien, comme nous disons par ici." Lucien Jerphagnon
"Merci de m'avoir adressé votre beau Julianus. Je demeure chrétien, mais je ne suis pas fermé à l'héritage polythéiste de l'Europe." Vladimir Volkoff
"Quarante pages d'érudition pure, un nectar digne des Dieux! (…) Mais les dernières pages de la brochure restent les plus fascinantes. C. Gérard y déverse assez d'idées, de vues, de réflexions, de pistes d'études et de préhension, pour nourrir les thématiques contradictoires de quatre ou cinq colloques…" André Murcie, Incitatus
Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : philosophie, paganisme, christianisme | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







