Yves-William Delzenne (03 mai 2007)
Concernant cet écrivain, voir mon Journal de lecture,
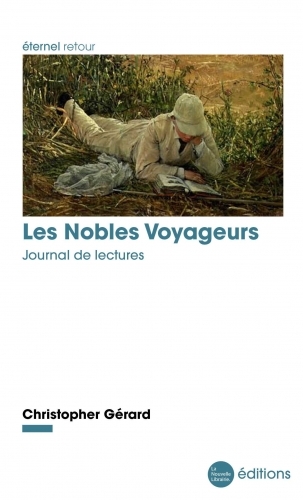
Afin de mieux faire connaître cet homme si singulier et au talent reconnu, je suis allé le voir dans son refuge ostendais.
Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment, vous, définiriez-vous celui que Jacques De Decker qualifie d’auteur belge « qui se distingue par sa discrétion et son élégance »?
D’abord, je ne me vois pas comme un auteur belge, pas davantage français. J’ai l’impression curieuse de traduire une langue inconnue quand j’écris dans ce français qui est le mien : un français le plus pur, le plus élégant et le plus précis possible. Le texte doit « chanter » au final pour rendre cette langue intérieure, exotique, qui est la mienne. Je suis quelqu’un de très exotique en somme. « Élégant et discret », cela me convient, je le prends comme un compliment. Mon monde de prédilection a toujours été celui des ambassades - j’ai eu des amitiés profondes dans ce milieu - parce que dans ce cadre mes qualités sont facilement reconnues, ailleurs je chante résolument trop haut, mais j’aime aussi les bouges, l’envers des villes, les vies cachées. On ne sait jamais qui je suis exactement, même moi peut-être.
Quelles ont été pour vous les grandes rencontres? Un mot sur vos débuts, l’atmosphère à l’époque, les salons…
Cocteau, Markevitch encore plus (même sur le plan, sinon littéraire [il a écrit ses mémoires cependant ] romanesque… de la personne), le prince Youssoupoff et Louise de Vilmorin. (Elsa Triolet dans le métro, pas un mot. Elle me regarda longuement. J’avais dix-sept ans.) En Belgique : Andrée Sodenkamp : une reine de l’alexandrin, un peu Folle de Chaillot dans la vie, et Marcel Lobet. Marcel Lobet m’a reconnu publiquement (secrètement aussi ; nous avons partagé ce qui, pour lui, était un lourd secret). Sa dernière lettre a été pour moi, sur son lit d’hôpital. Il me disait que de tous les livres lus, il désirait retenir le mien et partir avec lui. C’était L’Orage. J’ai beaucoup négligé la vie littéraire, belge et française, même si on m’a généralement - il y a maintenant plus de quarante ans - favorablement accueilli. Ce ne serait plus le cas aujourd’hui. Pour Jeanine Moulin, par exemple, je savais écrire, elle saluait cela. Si j’ai négligé cette vie, c’est qu’elle m’a paru ennuyeuse, compassée (contrairement à l’ambiance des ambassades - celle de l’Iran du Shah, par exemple, où je disais des poèmes devant des femmes couvertes de diamants et des jeunes secrétaires lustrés). J’ai fréquenté des salons, rares et déjà décrépits, mais j’ai aussi rencontré des poètes au sauna !
Les grandes lectures, les auteurs dévorés avec passion… et ceux que vous relisez quarante ans après vos débuts littéraires ?
Tourgueniev, Tolstoï, Pouchkine, Musset bien sûr. Une « poétesse » a cru m’insulter un jour en me traitant de Musset du vingtième siècle. Le plus beau compliment qu’on m’ait jamais fait. Nerval. Je relis sans cesse Les filles du feu. Stevenson dont j’adore Le Maître de Ballantrae. Zweig et Mann. Tonio Kröger a déclenché ma vocation. Je l’ai lu très tôt. À treize ans ! J’écrivais déjà des poèmes, déjà publiés dans des revues et dans Le Soir même… Passons. N’oublions cependant pas Dominique de Fromentin. La Redevance du fantôme d’Henry James. Maeterlinck et Apollinaire pour la poésie ; tant d’autres livres ! J’ai tout lu. Je lisais partout, pour m’éloigner de l’école, en tournée lorsque je faisais l’acteur comme un personnage de Nerval, dans les trains - j’en ai tant pris ! -, dans les hôtels - j’y ai vécu si souvent ! -, dans mon lit et ceux des autres. Je n’ai jamais beaucoup respecté les livres. Je les ai perdus, donnés, semés. On ne voit jamais de bibliothèques dans mes appartements. Mais je ne serais pas sincère si je n’évoquais pas la lecture - vers douze, treize ans aussi - des Faux monnayeurs de Gide. J’ai lu tout Gide mais je ne parviens guère à le relire. Tout Colette aussi dont j’aime toujours le français gras et fruité.
Justement, puisque nous parlons de littérature, vous avez rendu publique une protestation intitulée « Un peu de sérieux » (Evelyn Waugh disait « un peu d’ordre ! ») sur l’actuelle cuisine littéraire. Quel regard portez-vous sur celle-ci ? Et sur le monde de l’édition, que vous connaissez ?
J’ai peur, très peur de voir s’effondrer l’art du roman, un peu comme Yves Saint Laurent qui assista à la mort de la haute couture. N’est-ce pas intolérable de penser que des auteurs acceptent de voir « retoucher » leur livre quand on ne les « conseille » pas ? J’ai quitté un éditeur pour cela. Je ne voulais pas qu’on tripatouille ma prose, encore moins qu’on rabote mes idées, si peu correctes il est vrai. Pour moi, la littérature est un duel entre soi et soi. Un métier d’aristocrate ou de voyou. Un métier d’homme libre. Oui, un métier cependant, car pour bien écrire il faut beaucoup écrire, longuement. Je n’ai pas dit : beaucoup publier. Je suis horrifié par l’état des Lettres en France, par un certain renoncement des éditeurs devant les médias et les agents. Que l’avenir nous préserve des agents ! En Belgique tout est verrouillé. Quelques personnes se font des courbettes et voilà tout, pas ou très peu de polémique. On écrit que je suis élégant et discret dans la marge d’un journal et le même journal - tombé bien bas depuis quelque temps - encense un cuistre qui publie dix pages sur Zidane, à Paris, avec de l’argent belge probablement. Les éditeurs ? Ils se regardent en chiens de faïence. C’est très triste mais je ne vais pas en faire une maladie, même si mon éditeur devait renoncer à publier Le petit livre belge, une pochade un peu encombrante bien que légère en quantité.
Tous vos écrits, prose et poésie confondues, portent l’empreinte d’une profonde culture musicale. Votre épouse est pianiste, vous-même ne manquez pas le festival de Salzbourg. « De la musique avant toute chose » ?
Oui, la musique avant tout. D’ailleurs, pour moi, il y a grande littérature quand celle-ci donne à penser à de la musique. J’ai toujours dit que je désirais égaler Chopin, créer ces formes très contrôlées mais qui paraissent très libres. L’illusion de la confidence, parler au cœur, ce qui demande beaucoup d’intelligence et des moyens raffinés. Je suis un artiste, pas un intellectuel, et sans doute suis-je plus proche du musicien que de tout autre artiste. J’ai épousé une musicienne mais je suis aussi fils de musicien et même petit-fils de musicien. Mes plus chers amis sont des musiciens.
Votre œuvre romanesque, qui culmine dans Ainsi fut dissipé le charme nostalgique (Le Cri), ne fait-elle pas écho à l’incipit de Sur les falaises de marbre, ce roman fondateur d’Ernst Jünger magnifiquement traduit par Henri Thomas : « Vous connaissez tous cette intraitable mélancolie qui s’empare de nous au souvenir des temps heureux. Ils se sont enfuis sans retour, quelque chose de plus impitoyable que l’espace nous tient éloignés d’eux. » ?
Comme c’est bien dit : « plus impitoyable que l’espace… » ! J’ai la nostalgie du présent même, parfois. Hier, mon épouse essayait des robes du soir ; je lui ai conseillé celles qui m’évoquaient des moments dans le passé, des mots, Proust, et je sais qu’en les revêtant, en les accessoirisant de perles, de fourrures - avec des gants, je tiens beaucoup aux gants, - elle saura créer, au présent, de la nostalgie. Un jour - j’écrivais L’Orage - des spectateurs, dont nous étions croyions-nous, nous ont abordés à l’entracte. C’étaient des Juifs polonais qui avaient cru revoir en nous des princes varsoviens. Ils y croyaient pour de bon comme si nous étions venus de leur passé pour les enchanter. Je me souviens, c’était à un récital, le dernier, de Magaloff. Je ne sais pas d’où vient cette nostalgie dont j’étais déjà conscient enfant. Peut-être de mon grand-père, un bel homme romanesque et cultivé. Ernst Jünger ? Oui, c’est bien, très bien.
Parmi les leitmotivs de votre œuvre, ce couple ambigu (frère, sœur, amants) et princier…
C’est la question la plus indiscrète. Ce n’est d’ailleurs pas une question, plutôt un constat. Ce couple, est une clé et un idéal. C’est un miroir aussi, le miroir de mon couple, sa liberté et l’indestructible alliance de deux personnes qui se ressemblent, qu’on devine être ensemble même lorsqu’on les rencontre séparément. Un couple comme celui-là demeure toujours un mystère, alors même que certains s’offusquent de sa très - trop - grande liberté. Ce n’est pas un couple bourgeois, vraiment pas. Princier ? Oui. Il est tellement au-dessus de la morale courante, il se prête si mal au moule démocratique. C’est aussi un couple d’artistes mais sans folklore. Une véritable femme du monde et un poète gentleman qui ont décidé de traverser ensemble la vie, celle de quelques autres et la leur, comme un voyage. Après tout ce qu’on peut en dire par rapport à mon épouse et à moi, c’est aussi une métaphore de la beauté et du temps qui passe. Dans Ainsi fut dissipé le charme nostalgique, Cyril prend peur, il décide, après toutes ces années, de ne pas le revoir. À la fin de L’Orage, un jeune homme, moins compliqué, l’attend. C’est qu’il n’a à lui donner que son corps (accessoirement un bijou volé et un livre où manquent des pages) ; pour Cyril, il s’agit de son âme.
Il me semble aussi distinguer dans vos écrits un goût immodéré (et ceci n’est pas une critique) pour les velours, les soieries et les brocarts. Votre côté flamand ?
Je suis un couturier et un décorateur rentrés… J’ai fréquenté ces milieux aujourd’hui ravagés (un peu moins la décoration) par le commerce le plus plat. Villars (l’antiquaire) disait que j’avais un côté Christophe Decarpentrie. Ce n’était peut-être pas tout à fait, dans sa bouche, un compliment. Or Christophe, c’est le Flamand de Tournai (par son père, comme moi). Vous savez, je vis dans un appartement tout blanc, assez vide au premier regard, avec la mer pour cadre mais je collectionne des vêtements féminins avec un goût prononcé pour le somptueux, même de ville. Ah ! Le Givenchy du temps de sa gloire… J’ai dû être marchand d’étoffes dans une autre vie, un marchand vénéto-flamand en effet.
Vos projets ?
Trop. Deux livres au moins (je ne parle pas du Petit livre belge, je l’ai dit, très léger et néanmoins encombrant) mais je ne suis pas pressé. Je suis capable de travailler sur ces deux manuscrits pendant dix ans comme, à peu près, sur Ainsi fut dissipé le charme nostalgique. Je suis capable aussi de les donner sous une identité d’emprunt, l’un des deux en tout cas. Je n’ai pas de statut sinon celui de la discrétion (plus j’y pense, plus je crois que ce mot ne me convient pas). Savez-vous que j’ai, un jour, menacé Hubert Nyssen d’un duel à l’épée ? Il a répondu à cette proposition par un très plat : « N’en faisons pas tout un fromage. » Ces deux livres auront pour centre d’intérêt l’Inde comme un souvenir, une nostalgie. Mais mon principal projet est de faire survivre en moi l’éternel jeune homme, comme disait Lucie Spède dans la préface à mon premier et encore maladroit roman.*
La Course des chevaux libres. (Le Cri.)
Yves-William Delzenne a publié chez Le Cri, éditeur à Bruxelles :
La Course des chevaux libres, roman, 1983 /L’Orage, roman, 1991 /Poèmes, anthologie, 1993
Les Tours de Dresde, roman, 1994 / La Nostalgie batailleuse, nouvelles, 1995 /L’immortel bien-aimé, poème, 1998 /Œuvre complète, 2003
Dernier ouvrage paru : Ainsi fut dissipé le charme nostalgique, roman, 2006
En préparation chez le même éditeur : Le petit livre belge
Chez d’autres éditeurs : Un Amour de fin du monde, roman, Actes Sud, 1987 / Le Sourire d’Isabella, roman, Actes Sud, 1989
Les dés de pierre, Casterman, 1995
Entretien paru dans La Revue générale, avril 2006.
Écrit par Archaïon | Lien permanent | Tags : littérature, belgique | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |