09 septembre 2014
L’Ange gardien, de Jérôme Leroy
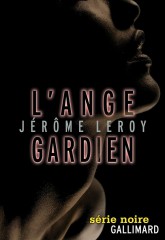
Joli montage que cet Ange gardien, où Jérôme Leroy récapitule des obsessions et des hantises qui n’ont guère changé depuis Monnaie bleue : il est vrai que la Vème République ne se porte pas mieux depuis les hideuses années 80, enlisée qu’elle est dans les égouts d’une mondialisation à marche forcée. Leroy n’a guère d’égal aujourd’hui pour décrire la faune de notre Bas Empire climatisé : journalistes à gages, flics stipendiés, éditeurs marrons, politiciens abrutis…
Les éditions originales recouvertes de papier cristal et les piquantes professeurs de lettres, les armes de poing et les vins non trafiqués, les anxiolytiques (stupéfiante, son érudition à propos de xanax & lexomil), le Rouen d’avant la catastrophe et les polices parallèles, tout un univers poétique ou glaçant revient sous la plume de notre révolté mélancolique.
Si dans Le Bloc, son précédent polar, il décrivait les coups tordus d’un gouvernement de droite qui pariait sur des émeutes ethniques pour se maintenir au pouvoir, aujourd’hui c’est à la gauche établie qu’il réserve quelques tirs tendus. Outre un climat proto-totalitaire, celui de notre décadence, on retrouve dans L’Ange gardien bien des personnages du Bloc, à commencer par Stanko, l’homme des basses œuvres du Bloc patriotique, le parti du tribun Dorgelles. L’Ange gardien passe pourtant un cran au-dessus du Bloc en raison de la plus grande densité de ses personnages, d’une critique sociale mieux intégrée au fil du récit et moins manichéenne, donc plus profonde, enfin d’un humour plus désespéré encore. Prenons le pivot de ce roman, Berthet, l’ange de la mort : sentimental samouraï d’un Occident décomposé, tueur méthodique (quoique parfois négligent : sa chair est faible) qui choisit des pseudonymes littéraires (Jacques Sternberg !) et collectionne les éditions originales de Toulet ou de Michaux. Cette (improbable) barbouze, qui a débuté sous Pompidou, a trempé dans bien des affaires, du meurtre de Pierre Goldmann à la noyade de tel activiste dextriste. Berthet appartient en fait à l’Unité, que d’aucuns appellent l’Etat profond, un service public occulte, invisible et omniprésent, spécialisé dans le nettoyage, y compris médiatique. Ses honorables correspondants se nichent partout, au CNRS comme dans les ministères et les grandes entreprises, et ses chefs, aux noms de cinéastes, nulle part. L’Unité ne fait pas de politique : elle l’influence en tirant le tapis d’un coup sec au bon moment, d’où quelques chutes regrettables. Au début de la Vème, l’Unité maintenait l’ordre national et républicain ; sous l’actuel président, elle ne fait plus que colmater les brèches, pour retarder le naufrage. Signe de nos temps de déréliction, l’Unité subit le même sort que l’école publique ou la poste : les contrats à durée indéterminée cèdent la place à des extras, incompétents et pressurés. La qualité s’en ressent ; Berthet en fait l’expérience dans la nuit lisboète. Il lui suffit de découper au bistouri l’oreille d’un collègue (une scène à la Dexter) pour apprendre que sa protégée, qu’il suit à son insu depuis vingt ans, la ravissante Kardiatou Diop, jeune Secrétaire d’Etat issue des quartiers de Roubaix, va faire l’objet d’une « opé » à la demande de son parti, celui de l’Exemple et du Changement. Non sans brio, Leroy inverse l’intrigue du Bloc : au complot interne à la droite nationaliste - vertueuse liquidation des affreux à la veille du grand soir - il substitue une double conspiration, autrement plus subtile : le sacrifice d’une martyre de la diversité et, cerise sur le gâteau, de la Walkyrie, la fille du tribun Dorgelles, et hop, « Liberté, égalité, fraternité ». Heureusement, il y a encore dans cette France crépusculaire des tueurs dont l’honneur s’appelle fidélité…
L’Ange gardien constitue une parfaite illustration de l’hétérotélie, quand de tortueuses manœuvres aboutissent au résultat inverse de celui recherché. Autre personnage attachant de ce roman où alternent douceur et noirceur, poésie et brutalité (des scènes de sexe trop appuyées, Série noire oblige), celui, récurrent dans l’œuvre du camarade Jérôme, de l’écrivain qui ne va pas trop bien, le lettré dépressif et drogué aux « benzos », l’amant précaire. Joubert est le nom de ce quinquagénaire désabusé, qui pige à droite toute malgré ses idéaux rosâtres et, au lieu de bâtir son œuvre, commet, pour boire, des romans pornographiques. La rencontre entre la barbouze et l’écrivain, un autre leitmotiv chez Leroy, est ici particulièrement réussie, car non dénuée d’un humour grinçant. Concluons. Notre « chardonnien sensuel et contrarié » n’a pas failli à sa mission : d’une belle ampleur, le montage tient la route, baigné d’une réelle poésie, celle des matins grecs et des bistrots parisiens, grâce au talent d’un de nos beaux écrivains*, qui sait, lui, « qu’il n’y a de vérité et de sens que dans la métaphysique ».
Christopher Gérard
Jérôme Leroy, L’Ange gardien, Série noire, 330 p., 18.90€
*L’honnêteté commande de déplorer, page 142, un « rentrer sur Paris » qui devrait me valoir une ou deux fillettes de Chinon sans soufre.
On dit du mal de Jérôme Leroy dans mon journal de lectures.

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, polar, série noire, jérôme leroy | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17 juin 2014
Un maître du Witz : Bernard du Boucheron

Enarque, ancien haut responsable dans l’industrie aéronautique, Bernard du Boucheron a décroché à 76 ans le Grand Prix du roman de l’Académie française avec Court Serpent, son premier roman - style au couteau et cruel raffinement. Six romans tout aussi pessimistes, publiés chez Gallimard, ont confirmé qu’il s’agissait d’un écrivain de haut parage et à rebours des modes. Voilà que, pour son huitième roman, il change d’éditeurtant il semble que Le Cauchemar de Winston ait effarouché la grande maison. Il est vrai que, dans le genre - difficile - de l’utopie mal-pensante, Boucheron atteint un sommet.
Mai 1941, Hitler, alias le Conducteur, échappant aux manœuvres de son médecin (zigouillé par la police secrète), retrouve un semblant de lucidité et annule l’opération Barbarossa. C’est le Grand Tournant, quand Ribbentrop et Molotov se partagent le continent (hilarant dialogue entre les deux prédateurs) dans le cadre d’une paix « perpétuelle ». Londres feint de reconnaître la prédominance allemande sur l’Europe en attendant son heure. Quant aux foules grisâtres de France, prises d’une frénésie de dénonciations, elles subissent bon gré mal gré la férule du Maréchal dans un fumet d’ail et de pieds mal lavés, faute de savon : « ce peuple indomptable qui a toujours accepté la servitude si même il ne recherchait pas, ce peuple artiste qui chante faux et a voué un culte à la laideur, cette nation généreuse que ne vit que pour son bas de laine, ces universalistes qui ignorent tout du monde, ces amateurs de grandeur pour qui le mot « petit » est un suprême éloge ». Au nom du Parti, Aragon chante le génie de Staline et d’Hitler, pendant que ses camarades passent en masse au service de la Grande Allemagne, « tant est grand le prestige de la tyrannie dans la patrie de la liberté où l’aplatissement va de pair avec l’insurrection ». Vichy s’installe à Versailles et Laval se suicide ( ?) pour céder la place à l’Ambigu, un avocat pourri d’ambition, ancien élève des Maristes - le genre à se faire limer les canines pour offrir un sourire plus enjôleur. Boucheron se surpasse dans la description de cet ambitieux qui « collabore sans ardeur et résiste sans conflits ». Avec Speer, l’Ambigu, que ses affidés surnomment Tonton, va négocier la Paix de Pantin, qui fait de la France, où renaissent des cultes naturistes, un modèle de décroissance. En 1951, rose à la main, l’Ambigu accueille la dépouille du Maréchal au Panthéon. Le même reçoit le Conducteur à Paris, sur la tombe du Soldat inconnu. Débarrassé d’une SS décidément encombrante, le Conducteur, dont Boucheron imagine une interview délirante avec un journaliste étrusque (en fait : albanais), prépare son triomphe dans une débauche de grands travaux tandis que la perfide Albion concocte sa terrible revanche. Du grand œuvre, qui laisse pantois.
Christopher Gérard
Bernard du Boucheron, Le Cauchemar de Winston, Editions du Rocher, 190 pages, 17€
PS: B. du Boucheron est l'un des 122 auteurs présentés dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, uchronie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11 juin 2014
Ghislain de Diesbach, un gentilhomme de notre temps
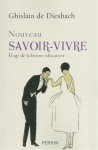
De nos jours, la politesse passe pour ringarde, pour ne pas dire suspecte, car, comme le souligne Ghislain de Diesbach dans cet essai bienvenu, « faite d’interdictions destinées à discipliner chez l’homme sa sauvagerie primitive ». Que cèdent les barrières et les barbares déferlent : Diesbach cite le voussoiement, tout en distances et en délicatesse, interdit par les sans-culottes au profit du brutal tutoiement « citoyen », qui mène droit à la guillotine. Et comme au recul de la civilisation s’ajoute un infantilisme triomphant (exemple : trois couples de trentenaires flasques avec moutards invertébrés au restaurant), comment ne pas le suivre pour réhabiliter le savoir-vivre, justement qualifié de « chef-d’œuvre en péril » ?
Avec autant d’esprit que d’humour, Diesbach précise que ce qui caractérise l’homme du monde, c’est que lui, au moins, sait qu’il est mal élevé… Hautement instructif, tout le livre est truffé d’anecdotes souvent hilarantes (comme gaffe célèbre, il cite celle de ce sommelier qui, servant du champagne au Grand-duc Wladimir, lui chuchote à l’oreille : « Brut impérial 1893 »), puisées chez quelques grands noms du monde comme Pringué et Boni de Castellane ou tout simplement dans la vaste mémoire de l’auteur.
On y apprend une foule de choses inutiles, ô combien importantes : toujours offrir un nombre impair de fleurs, ne jamais balbutier le piteux « enchanté » lorsqu’on est présenté, manger le poisson avec deux fourchettes, saluer une altesse (vraie ou fausse), ne pas galvauder le baisemain, voussoyer (« une espèce d’élégance qui préserve de la vulgarité, une certaine douceur aussi, une bonne grâce teintée de pudeur »), et, en cas de naufrage, « se retenir de taper à coups d’avirons sur les malheureux qui s’accrochent à la chaloupe ». Même la poignée de mains inspire une sorte de retenue à Diesbach, qui lui préfère « la courbette militaire et un peu mécanique des Allemands, la froideur anglo-saxonne », car plus hygiéniques… depuis que plus personne ne porte de gants. Il aurait pu citer Barbey : « beaucoup d’amis, beaucoup de gants, de peur de la gale ». Ma joie à la lecture de ses lignes assassines sur le téléphone portatif, celui-là même que triturent tant de ploucs d’un pouce graisseux, même à table : « ne devrait être délivré que sur ordonnance » !
Rédigé dans un français ferme et clair, ce Nouveau savoir-vivre charme par son humour antimoderne non dénué d’un zeste de cynisme, celui des civilisations accomplies… même si, in fine, le diplodocus réactionnaire baisse le masque : le comte de Diesbach apparaît avant tout comme un esthète qui, par élégance morale, sait qu’il lui revient, comme à tout homme du monde qui se respecte, de faire oublier leur défaite aux vaincus de l’existence.
Christopher Gérard
Ghislain de Diesbach, Le Nouveau savoir-vivre. Eloge de la bonne éducation, Perrin, 270 p., 21€
*
Rencontre avec Ghislain de Diesbach
Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,
aux éditions L’Age d’Homme
http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0
Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Pourrait-on vous qualifier de « gentilhomme de notre temps »?
Qui suis-je ? Je me suis souvent posé la question sans jamais pouvoir la résoudre, ayant découvert en moi trop d’éléments contradictoires pour me reconnaître une personnalité coulée d’une seule pièce, comme ces statues qui ornent les tombeaux ou les places. J’aime à dire que je suis né sous le Second Empire et j’en ai toujours aimé le régime, ainsi que les souverains, pensant comme La Varende que Napoléon III a été le dernier roi de France. Ayant dans mes veines le sang des colonels-propriétaires du Régiment de Diesbach au service de France, et aussi celui du fondateur de la Compagnie des Indes d’Ostende, ainsi que de l’inventeur, pendant le blocus continental, du procédé pour blanchir le sucre de betterave et le commercialiser, je me sens tour à tour militaire ou manufacturier, en regrettant de n’avoir pas été armateur ou planteur. Je ne dirais donc pas que je ne me sens pas gentilhomme au sens que l’on donnait sous l’Ancien Régime à ce mot, détestant d’ailleurs le préfixe gentil, qui dit faible, et préférant le terme de « patricien » ainsi qu’on l’entendait jadis à Rome et même à Londres ou Hambourg au XVIII° siècle, ce qui permet de concilier le commerce des denrées commerciales avec celui des beaux esprits.
Quelles ont été les grandes lectures, celles qui vous ont marqué pour la vie?
Dans mon enfance, Jules Verne, chantre de l’apogée de la civilisation européenne au XIX° siècle et la comtesse de Ségur, parfait manuel de bonne éducation, puis dès mon adolescence, Maupassant, Balzac, mais surtout les auteurs anglais des XVIII° siècle et XIX° siècle, avant de passer un peu plus tard à Virginia Woolf et aux écrivains de ce que l’on appelait alors le groupe de Bloomsbury.
Et les grandes rencontres ?
Le goût des livres m’a donné celui de leurs auteurs et ce fut ainsi que dans ma prime jeunesse je suis allé voir Ferdinand Bac, le dernier témoin du Second Empire, La Varende, puis Jean Giono, me trouvant par hasard près de chez lui, et enfin Marguerite Yourcenar dont les Mémoires d’Hadrien m’avaient enthousiasmé, me faisant aimer soudain tout ce qui m’avait tant ennuyé jadis pendant mes études. Une fois à Paris, j’ai connu beaucoup d’écrivains, dont Julien Green, le plus remarquable, mais la liste, là, serait trop longue…
Outre des ouvrages d’histoire (par exemple une Histoire de l’Emigration, que l’on réédite ces jours-ci), vous avez publié, chez Perrin, des biographies d’écrivains très remarquées : Madame de Staël, Proust, Chateaubriand, Le tour de Jules Verne en quatre-vingt livres. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé ces choix et ce que chacun de ces auteurs vous a apporté ?
Mes biographies d’écrivains, comme Madame de Staël, Proust, Chateaubriand, sont en général le fruit du hasard, voire d’une opportunité, mais il existe malgré tout un fil conducteur. Ayant par goût personnel voulu écrire une Histoire de l’Emigration, j’ai été frappé en lisant Souvenirs et Mémoires sur la fin du XVIII° siècle de l’âpreté des jugement sur Necker, véritablement jeté en pâture aux chiens après avoir été considéré pendant des années comme le sauveur de la France. Ainsi l’idée m’est-elle venue de le réhabiliter, puis, en travaillant à sa biographie, j’ai trouvé que sa fille Germaine de Staël était un personnage infiniment plus haut en couleur et intéressant. Je suis donc passé du père à la fille, et en préparant mon livre sur celle-ci j’ai amassé une documentation qui pouvait me servir également sur Chateaubriand, qui fut comme elle un grand opposant à Napoléon.
Dans ces deux écrivains, surtout Madame de Staël, j’ai admiré le goût des formules, les réflexions politiques, et j’en notais au passage avec l’idée que cela pouvait servir pour un autre livre, un ouvrage de morale politique par exemple. En revanche, j’ai fait d’autres livres pour le seul plaisir de témoigner ma reconnaissance à des auteurs qui avaient enchanté ma jeunesse, comme Jules Verne, dont j’ai analysé l’œuvre dans Le Tour de Jules verne en quatre-vingts livres, la comtesse de Ségur, dont l’œuvre, une fois décryptée, la montre, ainsi que Jules Verne, assez différente de l’image traditionnelle et enfin Ferdinand Bac, le premier à encourager ma vocation de mémorialiste et d’historien.
Vous publiez à Versailles un Petit dictionnaire des idées mal reçues, dans l’esprit de Rivarol, mais aussi de Proudhon, que vous citez: « j’ai pris la plume pour la servir – la liberté – et je n’aurai servi qu’à hâter la servitude générale et la confusion ». Quelle en est la genèse ?
Le Petit dictionnaire des idées mal reçues a été composé d’une toute autre façon et au hasard des lectures, des rencontres, des observations faites pendant ma vie professionnelle et parfois de propos entendus dans un restaurant ou pendant une soirée mondaine. En vérité, je dirais qu’il s’est fait tout seul, sans plan préconçu, ce qui explique l’ordre alphabétique. Ayant toujours détesté la bêtise, j’avais été consterné en lisant le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, brave homme et petit esprit, ainsi que le montra d’ailleurs dans ses Souvenirs son ami Maxime du Camp, un auteur méconnu, lui.
Ce déclin que vous fustigez avec panache, pensez-vous que certains livres l’aient annoncé, voire précipité ? A contrario, certains titres, du passé comme du présent, vous semblent-ils de parfaits antidotes ?
Le déclin que je stigmatise a, je le crains, toujours existé, depuis Louis XIV, je pense, et la seule chose qui a changé c’est l’accélération de l’Histoire. Avec le progrès technique, et la diffusion de plus en plus rapide, « en temps réel », des idées, surtout les mauvaises, l’homme d’aujourd’hui voit un pays se défaire ou se dissoudre alors qu’au XIX° siècle seuls des esprits pénétrants, comme Tocqueville ou Custine, voire Edmond de Goncourt, apercevaient les fissures et prophétisaient la ruine un jour de l’édifice. En ce qui concerne la France, il y eut dès l’aube du XX° siècle des écrivains comme Barrès qui sonnèrent le glas de la civilisation occidentale. Entre les deux guerres, dans les années 30, bien des écrivains publièrent des livres sur ce que l’un d’eux, un Anglais, appelait « Le suicide de la Vieille Europe ». Aucun de ces livres n’a eu malheureusement d’influence sur le cours des événements ; ils sont lus la plupart du temps par des esprits déjà convaincus, dont ils justifient les craintes ou les théories, mais demeurent sans effet sur « les masses » auxquelles reste en fin de compte le dernier mot, puisque ce sont elles qui votent.
Vous fûtes l’ami et le biographe de Philippe Jullian, « un esthète aux Enfers ». Vous avez aussi évoqué la princesse Bibesco. Ce monde des salons littéraires a-t-il disparu à jamais ? Si oui, quand et pourquoi ?
Le monde ancien, d’avant la Grande Guerre, a survécu d’une certaine manière jusqu’à mai 1968, car il y avait encore à Paris, dans ce qu’il est convenu d’appeler « le monde », des hôtesses tenant salon, des femmes aimant à réunir autour d’elles, sinon les meilleurs esprits, parfois récalcitrants, du moins des gens à la mode, ceux dont on parlait. Il y avait le salon académique de la duchesse de la Rochefoucauld, de sa belle-sœur, la comtesse de Fels, le salon musical de Mme Tézenas et d’autres encore où l’on voyait, devenus vieux, voire cacochymes, des jeunes gens qui avaient hanté jadis les salons décrits, sinon fréquentés, par Marcel Proust. Marthe Bibesco était une survivante de cette époque et l’avait bien connue ; elle l’avait aussi jugée à sa juste valeur et en a laissé une peinture exacte dans son roman le moins connu : Egalité. Philippe Jullian, lui aussi, a connu les vestiges de cette société, devenue d’ailleurs une sorte de Café-Society suivant le titre d’un de ses romans, et l’a cruellement caricaturée dans ses albums, comme dans l’illustration de certains de ses livres.
On se moquait alors, dans la fin des années 60, de ces dames assoiffées de gloire, aimant recevoir pour le plaisir d’être citées dans les chroniques mondaines, confondant leurs invités, prenant un peintre pour un écrivain, assurant à un cinéaste en vogue qu’elles se délectaient de son dernier roman, mais elles avaient du bon, car leurs salons étaient des endroits agréables où se retrouver, faire de nouvelles connaissances et faire aussi de l’esprit.
Les derniers salons ont fermé, car personne aujourd’hui n’a suffisamment de fortune pour avoir un hôtel particulier et y tenir table ouverte, ainsi que le faisait Marie-Laure de Noailles, ou un hôtel tout court, comme le Meurice où recevait chaque semaine Florence Gould. L’impôt sur le revenu, puis l’impôt sur la fortune et l’impôt sur l’impôt que représente la Contribution sociale généralisée, aboutiront progressivement à la disparition des patrimoines. Ainsi que je l’écris dans mon Petit dictionnaire des idées mal reçues, il n’y a pas en France égalité des citoyens devant l’impôt, mais égalisation des fortunes par l’impôt. Les cafés littéraires n’ont plus leur clientèle d’autrefois. La vague démocratique a tout englouti.
Vos projets ?
Dans un monde aussi démocratisé, où chaque citoyen est de plus en plus « conditionné », numéroté, en attendant d’être soviétisé par le biais trompeur du capitalisme international, comment faire des projets, sinon celui de « résister » ?
Paris, le 9 novembre 2007
Propos recueillis par Christopher Gérard.
La Presse littéraire XII, déc. 2007 – janvier 2008.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, savoir-vivre, aristocratie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05 juin 2014
Roland Laudenbach ou l’insolence

« Un esprit fort qui n’autorise pas les habiles à calomnier l’honneur et les barbares à offenser la civilisation »
Pol Vandromme
Mea maxima culpa, je confesse que, au début des merveilleuses années 80 (Mitterand, Reagan & Jean-Paul II), j’étais un étudiant dissipé, qui passait beaucoup plus de temps chez les bouquinistes que dans les amphithéâtres de mon Alma Mater. Il est vrai que, au cours de « grands courants de la philosophie », nous devions subir l’indigeste charabia d’un ancien secrétaire de Sartre, qui eut l’unique mérite - involontaire - de me vacciner à tout jamais contre l’imposture aux mille faces.
Je préférais flâner dans diverses librairies, dont Bruxelles était riche alors et où, du premier coup d’œil, je repérais la casaque blanche et vermillon ornée du mythique LTR dessiné par le peintre Salvat. De mes promenades je ramenais dans ma soupente des trésors intitulés Le Songe de l’Empereur, Minutes d’un libertin, Au large du siècle, sans oublier L’Histoire égoïste - les mémoires de Jacques Laurent, auteur d’un pamphlet, Paul et Jean-Paul, que je ne lus que bien plus tard. Je faisais alors connaissance avec Pol Vandromme et Michel Déon, Gabriel Matzneff et Willy de Spens. Ma joie quand je découvris, sur une étagère haut-perchée, un exemplaire intact du Drieu parmi nous de Jean Mabire.
Gavé de scolastique sartrienne à l’Université, je prenais en quelque sorte le maquis – un maquis blanc dont le commandant en chef, lointain, quasi mythique, se nommait Roland Laudenbach, alias Michel Braspart. Dans le joli Cahier que LTR publia en 1974 pour ses trente ans, j’appris ce qu’il fallait savoir de cet éditeur inflexible, l’ami de Cocteau et de Genet, l’homme qui brava les interdits de la police de la pensée non seulement en éditant des proscrits (dont certain poète madrilène, un temps collaborateur de Valeurs actuelles) et des pestiférés comme Morand et Giono, victimes de la vindicte des nouveaux puritains - les amis de Sartre & consorts. J’aimais que Vandromme exaltât chez Laudenbach ce sens de l’amitié : « une amitié sur un mode divinatoire et quasi initiatique » et que l’éditeur en personne, qui fut aussi romancier et scénariste, évoquât « l’amitié qui excuse tout, qui s’exprime soit par fou rire, soit par silence et autorise une connivence aux codes secrets ».
Une « connivence aux codes secrets » : quel plus beau programme pour un jeune rebelle de vingt ans et des poussières, en bisbille contre son époque et qui se cherchait des aînés qui ne fussent pas des pions ?
Cette connivence, je l’ai connue, non avec Laudenbach, disparu en 1991 et que je ne rencontrai jamais (même si, dès la fin de mon service militaire, j’avais écrit 40 rue du Bac pour y solliciter un emploi), mais avec Dimitri, le fondateur de L’Age d’Homme, dans divers lieux conspiratifs tels que la cave de la rue Férou, le Café de la Mairie ou son stand de la Foire du Livre.
J’aimais, et continue d’aimer à la folie ce côté hidalgo, intraitable sur les valeurs, sauvage même, et, je le confesse, ce parfum de conspiration. Cette générosité, dont Gabriel Matzneff témoigne dans L’Archange aux pieds fourchus, et je ne sais plus qui, qui disait les larmes de Laudenbach à l’annonce du Prix Goncourt décerné à Jacques Laurent pour Les Bêtises… publiées chez Grasset. De même, j’aimais que Laudenbach témoignât pour son confrère Lindon, des éditions de Minuit (celui-ci lui rendit la pareille lors d’un procès pour offenses au chef de l’état).
Et quel catalogue ! Gripari et Mourlet, Volkoff et Sérant, Héduy et Schoendorffer, Anouilh et Dominique de Roux… Un feu d’artifice. Les libertins du siècle, dont nous sommes aujourd’hui les orphelins.
Christopher Gérard
Publié dans le numéro 14 de Livr'Arbitres, revue littéraire non conformiste http://livr-arbitres.com/
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04 juin 2014
Avec Guy Féquant

Vingt ans ! Cela fait vingt ans que les livres de Guy Féquant occupent une place de choix dans ma bibliothèque. Lui que je croyais parti pour toujours à la Réunion est revenu dans la maison ancestrale et s’est remis à écrire !
Petit-fils de berger, Guy Féquant a été professeur d’histoire et de géographie. Spécialiste de Tacite, il s’est nourri des Latins, de Lucrèce aux chroniqueurs carolingiens, des Romantiques allemands, jusqu’à notre cher Jünger. Lecteur de Gracq et de Déon, de Caillois et de Borges, il affectionne les écrivains voyageurs : White, Leigh Fermor, Bouvier… Aujourd’hui, il s’adonne aux joies de la retraite dans un petit village de sa Champagne natale, près de Rethel – où, en 1432, Philippe le Bon mit en place l’Ordre de la Toison d’Or. Cette province, il lui a rendu hommage dans son premier livre, Le Ciel des bergers (1986), étonnant dialogue archaïque entre un homme et le sol qui l’a vu naître, et aussi tribut rendu à ses aïeux bergers et laboureurs des terres crayeuses, comme ce grand-père qui lui dit un jour : « D’abord, ne jamais se complaire dans les petits maux que le destin nous inflige ; ensuite ouvrir grand son esprit à la magnificence du monde ; enfin ne consentir à rentrer en soi que pour prier ».
Après un essai consacré à Saint-John Perse, Guy Féquant a publié deux beaux romans malheureusement épuisés et qu’un éditeur ferait bien de rééditer.
Odinsey, qui s’ouvre par la devise figurant sur la pierre tombale de Martin Heidegger, « La marche à l’étoile, rien que cela », est la chronique imaginaire de l’île d’Odin, qui ressemble étrangement à l’Ultima Thulé de Pythéas. Lecteur d’Horace et d’Hérodote, botaniste et ornithologue (comme Féquant), Stéphane Arnasson y incarne un rebelle jüngerien qui assiste, impuissant, à la fin de la société aristocratique et païenne - c’est tout un, comme toujours -, celle des sagas, des prophétesses et des princes, emportée par la triple montée du christianisme, de la monarchie centralisée et du règne des marchands.
Le Jaseur boréal tire son nom d’un oiseau de mauvais augure, que la vieille langue thioise appelle pestvogel – l’oiseau qui annonce la peste, la guerre et la famine. Le lecteur y suit pas à pas, sans lâcher son grimoire une seconde, le jeune Manfred, élève d’une école monastique et compagnon d’Erik le Rouge en Amérique. Surnommé Julien l’Apostat par un frère ambigu qui préférerait avoir affaire à un athée, Manfred flirte avec un paganisme encore bien vivant (nous sommes aux alentours de l’an mil) tout en étant fasciné – qui ne le serait pas ? – par la figure du « moine grammairien voué au culte des livres et à la méditation au cœur de la forêt, ce désert d’Occident ».
J’avais lu ces livres il y a vingt ans, avec quel plaisir. Voilà que le facteur me dépose Plume, un roman, ou est-ce un récit ?, qui m’a ému et que j’ai abondamment crayonné. Plume est une sorte d’éloge des chats, comme le précise la dédicace manuscrite : « le silence des chats est celui des grands initiateurs ». Un couple de lettrés réfugié dans un village bourguignon, lui professeur de japonais et qualifié par sa femme, une traductrice, de mutashi otoko (« homme de jadis ») – un contemplatif fasciné par le grand mystère, « celui de l’instant volé à l’avalanche du temps ». Un rebelle, encore, rétif au monde moderne, vu comme « un complot contre l’âme, contre la part de nous-mêmes qui veut sans cesse relier la terre aux étoiles.»
Un jour, une chatte, légère et aérienne, arrive on ne sait d’où, sans doute abandonnée par des citadins, et se fait adopter d’emblée. Angora à la démarche décidée, tachée de noir et de blanc, Plume s’impose avec sa logique obéissant à des flux mystérieux. Entre l’homme et le félin se nouent des liens d’une étonnante profondeur, d’autant plus intenses que, lors d’un séjour à la Réunion, un autre chat, Timour, avait déjà occupé une place importante dans sa vie. Tout le récit tourne autour de la mort des deux chats, et de la métamorphose qu’elle implique chez l’humain qui leur survit. Moraliste influencé par le taoïsme comme par le vieux paganisme gaulois, Guy Féquant chante les chats, leur noblesse « sans passé ni attente », leur résistance aux mises au pas comme à tout dressage. L’époque, dit-il, n’est pas aux chats, trop indépendants, trop fins, mais plutôt aux chiens de garde et de camps. Le style, classique et d’une belle sobriété, rehausse ces réflexions tour à tour poétiques et désabusées que je suis sûr de relire encore.
Christopher Gérard
Guy Féquant, Plume, Editions Noires Terres, 222 p. 15€
Odinsey et Le Jaseur boréal avaient été publiés à la Manufacture.
Lire aussi mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, chats | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







