11 juin 2014
Ghislain de Diesbach, un gentilhomme de notre temps
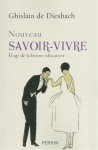
De nos jours, la politesse passe pour ringarde, pour ne pas dire suspecte, car, comme le souligne Ghislain de Diesbach dans cet essai bienvenu, « faite d’interdictions destinées à discipliner chez l’homme sa sauvagerie primitive ». Que cèdent les barrières et les barbares déferlent : Diesbach cite le voussoiement, tout en distances et en délicatesse, interdit par les sans-culottes au profit du brutal tutoiement « citoyen », qui mène droit à la guillotine. Et comme au recul de la civilisation s’ajoute un infantilisme triomphant (exemple : trois couples de trentenaires flasques avec moutards invertébrés au restaurant), comment ne pas le suivre pour réhabiliter le savoir-vivre, justement qualifié de « chef-d’œuvre en péril » ?
Avec autant d’esprit que d’humour, Diesbach précise que ce qui caractérise l’homme du monde, c’est que lui, au moins, sait qu’il est mal élevé… Hautement instructif, tout le livre est truffé d’anecdotes souvent hilarantes (comme gaffe célèbre, il cite celle de ce sommelier qui, servant du champagne au Grand-duc Wladimir, lui chuchote à l’oreille : « Brut impérial 1893 »), puisées chez quelques grands noms du monde comme Pringué et Boni de Castellane ou tout simplement dans la vaste mémoire de l’auteur.
On y apprend une foule de choses inutiles, ô combien importantes : toujours offrir un nombre impair de fleurs, ne jamais balbutier le piteux « enchanté » lorsqu’on est présenté, manger le poisson avec deux fourchettes, saluer une altesse (vraie ou fausse), ne pas galvauder le baisemain, voussoyer (« une espèce d’élégance qui préserve de la vulgarité, une certaine douceur aussi, une bonne grâce teintée de pudeur »), et, en cas de naufrage, « se retenir de taper à coups d’avirons sur les malheureux qui s’accrochent à la chaloupe ». Même la poignée de mains inspire une sorte de retenue à Diesbach, qui lui préfère « la courbette militaire et un peu mécanique des Allemands, la froideur anglo-saxonne », car plus hygiéniques… depuis que plus personne ne porte de gants. Il aurait pu citer Barbey : « beaucoup d’amis, beaucoup de gants, de peur de la gale ». Ma joie à la lecture de ses lignes assassines sur le téléphone portatif, celui-là même que triturent tant de ploucs d’un pouce graisseux, même à table : « ne devrait être délivré que sur ordonnance » !
Rédigé dans un français ferme et clair, ce Nouveau savoir-vivre charme par son humour antimoderne non dénué d’un zeste de cynisme, celui des civilisations accomplies… même si, in fine, le diplodocus réactionnaire baisse le masque : le comte de Diesbach apparaît avant tout comme un esthète qui, par élégance morale, sait qu’il lui revient, comme à tout homme du monde qui se respecte, de faire oublier leur défaite aux vaincus de l’existence.
Christopher Gérard
Ghislain de Diesbach, Le Nouveau savoir-vivre. Eloge de la bonne éducation, Perrin, 270 p., 21€
*
Rencontre avec Ghislain de Diesbach
Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,
aux éditions L’Age d’Homme
http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0
Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Pourrait-on vous qualifier de « gentilhomme de notre temps »?
Qui suis-je ? Je me suis souvent posé la question sans jamais pouvoir la résoudre, ayant découvert en moi trop d’éléments contradictoires pour me reconnaître une personnalité coulée d’une seule pièce, comme ces statues qui ornent les tombeaux ou les places. J’aime à dire que je suis né sous le Second Empire et j’en ai toujours aimé le régime, ainsi que les souverains, pensant comme La Varende que Napoléon III a été le dernier roi de France. Ayant dans mes veines le sang des colonels-propriétaires du Régiment de Diesbach au service de France, et aussi celui du fondateur de la Compagnie des Indes d’Ostende, ainsi que de l’inventeur, pendant le blocus continental, du procédé pour blanchir le sucre de betterave et le commercialiser, je me sens tour à tour militaire ou manufacturier, en regrettant de n’avoir pas été armateur ou planteur. Je ne dirais donc pas que je ne me sens pas gentilhomme au sens que l’on donnait sous l’Ancien Régime à ce mot, détestant d’ailleurs le préfixe gentil, qui dit faible, et préférant le terme de « patricien » ainsi qu’on l’entendait jadis à Rome et même à Londres ou Hambourg au XVIII° siècle, ce qui permet de concilier le commerce des denrées commerciales avec celui des beaux esprits.
Quelles ont été les grandes lectures, celles qui vous ont marqué pour la vie?
Dans mon enfance, Jules Verne, chantre de l’apogée de la civilisation européenne au XIX° siècle et la comtesse de Ségur, parfait manuel de bonne éducation, puis dès mon adolescence, Maupassant, Balzac, mais surtout les auteurs anglais des XVIII° siècle et XIX° siècle, avant de passer un peu plus tard à Virginia Woolf et aux écrivains de ce que l’on appelait alors le groupe de Bloomsbury.
Et les grandes rencontres ?
Le goût des livres m’a donné celui de leurs auteurs et ce fut ainsi que dans ma prime jeunesse je suis allé voir Ferdinand Bac, le dernier témoin du Second Empire, La Varende, puis Jean Giono, me trouvant par hasard près de chez lui, et enfin Marguerite Yourcenar dont les Mémoires d’Hadrien m’avaient enthousiasmé, me faisant aimer soudain tout ce qui m’avait tant ennuyé jadis pendant mes études. Une fois à Paris, j’ai connu beaucoup d’écrivains, dont Julien Green, le plus remarquable, mais la liste, là, serait trop longue…
Outre des ouvrages d’histoire (par exemple une Histoire de l’Emigration, que l’on réédite ces jours-ci), vous avez publié, chez Perrin, des biographies d’écrivains très remarquées : Madame de Staël, Proust, Chateaubriand, Le tour de Jules Verne en quatre-vingt livres. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé ces choix et ce que chacun de ces auteurs vous a apporté ?
Mes biographies d’écrivains, comme Madame de Staël, Proust, Chateaubriand, sont en général le fruit du hasard, voire d’une opportunité, mais il existe malgré tout un fil conducteur. Ayant par goût personnel voulu écrire une Histoire de l’Emigration, j’ai été frappé en lisant Souvenirs et Mémoires sur la fin du XVIII° siècle de l’âpreté des jugement sur Necker, véritablement jeté en pâture aux chiens après avoir été considéré pendant des années comme le sauveur de la France. Ainsi l’idée m’est-elle venue de le réhabiliter, puis, en travaillant à sa biographie, j’ai trouvé que sa fille Germaine de Staël était un personnage infiniment plus haut en couleur et intéressant. Je suis donc passé du père à la fille, et en préparant mon livre sur celle-ci j’ai amassé une documentation qui pouvait me servir également sur Chateaubriand, qui fut comme elle un grand opposant à Napoléon.
Dans ces deux écrivains, surtout Madame de Staël, j’ai admiré le goût des formules, les réflexions politiques, et j’en notais au passage avec l’idée que cela pouvait servir pour un autre livre, un ouvrage de morale politique par exemple. En revanche, j’ai fait d’autres livres pour le seul plaisir de témoigner ma reconnaissance à des auteurs qui avaient enchanté ma jeunesse, comme Jules Verne, dont j’ai analysé l’œuvre dans Le Tour de Jules verne en quatre-vingts livres, la comtesse de Ségur, dont l’œuvre, une fois décryptée, la montre, ainsi que Jules Verne, assez différente de l’image traditionnelle et enfin Ferdinand Bac, le premier à encourager ma vocation de mémorialiste et d’historien.
Vous publiez à Versailles un Petit dictionnaire des idées mal reçues, dans l’esprit de Rivarol, mais aussi de Proudhon, que vous citez: « j’ai pris la plume pour la servir – la liberté – et je n’aurai servi qu’à hâter la servitude générale et la confusion ». Quelle en est la genèse ?
Le Petit dictionnaire des idées mal reçues a été composé d’une toute autre façon et au hasard des lectures, des rencontres, des observations faites pendant ma vie professionnelle et parfois de propos entendus dans un restaurant ou pendant une soirée mondaine. En vérité, je dirais qu’il s’est fait tout seul, sans plan préconçu, ce qui explique l’ordre alphabétique. Ayant toujours détesté la bêtise, j’avais été consterné en lisant le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, brave homme et petit esprit, ainsi que le montra d’ailleurs dans ses Souvenirs son ami Maxime du Camp, un auteur méconnu, lui.
Ce déclin que vous fustigez avec panache, pensez-vous que certains livres l’aient annoncé, voire précipité ? A contrario, certains titres, du passé comme du présent, vous semblent-ils de parfaits antidotes ?
Le déclin que je stigmatise a, je le crains, toujours existé, depuis Louis XIV, je pense, et la seule chose qui a changé c’est l’accélération de l’Histoire. Avec le progrès technique, et la diffusion de plus en plus rapide, « en temps réel », des idées, surtout les mauvaises, l’homme d’aujourd’hui voit un pays se défaire ou se dissoudre alors qu’au XIX° siècle seuls des esprits pénétrants, comme Tocqueville ou Custine, voire Edmond de Goncourt, apercevaient les fissures et prophétisaient la ruine un jour de l’édifice. En ce qui concerne la France, il y eut dès l’aube du XX° siècle des écrivains comme Barrès qui sonnèrent le glas de la civilisation occidentale. Entre les deux guerres, dans les années 30, bien des écrivains publièrent des livres sur ce que l’un d’eux, un Anglais, appelait « Le suicide de la Vieille Europe ». Aucun de ces livres n’a eu malheureusement d’influence sur le cours des événements ; ils sont lus la plupart du temps par des esprits déjà convaincus, dont ils justifient les craintes ou les théories, mais demeurent sans effet sur « les masses » auxquelles reste en fin de compte le dernier mot, puisque ce sont elles qui votent.
Vous fûtes l’ami et le biographe de Philippe Jullian, « un esthète aux Enfers ». Vous avez aussi évoqué la princesse Bibesco. Ce monde des salons littéraires a-t-il disparu à jamais ? Si oui, quand et pourquoi ?
Le monde ancien, d’avant la Grande Guerre, a survécu d’une certaine manière jusqu’à mai 1968, car il y avait encore à Paris, dans ce qu’il est convenu d’appeler « le monde », des hôtesses tenant salon, des femmes aimant à réunir autour d’elles, sinon les meilleurs esprits, parfois récalcitrants, du moins des gens à la mode, ceux dont on parlait. Il y avait le salon académique de la duchesse de la Rochefoucauld, de sa belle-sœur, la comtesse de Fels, le salon musical de Mme Tézenas et d’autres encore où l’on voyait, devenus vieux, voire cacochymes, des jeunes gens qui avaient hanté jadis les salons décrits, sinon fréquentés, par Marcel Proust. Marthe Bibesco était une survivante de cette époque et l’avait bien connue ; elle l’avait aussi jugée à sa juste valeur et en a laissé une peinture exacte dans son roman le moins connu : Egalité. Philippe Jullian, lui aussi, a connu les vestiges de cette société, devenue d’ailleurs une sorte de Café-Society suivant le titre d’un de ses romans, et l’a cruellement caricaturée dans ses albums, comme dans l’illustration de certains de ses livres.
On se moquait alors, dans la fin des années 60, de ces dames assoiffées de gloire, aimant recevoir pour le plaisir d’être citées dans les chroniques mondaines, confondant leurs invités, prenant un peintre pour un écrivain, assurant à un cinéaste en vogue qu’elles se délectaient de son dernier roman, mais elles avaient du bon, car leurs salons étaient des endroits agréables où se retrouver, faire de nouvelles connaissances et faire aussi de l’esprit.
Les derniers salons ont fermé, car personne aujourd’hui n’a suffisamment de fortune pour avoir un hôtel particulier et y tenir table ouverte, ainsi que le faisait Marie-Laure de Noailles, ou un hôtel tout court, comme le Meurice où recevait chaque semaine Florence Gould. L’impôt sur le revenu, puis l’impôt sur la fortune et l’impôt sur l’impôt que représente la Contribution sociale généralisée, aboutiront progressivement à la disparition des patrimoines. Ainsi que je l’écris dans mon Petit dictionnaire des idées mal reçues, il n’y a pas en France égalité des citoyens devant l’impôt, mais égalisation des fortunes par l’impôt. Les cafés littéraires n’ont plus leur clientèle d’autrefois. La vague démocratique a tout englouti.
Vos projets ?
Dans un monde aussi démocratisé, où chaque citoyen est de plus en plus « conditionné », numéroté, en attendant d’être soviétisé par le biais trompeur du capitalisme international, comment faire des projets, sinon celui de « résister » ?
Paris, le 9 novembre 2007
Propos recueillis par Christopher Gérard.
La Presse littéraire XII, déc. 2007 – janvier 2008.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, savoir-vivre, aristocratie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







