24 septembre 2018
Chambolle-Musigny
Un extrait de "Chambolle-Musigny",
le chapitre XX de mon roman Le Prince d'Aquitaine
"Le vin que tu m’avais fait connaître malgré toi, je l’apprivoisai, en digne suivant de Dionysos, dont j’étudiai le mythe et les rites. Ce Dieu du vin, de la vigne et de l’extase, issu d’une mortelle, à la fois hellène et thrace, ce Dieu errant et un temps pourchassé, me fascinait. N’avait-il pas gagné les Indes ? N’était-il pas suivi de Bacchantes en délire ? N’est-il pas, encore aujourd’hui, source d’inspiration ?
Le vin qui libère et asservit, je le bois, parfois sans mesure excessive, mais toujours dans la joie, par amour de la vie plutôt que du morne plaisir, avec l’Aimée, avec les amis, sans une once de tristesse."
A paraître le 30 août chez Pierre-Guillaume de Roux
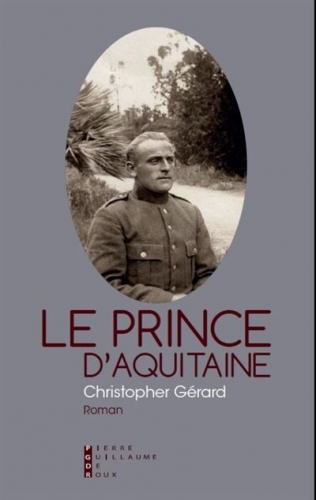
Pour plus d'information, voir ci-dessous sur Archaion
Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11 septembre 2018
Un Homme dans l'Empire

L’honneur d’un lieutenant
Pénaliste reconnu, auteur aux PUF de savants traités sur l’erreur et l’innocence judiciaires, Dominique Inchauspé se révèle aussi romancier de haut parage avec Un Homme dans l’Empire, élégant récit qui, sous la forme de lettres écrites par un officier à la femme qu’il a quittée, nous entraîne dans un empire imaginaire, mixte d’Imperium Romanum et de IIIème République. Comment, dès les premières pages, ne pas penser au Désert des Tartares, au Crabe Tambour ? Hautaine méditation sur la res militaris, sur l’honneur de servir au mépris des mesquines stratégies personnelles, cet envoûtant roman, anachronique à souhait, nous fait partager la vie d’un Impérial, le lieutenant Lertère Varlien. À elle seule, l’onomastique de M. Inchauspé est déjà un fascinant périple : Tamiena, Sarjagase, Silianques, Largethuse scandent ces pages inspirées.
Nous suivons donc un jeune lieutenant d’artillerie, depuis son instruction à l’Académie impériale jusqu’aux postes perdus des Provinces archaïques et du Pays verlare, sur ce limes qui subit la pression de tribus invaincues : Immuables, Kaliates et autres barbares des forêts et des steppes. Le soir, après le service, ce prétorien songe « à tous ces peuples qu’il faut contenir, à ces frontières qu’il faut fortifier, à ces immensités sur lesquelles s’étend notre règle, à ces postes perdus dans les confins hostiles où une poignée d’hommes autour de quelques enseignes, avec des armes solides, rappellent que nous fûmes promis à un destin exceptionnel, terrible et qui nous dépasse. » On pense à un proche cousin de Jünger, tout comme lui à la recherche d’un glorieux inconfort - qui n’est pas celui des tranchées, car il s’agit ici d’une guerre coloniale, atroce par définition. Faut-il tuer, torturer, ravager pour civiliser ? Quelle est la nature d’un empire ? Sa grandeur peut-elle reposer sur l’horreur, dépendre de canailles, profiter à des inconscients ? D. Inchauspé a créé là une magnifique figure de mainteneur, antimoderne en diable, qui nous accompagnera longtemps dans nos rêveries.
Christopher Gérard
Dominique Inchauspé, Un Homme dans l’Empire, L’Age d’Homme, 242 p., 19€
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20 août 2018
L'Estacade

Un extrait du chapitre III, L'Estacade
"Par quel paradoxe une ville aussi décatie qu’Ostende m’a-t-elle laissé l’un des rares beaux souvenirs de mon enfance ?
(...)
De ce long séjour à la côte, je garde une vision qui m’accompagne depuis toutes ces décennies. J’ai longtemps cru qu’il existait des photos de ce moment particulier, mais j’ai dû rêver, ou alors, les photos ont disparu avec le reste à la mort de Grand-Mère, lors du pillage de son appartement. Nous nous promenons, elle et moi, sur la plage qui donne sur l’estacade. Moi je gambade, le cœur dilaté comme jamais plus. Lors de ce qu’elle appelait « les commissions », elle m’a offert un avion en carton avec, pour le projeter dans les airs, une sorte de catapulte. Elle tire et moi, infatigable, je galope à perdre haleine derrière l’avion qui virevolte dans le vent de novembre pour le lui rapporter, fier comme Artaban. Tel est le tableau : Grand-Mère et moi, sur cette plage déserte d’Ostende, le sable crissant sous nos pas, les mouettes qui nous surveillent du coin de l’œil - et cette joie inouïe, unique, qu’elle semble partager. Nous parvenons à l’estacade et, bien que le soleil soit fort bas, elle accepte que nous fassions, en vitesse, la promenade jusqu’au bout, jusqu’au petit phare au pied duquel se rassemblent quelques pêcheurs. La mer, grise et froide, une toile que nous contemplons sous une fine pluie, la main dans la main. Jamais, je ne t’ai parlé de ce moment, ni à toi ni à ma mère, encore moins à Grand-Mère avec qui je l’ai vécu, ce moment qui aura été l’un de ces talismans qui aident à vivre. Ostende m’a appris que le bonheur se compose de rares instants que l’esprit peine à saisir, si vite à jamais évanouis."
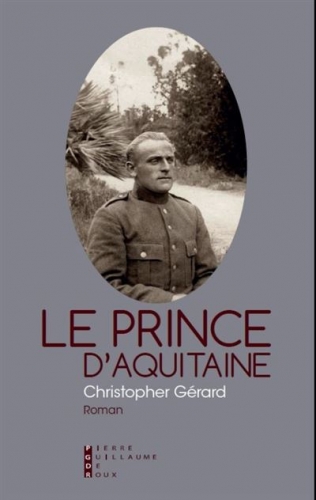
En librairie le 30 août
Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02 août 2018
Nimier, masculin, singulier, pluriel.
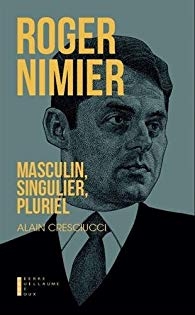
« Nimier écrit en français direct vivant, pas en français de traduction, raplati, mort » proclamait Céline dans une lettre à un confrère et néanmoins ami, pour dire son estime à l’égard d’un cadet. Il est vrai que Roger Nimier (1925-1962), disparu comme Albert Camus ou Jean-René Huguenin dans un accident de voiture, s’était démené sans compter pour sortir Céline du purgatoire. C’est l’une des nombreuses facettes de cet écrivain attachant qu’étudie avec rigueur et sympathie Alain Cresciucci dans une biographie qui est aussi et surtout le portrait d’« une génération heureuse qui aura eu vingt ans pour la fin du monde civilisé ». Génie littéraire à la monstrueuse précocité, dont son condisciple Michel Tournier a témoigné, Roger Nimier publia sept livres, cinq romans (dont Le Hussard bleu) et deux essais (dont Le Grand d’Espagne), en cinq ans, avant même d’atteindre la trentaine. Un météore donc, lui aussi, qui, en quelques années, s’impose comme le chef des Hussards, ces impertinents qui se rebellent contre le règne des idéologues marxistes et des pions humanitaires – Sartre et tutti quanti. « Libertin du siècle », comme il se définissait lui-même, Roger Nimier fut le fils spirituel de Georges Bernanos, qu’il rencontra lors de son retour d’exil. Mais aussi de Malraux et de Drieu la Rochelle, et, bien plus haut, de Retz et de La Rochefoucauld. Romancier mélancolique, critique implacable, éditeur d’élite chez Gallimard (Céline et Morand lui doivent leur renaissance), dialoguiste de cinéma (entre autres pour Louis Malle dans le sublime Ascenseur pour l’échafaud), Nimier aurait pu devenir, sans cet accident stupide au volant d’une Aston Martin, l’un des maîtres de sa génération. Quinze ans après sa mort, son ami Pol Vandromme, inconsolable, le saluait en ces termes : « Son existence est humble et aristocratique. Il a découvert le rugby dont le goût rejoint bientôt chez lui celui des armes anciennes, du dessin, de la papeterie, des condiments, du champagne et de l’eau fraîche, tout ce qui brûle ou ce qui glace, tout ce qui fait la vie plus sage et plus virile, plus fidèle et plus forte. »
Christopher Gérard
Alain Cresciucci, Roger Nimier. Masculin, singulier, pluriel, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 25€
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04 juillet 2018
Dominique de Roux parmi nous
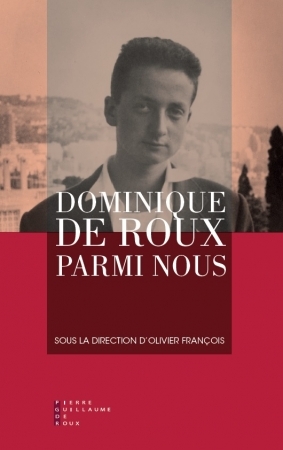
« Il n’a pas été remplacé et il nous manque beaucoup » disait le regretté Pol Vandromme en parlant de son ami Dominique de Roux (1935-1977), éditeur de deux revues mythiques Les Cahiers de l’Herne et Exil, fondateur des éditions Christian Bourgois et de la collection 10/18, écrivain aux fulgurances inouïes.
Une sorte de barbare en fait, mais au service d’une certaine idée de la civilisation, notamment française, qu’honorait un récent colloque de la revue Eléments, où Dominique de Roux demeure très présent depuis quarante ans, comme l’illustrent des articles parfois anciens de Jean Parvulesco, Michel Marmin ou André Coyné.
Celui qui passa sa courte existence à défendre Céline, Pound et Abellio, cet éditeur allergique à « la volaille universitaire », ce héraut d’un gaullisme «nervalien», cet écrivain en guerre qui s’épuisa dans une quête haletante, se voit ici salué par quelques-uns de ses héritiers ou de ses débiteurs.
Son fils, l’éditeur Pierre-Guillaume (qui maintient aujourd’hui l’esprit de l’Herne, mais aussi celui de la Table ronde, de l’Age d’Homme ou du Rocher) rappelle l’importance des Cahiers de l’Herne, créés avec trois francs six sous par ses parents pour redonner la parole aux Impardonnables, « ces écrivains exigeants, malcommodes, habités par une manière de déplaire parce que profondément solitaires ».
Son ami Gabriel Matzneff dit la même chose que Pol Vandromme : sa mort à 42 ans à peine fut pour lui une « mutilation sans remède ». Surtout, il insiste sur le fait que, pour son ami Dominique, l’écriture était un acte de vie, tout le contraire d’un jeu ou d’une stratégie mondaine.
François Bousquet, l’ancien pilier de la rue Férou, librairie mythique où officia un temps le jeune Olivier François, directeur du présent recueil, fait justement le lien entre Dominique de Roux et un autre prodige des Lettres, Vladimir Dimitrijevic, alias Dimitri. Dans son éloge passionné, il rappelle que c’est Dominique de Roux qui offrit le Pétersbourg de Biély à Dimitri, permettant ainsi la naissance des fameux Classiques slaves, et donc la montée en puissance d’une maison longtemps non conforme.
Laurent Schang, un fidèle, qui saluait déjà de Roux il y a vingt ans dans une revue underground de Metz, évoque la géopoétique de cet auteur qui voulut « retarder la vieillesse du monde ». Et Philippe Barthelet, auteur d’un joli Qui suis-je ? chez Pardès, rappelle ce mot lourd de conséquences de Jünger : « S’il y a de l’indestructible, alors toutes les destructions imaginables ne sont que des purifications ».
Christopher Gérard
Olivier François dir., Dominique de Roux parmi nous, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 122 pages, 19,90 euros.
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |








![IMG_1511[1].JPG](http://archaion.hautetfort.com/media/02/02/1167055680.JPG)