26 avril 2023
Epicurea
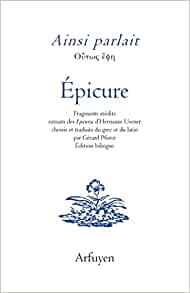
Épatant, ce volume de fragments inédits d’Épicure choisis et traduits du grec et du latin par Gérard Pfister, poète, spécialiste du dadaïsme et de la mystique rhénane, fondateur des éditions Arfuyen ! Traducteur e.a. du turc, de l’allemand et de l’italien, Gérard Pfister maîtrise aussi les langues classiques, qu’il rend dans un français d’une subtile fermeté. Comment ne pas rester pantois devant pareil travail de transmission tout de passion et de rigueur ? Comment ne pas être ému par le fait qu’il ait dédié son livre à Marcel Conche, authentique philosophe et incomparable connaisseur d’Héraclite, de Lucrèce et de Montaigne ?
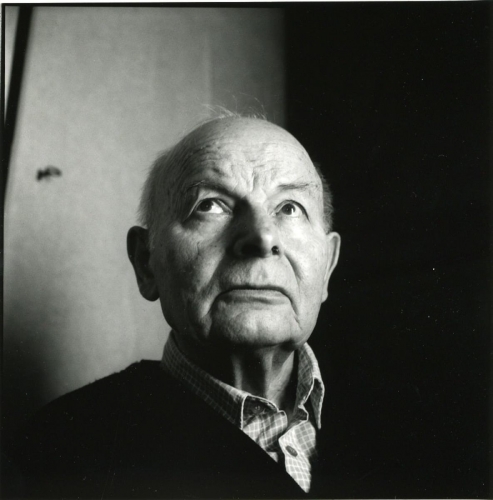
Inédits en français, ces Epicurea avaient été collationnés au XIXème siècle par un philologue allemand, Usener. Son lointain disciple, le néerlando-alsacien Pfister, en propose une anthologie, 242 fragments tirés d’auteurs grecs ou latins, païens ou chrétiens, qui synthétisent la pensée du philosophe du Jardin, Épicure (341-270 AC), dont le mot d’ordre pourrait être summum bonum voluptas, laquelle voluptas consiste à nihil dolere. La souffrance, le trouble, l’instabilité, voilà le mal ! Et les faux besoins, et la vie malsaine, et tout ce qui enchaîne l’homme et le rabaisse, par exemple les désirs absurdes, les opinions reçues : « Celui qui suit la nature et non les vaines opinions est auto-suffisant en tout. Au regard de ce qui suffit à la nature, toute possession est richesse ; au regard des appétits sans limites, même la plus grande richesse est pauvreté ».
À rebours du dieu jaloux (et donc faible) qui punit les enfants pour les crimes des parents, celui d’Épicure est bienheureux car immortel, incorruptible - rien ne l’atteint, pas même nos sacrifices et nos supplications, rien ne l’affaiblit ni ne l’altère. Ni bonté ni colère ne troublent son cœur de cristal. Quant à l’univers, loin d’être créé à partir de rien par quelque invisible magicien, il est le tout infini, incréé et incorruptible : « Il n’y a pas de naissance des choses qui n’étaient pas, ni de destruction de choses qui sont ; mais la conjonction de certaines choses qui sont avec d’autres s’appelle « naissance », et leur séparation s’appelle « mort ». »
Epicure nous exhorte à dompter nos faims et nos espérances, à réduire les besoins au pain et à l’eau – c’est dire si cette « joyeuse pauvreté », cette sereine frugalité sont loin du cliché du pourceau vautré dans la fange. Lisons ces Epicurea, leçons d’austère rectitude, guides pour la vie sage et bonne !
Christopher Gérard
Épicure, Ainsi parlait Épicure, trad. Gérard Pfister, édition bilingue, 192 pages, 14€

A Londres, avec le Maître.
Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : arfuyen, philosophie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04 mai 2022
Sire Orphée
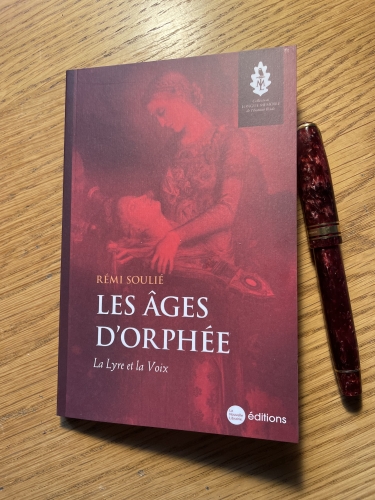
Rémi Soulié, dont le patronyme évoque le soleil du Rouergue (pensons à Soulès, le vrai nom d’Abellio), est le disciple du philosophe Pierre Boutang, à qui il a consacré un fervent essai ; il est aussi spécialiste de Nietzsche et de Péguy. Depuis une vingtaine d’années, il publie des livres rares et recherchés où il dévoile par étapes un paysage mental des plus singuliers, et où s’exprime une saine méfiance à l’égard de l’homme de l’Âge sombre, celui de l’homme « diminué ».
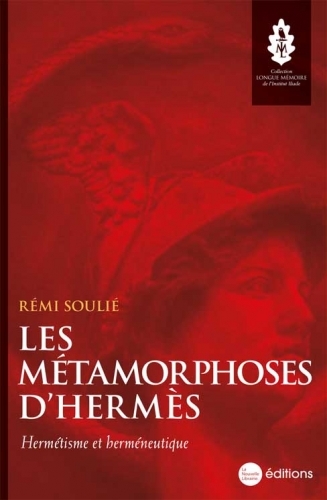
Cette quête de sens quasi alchimique, il la poursuivait tout récemment dans Les Métamorphoses d’Hermès, où il tentait de mieux définir ce frère d’Apollon et père de Pan, à la fois dieu de l’Olympe et ami des mortels, héraut et messager, interprète de la volonté divine. Intercesseur et guide secret, Hermès traverse notre inconscient depuis l’Égypte (Thot) jusqu’à la France du Grand Siècle, jusqu’aux poètes romantiques (Blake et Nerval), jusqu’aux rôdeurs des confins.
Aujourd’hui, il se penche sur la figure d’Orphée, fils d’un roi thrace et de la muse Calliope, époux malheureux d’Eurydice, qu’il va rechercher - et perdre à nouveau - jusque dans les Enfers. Orpheus, en grec, fait probablement référence à orphnos, l’obscurité – il est donc le Ténébreux… mais un ténébreux double, comme nombre de figures helléniques (Apollon en personne n’étant pas univoquement solaire).
Comme dans ses essais antérieurs, Rémi Soulié fait ici preuve d’une densité de pensée vertigineuse, qui peut parfois se traduire par un déluge de références.
Pour paraphraser Mallarmé, « Avant Homère, quoi ? Orphée ». Nous sommes bien à la source du miracle grec, entre ordre et chaos, lumières et ténèbres, science et oracle. Un lai breton du XIVème siècle, Sir Orfeo, fait le lien avec l’univers celtique et les archétypes indo-européens tels que la primauté de la Nuit ou l’arbre cosmique. Rémi Soulié perçoit bien le caractère paradoxal d’Orphée, figure secrète, éminemment prémoderne, qui inspira un autre mage thaumaturge, lui aussi revenu du monde des morts.
Christopher Gérard
Rémi Soulié, Les Âges d’Orphée. La Lyre et la Voix, La Nouvelle Librairie, 75 pages, 7€
Chez le même éditeur, Les Métamorphoses d’Hermès.
*
**
Lire aussi :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2021/02/19/les-metamorphoses-d-hermes-6298702.html
Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : iliade, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27 avril 2022
La Lyre et le Caducée

Disparu en 2020, Jean-François Gautier, dont j’ai naguère chroniqué sa lumineuse défense du polythéisme, A Propos des Dieux, avait, dans les années 90, publié deux essais remarqués, L’Univers existe-t-il ? et Claude Debussy. La musique et le mouvant, tous deux chez Actes Sud. Nous correspondions déjà depuis quelque temps. D’emblée, le personnage avait suscité chez moi une sorte de fascination : docteur en philosophie avec une thèse sur Gorgias et la sophistique, assistant à l’Université de Libreville, et donc promis à une carrière sans histoire de mandarin, n’avait-il pas rompu les amarres pour se lancer dans des recherches personnelles, devenant même rebouteux après de brillantes études d’étiopathie ? Voici ce qu’il nous disait alors dans un mémorable entretien accordé à ma revue Antaios à laquelle il allait collaborer, notamment avec des études sur Héraclite et Cioran : « Dans une société où l’on ne peut plus se révolter qu’en faveur du système en place, et jamais contre lui, les carrières n’ont plus d’objet : elles n’enrôlent que des séides. Tous ceux qui m’avaient fourni un état, l’Université, la presse et l’édition, je les ai quittés, de manière parfois un peu rude, à la mesure de l’empressement qu’ils mettaient à me convaincre de rester. Je retrouvais là, par mes propres voies, la défiance de mes maîtres Julien Freund et Lucien Jerphagnon à l’égard des institutions. Et me voici rebouteux de village comme d’autres furent cordonniers ou polisseurs de verres, libre de mon emploi et débarrassé des comptes à rendre. » La figure d’Antée lui paraissait fondamentale : l’évoquer lui semblait une façon de dire : « seul est secourable ce qui n’a pas de sens fixé par avance, et qui est assez fidèle pour incliner à en fabriquer un. Telle est la Terre. » Il ajoutait, et ces mots de l’été 1996 sont loin d’avoir pris la moindre ride : « Nul ne connaît les conditions pratiques du retour d’Antée. Il naîtra avec l’immense lassitude que fabriquent les sociétés modernes, due au servage du sens qu’elles imposent pour mieux faire aimer leurs marchandises. Quels mythes en seront les porteurs, les médiateurs ? Nul ne le sait, mais certainement pas l’Univers, ni le code génétique ou les particules élémentaires. »
Cet homme savant, issu du terroir charentais – et influencé, nous confie son fils, par le style de Jacques Chardonne, était musicien, cuisinier, marin – et quel critique d’art ! Une sorte de Pic de la Mirandole, accessible et plein de sympathie pour ses cadets. Dans sa première lettre, voici ce que, magistral, il m’écrivait pour me mettre en garde contre les illusions « restauratrices » : « L’avenir est plus aux franciscains et aux anarques qu’aux croisés des grandes batailles. Il vaut mieux apprendre une manière de faire et de vivre qu’une manière de dire ou de convaincre. L’exemplarité instaure ; le reste, même s’il croit restaurer, s’enlise. »
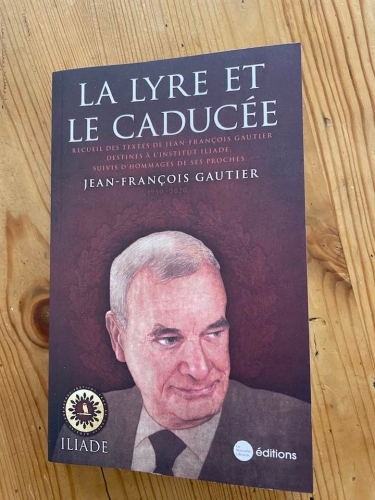
Aujourd’hui, je retrouve ce ton, cette généreuse lucidité dans le joli recueil de ses contributions à l’Institut Iliade, assorties de quelques hommages. Le lecteur y découvrira la synthèse de sa réflexion sur le divers comme norme et le refus des illusions monomanes - l’Un, pour ce polythéiste d’une rare cohérence, était proche du Rien. Ce parfait connaisseur des mythes grecs rappelait aussi que l’Espérance reste un mal, le tout dernier à stagner au fond de la jarre ouverte par la calamiteuse Pandore. Jean-François Gautier avait aussi développé le couple Hestia-Hermès, la vierge et l’ange, symbolisant la pérennité et le mouvement. Aussi, ce concept de Mitsein, corollaire du Dasein, être-avec allant de pair avec être-là, car les Européens, depuis les origines (helléniques) distinguent ce qui est chez eux de ce qui est dehors. Écoutons ce sage : « choisir la nature comme socle de représentation de la vie individuelle ou civique est une manière décidée de conjuguer le nécessaire (politique) de l’action collective et le contingent (éthique) de sa mise en œuvre pratique, toutes choses que l’individualisme contemporain s’efforce depuis des décennies de contourner. » Ou ce brillant raccourci grammatical : « Les Européens n’aiment pas être le complément de quoi que ce soit, ils préfèrent être les sujets de l’action, c’est-à-dire, chez eux, les maîtres de leur sort. »
Nulle illusion de salut, mais l’énigme du monde, un monde éternel sans fin ni début ; l’honnête reconnaissance de l’inconnaissable et le refus des rassurantes certitudes – telle est l’inoubliable leçon du regretté Jean-François Gautier.
Christopher Gérard
Jean-François Gautier, La Lyre et le Caducée, Institut Iliade -Nouvelle Librairie, 138 pages, 16 €
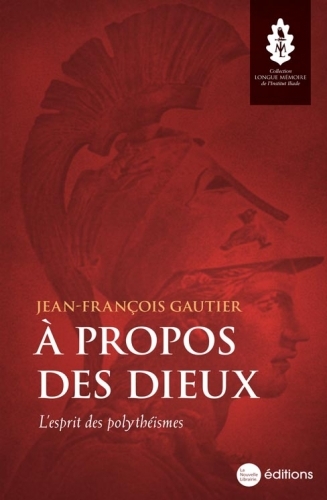
Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : iliade, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20 décembre 2021
OPTIMUM SOLSTITIUM

A tous les amis & correspondants,
joyeux solstice et heureuse année MMXXII
Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20 juin 2021
SOLSTITIUM

"Il faut éteindre la démesure
plus encore que l'incendie."
Héraclite, fragment 48.
Joyeux solstice d'été MMXXI
Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







