03 décembre 2019
Le Jeune Homme à la mule

C’est là un roman enchanteur, dont la magie fait son effet de la première à la dernière page, que nous offre Michel Orcel. Né en 1952 dans une antique famille provençale, Michel Orcel est philosophe, islamologue et romaniste de formation. Critique littéraire et musical, il est aussi traducteur de Leopardi, Dante, Michel-Ange et D’Annunzio, entre autres. Un humaniste au sens classique du terme, également éditeur (L’Alphée) et surtout poète jusqu’au bout des ongles tant sa sensibilité transparaît dans ce magnifique roman picaresque et stendhalien, qui se lit d’une traite et avec jubilation.
Tout le roman baigne dans une lumière ocre et se révèle parfumé de thym, d’orange et de bergamote – un délice.
L’intrigue ? L’éducation sentimentale et politique du jeune Jouan Dauthier, patricien provençal, que nous suivons dans ses aventures sur les routes du comté de Nice encore sarde jusqu’à Gênes et à Milan. 1790 : la Révolution étend son ombre menaçante sur une Provence encore intacte. Un chanoine aux allures de maître espion recrute Jouan dans la conjuration qu’il mène au service de Rome, bien inquiète des progrès des Idées nouvelles, et surtout de la guillotine. Notre jeune espion s’éprend de la divine Giuditta, une cantatrice vénitienne au joli tempérament… tout en restant amoureux de Nanette, la fille du médecin de Sigale, son village. Orcel cite Sénèque et L’Arioste, se moque avec esprit du narrateur dont il souligne d’imaginaires défauts et s’amuse à nous promener sur les routes de sa Provence. La grâce du style, limpide, les jeux linguistiques, la ponctuation soignée avec art, tout concourt à rendre ce Jeune Homme à la mule délicieux. La liberté de ton du romancier, peu séduit par les blandices révolutionnaires ajoute à l’intérêt du livre, par exemple quand il fait dire à l’un de ses attachants personnages : « Le moindre maire se prend pour Caton ou Brutus et s’imagine sauver le peuple du despotisme des tyrans ; en vérité, on guillotine n’importe qui pour n’importe quoi. » Ou, justement sur le peuple, cette idole nouvelle (en 1790) : « le peuple n’est qu’une entité commode que ces canailles ont inventée pour servir leurs desseins. » Ou enfin : « Tout le monde n’était pas dupe de cette frénésie de liberté, et certains, qui seraient passés pour des imbéciles aux yeux des avocats et autres petits clercs qui détruisaient allègrement l’ordre ancien en comptant bien prendre la place de la noblesse, se doutaient que le pire était peut-être à venir ». Orcel parvient avec brio à mettre en scène une tragédie dont il atténue la cruauté par le truchement d’une légèreté sans rien de creux.
Christopher Gérard
Michel Orcel, Le Jeune Homme à la mule, Pierre-Guillaume de Roux, 216 pages, 17.90€
Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15 novembre 2019
Avec Jean-Pierre Montal
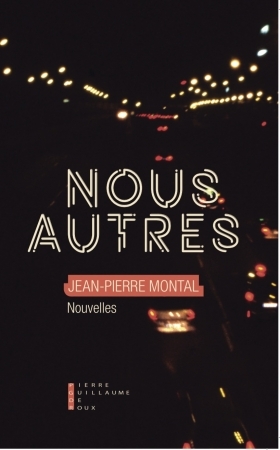
Depuis bientôt sept ans, je suis Jean-Pierre Montal à la trace, comme éditeur (rue Fromentin) et comme auteur – j’ignore tout de sa vie dans les milieux du rock, musique que j’abhorre.
En 2013, je m’enthousiasmais en effet pour son coup d’essai, un Tombeau pour Maurice Ronet au ton si juste et où se conjuguaient talent et loyauté.
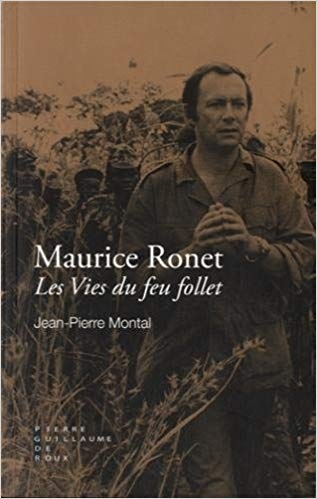
Deux ans plus tard, Montal nous livrait son premier roman, Les Années Foch, dont je saluais la voix si singulière, comme entêtante – une sorte de plongée à la Modiano (un Modiano post-moderne) dans les années 90. L’ombre d’un ami disparu, le mystérieux Jean Parvulesco, planait sur ces deux talismans, de même qu’une atmosphère à la Melville, comme ouatée et, j’ose me citer, « pleine d’angles morts ».
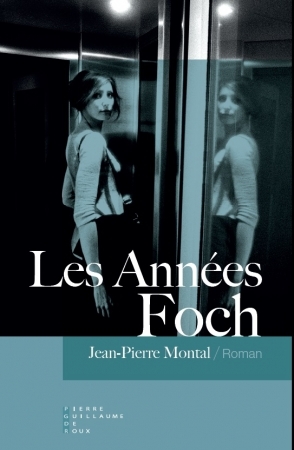
Deux ans plus tard, Les Leçons du vertige, « roman métapolitique et analyse spectrale de notre bel Occident », confirmaient mon intuition tant son savoir-faire, son élégance et sa finesse de moraliste lucide ne pouvaient que séduire le lecteur exigeant. J’aime cette ligne claire qui est la sienne, ce ton désabusé, cette impression de flottement (totalement dépourvue de veulerie). Bref, j’étais conquis.
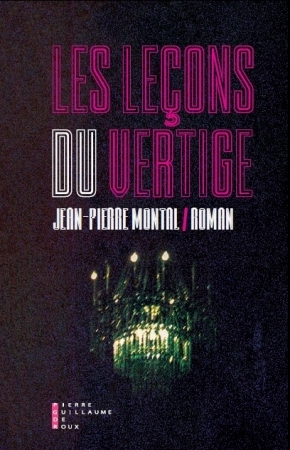
Aujourd’hui, il se lance dans l’art difficile de la nouvelle, avec brio. Les dix nouvelles qui composent Nous autres (allusion à Zamiatine ?), rédigées dans un style impeccable - pas une once de graisse -, avec un humour désespéré (mais drôle, et d’un désespoir sans mièvrerie aucune) révèlent que l’écrivain a franchi un cap et atteint une forme de maturité.
Rythme, ton, style ciselé, chutes réussies, personnages bien campés, décors – tout y est. Et notamment, un tableau dévastateur de la culture managériale qui détruit tout sur son passage, entreprises privées et publiques, sans oublier les personnes, laminées par open spaces & flexoffice, « éléments de langage » et autres team building.
Parmi mes nouvelles préférées, « Le Son », conte dans la veine réaliste magique (une corne de brume qu’entendent quelques élus, pour les mener où ?) ; « 25 bis rue Jenner », sur l’incendie qui détruisit les studios du génial cinéaste Jean-Pierre Melville ; « En Marge », sur le destin d’un écrivain débutant qui tombe par hasard sur son premier livre annoté par un lettré aussi fin que cruel.
Pour revenir à « 25 bis rue Jenner », Montal a une idée de génie quand il fait découvrir par son héros dans un garage de banlieue l’un des décors du Samouraï, ce bar improbable, comme tous les night-clubs melvilliens, où Jeff Costello tombe sous les balles de la police. Sacré Montal !
Christopher Gérard
Jean-Pierre Montal, Nous autres, nouvelles, Pierre-Guillaume de Roux, 216 pages, 18€
Il est question de Jean-Pierre Montal dans mes Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23 août 2019
Avec Pierre Mari
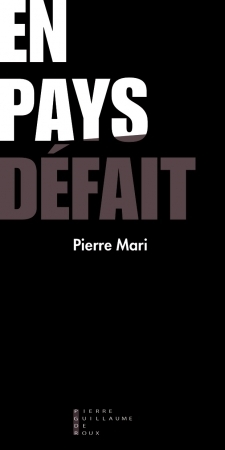
Le titre, En Pays défait, annonce la couleur : l’auteur, Pierre Mari (1956), auteur d’essais sur Rabelais et Kleist, mais aussi de romans, ne donnera ni dans le consensus mou ni dans le tiède acquiescement. La collection où il publie sa charge contre les mandarins d’aujourd’hui abrite quelques brûlots (les zélotes de Sartre & Foucault en prennent pour leur grade) ; son éditeur, le cher Pierre-Guillaume de Roux, s’inspire sans se cacher le moins du monde de ces précieux volumes allongés de couleur brune (Libertés 49, dirigée par Jean-François Revel) que Jean-Jacques Pauvert éditait dans les années 60 et où l’on retrouvait Berl et Papaïoannou, d’Holbach et Barbey. En cherchant bien chez les bouquinistes survivants, on trouve encore pour quelques euros ces pamphlets d’un autre temps.
Mari, lui, est bien du nôtre, de temps, qu’il qualifie, dans une langue toute classique, de « bagne anthropologiquement inédit » - ce qui est bien vu, puisque, naguère encore, « tout le monde n’appartenait pas au même temps ». Les aspects déplaisants de l’époque, de toutes les époques, pouvaient être compensés par la survie de bulles temporelles comme par la possibilité de « faire dialoguer l’ici et l’ailleurs, le jadis et le maintenant ». Cette possibilité, cet échappatoire sont lentement mais sûrement éradiqués, sous nos yeux, avec la complicité active d’élites aussi déconnectées qu’indifférentes : « Je parle de vous tous qui bénéficiez d’une forme ou d’une autre de consécration, et chez qui j’observe la même pathologie, entretenue et même cultivée : l’incapacité de dire les choses comme tout le monde les sent – l’empêchement de sentir juste et fort. Comme si, dès qu’on échappe à l’anonymat, un implacable constat de tiédeur devait être signé avec la machine pourvoyeuse de visibilité. » Docilité et convenance sont de toutes les époques certes, comme l’abaissement moral, mais depuis les années 80, l’universelle démission, la rupture névrotique du lien civilisationnel, l’amnésie forcée sont devenues la règle. Le désarroi, l’accablement de Pierre Mari, qui sont ceux de toute une génération, la mienne, proviennent de notre impuissance à comprendre ce qui nous est arrivé.
Comment ce « morne alignement des têtes » que, naïfs, nous croyions propres aux défunts régimes à parti unique, comment cette insupportable langue de coton (un salut en passant à François-Bernard Huyghe qui, le premier, analysa cette dernière), comment ce déclin du courage civique et ce conformisme hargneux se sont-ils ainsi imposés ? C’est ce mystère, ce désir mortifère de sombrer que le talentueux Pierre Mari dissèque d’un scalpel sûr, sans anesthésie.
Christopher Gérard
Pierre Mari, En Pays défait, Ed. Pierre-Guillaume de Roux, 186 pages, 16€
Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, pamphlet, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02 mai 2019
Tour d'ivoire

Moins de deux ans après le magnifique et très-subversif L’Homme surnuméraire, le Nantais Patrice Jean propose son cinquième roman, Tour d’ivoire, dont le décor, et en fait l’un des personnages principaux, est Rouen, la ville de Gustave Flaubert. Comme dans son précédent roman, le héros, Antoine, est un déclassé, un lettré « surnuméraire » qui a fait le choix de la pauvreté volontaire pour se consacrer, stricto sensu, à une revue littéraire, confidentielle comme son nom l’indique, Tour d’ivoire. Un raté en somme, selon les critères aujourd’hui en vogue, qu’accompagne son ami ( ?) Thomas, encore plus intraitable sur la pureté de l’engagement en faveur de l’art pour l’art. Tout le roman tourne autour du dialogue, tantôt véhément, tantôt muet, entre ces deux hommes : faut-il céder, ne fût-ce que d’un pouce, aux sirènes, même postmodernes ?
Antoine a donc choisi l’obscurité, décevant ainsi son épouse, qui le largue (et cesse de jouer au mécène) et, bientôt, sa fille Blandine, que viendra consoler l’attentionné Thomas. Il vivote dans un HLM de la Grand’Mare (hilarants tableautins du « vivre-ensemble ») et se contente de CDD à la médiathèque Arthur Rainbow (!), l’un des décors du roman – prétexte pour l’auteur à une description aussi comique que glaçante du dispositif d’infantilisation des masses et de leur encadrement « culturel ». Notre bibliothécaire tranche d’avec ses jeunes collègues, acquis à la culture du divertissement et conscients de leur rôle dans le dressage « citoyen » de leurs usagers. Il fera, ô surprise, l’objet d’une dénonciation en règle pour un article littéraire de sa revue consacré à un écrivain qui, dans un français parfait, ose évoquer l’actuel chaos migratoire et ses conséquences sans l’enthousiasme ni la cécité de commande.
Avec un calme courage, Patrice Jean s’attaque à la doxa dominante, usant tour à tour de la cruauté du polémiste et de la douceur toute en sensibilité de l’artiste - un tueur en dentelles. L’une des questions qu’il pose est celle de la place de la culture authentique, vécue non comme docile consommation de produits estampillés culturels mais bien comme quête désintéressée du beau et du vrai, comme métamorphose. Comment résister à la méthodique profanation de la littérature ? Comment éviter son fatal déclassement dans un monde où l’argent est tout, où l’industrie culturelle dicte le mauvais goût et la bonne pensée : « A quoi bon psalmodier le bréviaire de l’exigence spirituelle dans un monde livré au néant de la matière, sous le soleil de la marchandise victorieuse, à l’ombre du divertissement ricaneur ? »
Doué d’un jolie vis comica, l’impeccable styliste qu’est Patrice Jean* réussit ses descriptions de types humains, comme le progressiste, qui, pour recevoir une gratification narcissique (« susucre ») affiche de manière pavlovienne sa « révolte » au service du Bien (« papatte ») et qui, dans un désir éperdu de Vertu, s’arroge le pouvoir de cataloguer, et donc de condamner, une personne, même inconnue de lui, selon l’idée qu’il se fait d’elle, au gré de ses humeurs ou de ses intérêts : « En ce monde perdu, est-il plus sotte façon, plus lâche posture, que celle où l’on abdique la dignité du doute pour revendiquer, moralement, la supériorité d’être dans le vrai et le bien, au-delà des interrogations, dans le confort d’un choix juste et solide, jamais remis en cause ? »
Nihil novi depuis Tartuffe & Trissotin, certes, mais, aujourd’hui, ces ligues de rééducation, véritables bataillons de termites, sont légion, et servies par l’électronique, et défendues par des élites de pacotille.
Tout cet ambitieux roman, rédigé dans une langue limpide, charpentée par un compagnon du devoir devenu maître, pousse le lecteur à s’interroger sur notre crépuscule et sur la nature de la littérature comme défense et illustration du monde invisible, comme quête ascétique d’une forme d’excellence.
Christopher Gérard
Patrice Jean, Tour d’ivoire, Editions rue Fromentin, 244 pages, 21€.
* J’ai buté sur une seule scorie : un « tacler » par trop journalistique … sans doute utilisé avec ironie.
Lire aussi

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29 avril 2019
Exit Jean-Claude Albert-Weil

CG et Jean-Claude Albert-Weil au cocktail organisé en novembre 2000 à L'Age d'Homme, rue Férou, pour la parution de Parcours païen.
A l'arrière-plan, Jean Parvulesco.
C’est à Rome que j’ai appris la disparition en avril du cher Jean-Claude Albert-Weil (1933-2019), l’un des écrivains les plus singuliers que j’ai rencontrés. Cette chance, je la dois à mon ami Marc Laudelout, l’éditeur du Bulletin célinien, qui, vers 1997, attira mon attention et celle de quelques happy few sur un hallucinant roman, mixte de Swift et de Philip K. Dick, Sont les oiseaux.
Alors inconnu, si ce n’est des milieux du jazz où il s’était fait un nom, l’auteur publiait, au Rocher, une uchronie que l’on peut, oui, qualifier de géniale, où il imaginait l’écrasante victoire du Reich en 1940, suivie de l’instauration du Grand Empire eurasiatique, traversé de Dunkerque à Vladivostok par une autoroute monstrueuse, Panfoulia. Roman « visionnaire », comme le qualifiait Jérôme Leroy dans sa quatrième de couverture, Sont les oiseaux fut pour moi un coup de massue, peu ou prou comparable à celui du Voyage, dont Jean-Claude Albert-Weil, qui m’enguirlandait quand je prononçais son patronyme à l’allemande, était un fanatique, lui qui plaçait si haut Céline, mais aussi Swift et Rabelais.
Lorrain par son père, descendant des Juifs du Roi, protégés par Louis XIV, bourguignon par sa mère, de tradition gaulliste et patriote, Jean-Claude rêvait, lui aussi, au retour des Grandes Dionysies, mais au sein d’un empire non-humaniste, « existenciste » et heideggérien, où le jazz aurait été musique officielle et la publicité interdite, comme bien d’autres pratiques « ploutocratiques ». Une bombe donc, à l’ahurissante créativité verbale et d’une liberté de ton qui faisait jubiler le lecteur. L’auteur crut bon de rédiger une suite, sous la forme d’un trilogie : Europia (nouveau titre de Sont les oiseaux dans la réédition), Franchoupia et Siberia.
Je ne fus pas séduit par ces suites dont le délire narratif et langagier me rebuta. Je pense que Jean-Claude Albert-Weil fut l’homme d’un seul livre, un roman-monde où il déversa d’un coup et dans le bon ordre ses phantasmes de démiurge. Je l’avais perdu de vue depuis longtemps, ce qui n’atténue en rien ma peine à l’idée de ne plus revoir cet homme unique qui m’aimait bien.
Sit tibi terra levis !
Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







