23 février 2024
Exit Alfred Eibel

Triste nouvelle, Alfred Eibel est mort. Né à Vienne en 1932 - il se souvenait de l'Anschluss et de l'entrée d'Adolf Hitler dans sa ville - il avait vécu en Belgique, où il avait étudié au prestigieux Collège Cardinal Mercier. L'homme était charmant, immensément cultivé et d'une merveilleuse bienveillance pour ses cadets - j'en sais quelque chose pour avoir lu quelques lignes généreuses sur certains de mes livres. Je l'avais rencontré à une signature de Radio Courtoisie : j'avais été présenté par Michel Mourlet, sésame parfait, et nous avions immédiatement noué un lien. Il avait fréquenté Ernst Jünger et Fritz Lang, Arno Breker et Leni Riefenstahl (ce qu'il disait avec un sourire délicieusement ambigu), Gregor von Rezzori. Un temps éditeur à Lausanne (il dilapida ainsi un semblant de fortune), il publia Fernando Pessoa (le premier, me dit Jérôme Leroy, qui m'apprend sa mort), Jean-Pierre Martinet, Kenneth White...

Critique littéraire, il écrivit dans Le Quotidien de Paris, les Nouvelles littéraires, les Lettres Françaises, le Figaro, Le Magazine littéraire, et aussi dans Matulu, la Revue littéraire, Polar, Service littéraire…
Voici ce que j'écrivais il y a deux ans à propos de ses Souvenirs viennois.
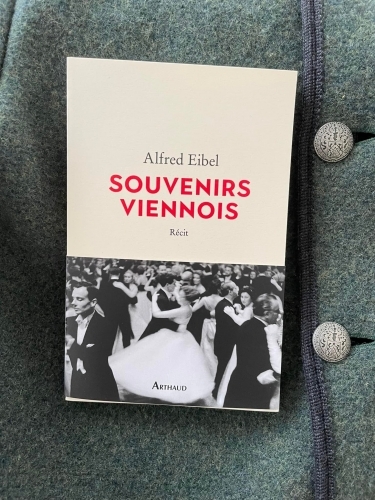
Né en 1932 à Vienne d’un père officier tôt disparu et d’une mère austro-hongroise, Alfred Eibel est une figure attachante de la vie littéraire qui a traîné ses bottes de Bruxelles à Hollywood, de Prague à Zürich. L’homme a fréquenté bien du monde : Fritz Lang et Kenneth White, Léo Malet et Etiemble, Gregor von Rezzori et Gabriel Matzneff (qu’il a édité, avec quelques autres, dont Gérard Guégan et Pol Vandromme). Il connaît sur le bout des doigts le cinéma européen, la littérature chinoise et l’opéra autrichien. De père catholique, il a connu, après l’Anschluss, l’exil en Belgique avec son beau-père juif. Il est sans doute l’un des rares écrivains français d’aujourd’hui à avoir vu passer Hitler dans la Vienne de 1938 et à avoir entendu les stukas mitrailler les foules de l’exode en 1940. Alfred Eibel est un personnage de légende.
Voilà qu’il nous livre ses Souvenirs viennois par le truchement d’un joli ouvrage à la nostalgie ironique, car l’homme n’est jamais dupe. « En naissant à Vienne, écrit-il, j’ai vu le jour sur une zone sismique qui m’a fait penser à chaque instant à la disparition définitive du passé, à l’exemple de l’Atlantide ». C’est justement cette cité engloutie qu’il évoque par tableautins : la Vienne des années 50, qui lui sert de marchepied pour nous replonger, par fines allusions, dans celle de la Double Monarchie. Jonglant, non sans un zeste de perversité, entre kitsch et retour du refoulé, Alfred Eibel ressuscite la pension Operning, où il descendait naguère, avec ses naufragés de toutes sortes : rescapés des camps au sourire poli, émigrés revenus des Amériques et tous ces « accourus », Berlinois qui ont quitté leur ville rasée pour se faire oublier. Aux tables des grands cafés viennois, le Sacher, le Central ou le Mozart, il croise requins et margoulins, espions (nous sommes bien dans la Vienne du Troisième Homme – der Dritte Mann), mélomanes et cinéastes. La Vienne d’Alfred Eibel se révèle une ville à l’insouciance surjouée, qui tente de refouler les horreurs d’un passé récent ; il en rend avec brio l’atmosphère ambiguë et parfois frelatée.
Que la terre vous soit légère, cher Alfred Eibel !
Christopher Gérard
Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : eibel, littérature, cinéma | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22 août 2023
Georges Sanders, canaille aristocratique

« S’il est vrai que le caractère d’un homme penche dans le sens du bien en fonction du plaisir, du degré de bonheur et de la quantité de tendre amour dont il a joui durant l’enfance, alors je devrais avoir le caractère le plus noble et le plus magnifique du monde. Personnellement, je pense être la preuve vivante de cette affirmation. Toutefois, un nombre surprenant de personnes sont d’un avis contraire. » Tout est dit en quelques lignes de et par cet acteur d’allure anglo-saxonne, Georges Sanders (1906-1972), qui, plus de trente ans durant, a joué sous la direction des plus grands réalisateurs, d’Alfred Hitchcock à Fritz Lang, de Joseph Mankiewicz à Julien Divivier, d’Otto Preminger à Roberto Rossellini.
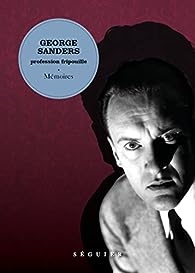
Le titre original de ses amusants mémoires, Memoirs of a Professionnal Cad, donne le ton : cad, en anglais, désigne la crapule ou le goujat en version distinguée. Très vite, il se spécialise en effet dans le rôle du salaud élégant, espion nazi ou escroc cosmopolite : « J’étais décidément un très bon méchant. Ma méchanceté toutefois était d’un genre nouveau. J’étais infect, mais jamais grossier. J’étais une sorte de canaille aristocratique. (…) J’étais le type de traître qui déteste avoir une tache de sang sur ses vêtements ; pas tant parce que je redoutais d’être découvert que parce que j’aimais avoir l’air propre sur moi. »
L’homme naît à Saint-Pétersbourg, « dans un monde appelé à disparaître », au sein d’une famille de la haute société, d’origine anglo-écossaise ou, selon certains, dont son traducteur Romain Slocombe, fils naturel d’un prince proche de la famille impériale - ce qui est autrement plus romanesque. Maison à Saint-Pétersbourg, résidences d’été en Estonie et en Courlande, fêtes somptueuses - le jeune Georges fait alors partie des privilégiés, ses parents fréquentant la Cour. En 1917, dès les premiers troubles, Georges est envoyé en Angleterre au même moment où Lénine, une autre canaille, prolétarienne celle-là, débarque en Russie, avec l’aide des services allemands. Restés là-bas, ses parents échapperont non sans peine à la terreur bolchevique et se réfugieront, ruinés, en Grande-Bretagne. Après des études dans un collège privé, il connaît les boulots sans gloire mais lointains : l’Argentine et la Patagonie des années 20…
Venu un peu par hasard au cinéma par le biais du chant (il est baryton), Sanders va tourner, en Angleterre puis à Holywood, une bonne centaine de films en trente-cinq ans, interprétant tour à tour Vidocq et Landru, Bel-Ami et Gauguin. Dans ces films, il promène une silhouette de dandy cynique très Vieille Europe : d’après lui, il ne joue jamais que son propre rôle ! Ses mémoires fourmillent d’anecdotes drôles sur des tournages, par exemple pour Viaggio in Italia, de Rossellini, avec Ingrid Bergman, où il nous apprend que le réalisateur italien travaillait sans réel scénario et à son rythme, en donnant la priorité à la plongée sous-marine ou aux courses en Ferrari avec les trains italiens !
Marié un temps à la très riche actrice hongroise Zsa Zsa Gabor, il mène une vie de luxe : Cannes au Carlton, etc. Sa vision du monde tranche par sa totale lucidité, par exemple quand il décrit les États-Unis des années 50 : « Le principe d’obsolescence, le principe de recherche de motivation et le principe de perception subliminale semblent avoir été inventés seulement pour améliorer des méthodes par lesquelles les gens sont cyniquement induits à s’enchaîner pour payer des choses dont ils n’ont pas besoin avec de l’argent qu’ils n’ont pas. »
Puis vient le déclin, les navets remplacent les grands films, l’argent manque et les affaires plus ou moins douteuses n’arrangent rien. Tout se termine mal, mais avec style, par un suicide dans un palace espagnol. Dans ses poches, un mot en anglais : « Cher monde, je m’en vais parce que je m’ennuie. Je sens que j’ai vécu suffisamment longtemps. Je vous laisse avec vos soucis dans cette charmante fosse d’aisance. Bonne chance. »
Christopher Gérard
Georges Sanders, Profession fripouille, Mémoires, traduction & épilogue Romain Slocombe, Editions Séguier, 276 pages, 20€

16 mars 2021
Sur Claude Sautet
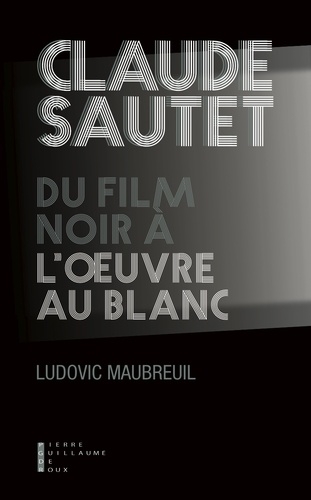
Né en 1968, Ludovic Maubreuil est un cinéphile passionné à l’immense culture, résolument à contre-courant, comme le montre son site http://cinematique.blogspirit.com/.
Pour lui, la cinéphilie est une servante de la philosophie, à rebours de l’actuelle doxa qui réduit le cinéma à un jeu gratuit. Pour Maubreuil, les salles obscures (pour ne rien dire des omniprésentes séries) sont devenues autant de cavernes au sens platonicien : des dortoirs pour consommateurs fourbus.
Dans Cinématique des muses, il présentait une étrange galerie de vingt-et-un portraits de muses ou d’initiatrices, parmi lesquelles Mimsy Farmer et cette fascinante allégorie de la Mort, Cathy Rosier, l’inoubliable pianiste du Samouraï.
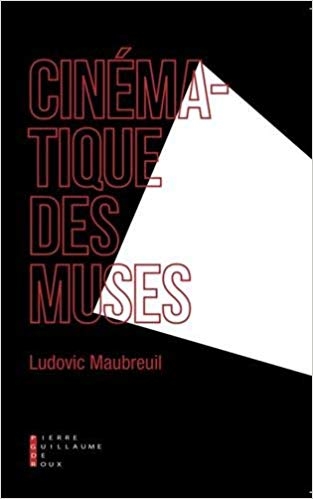
Aujourd’hui, il réhabilite Claude Sautet (1924-2000), un réalisateur attachant quelque peu sous-évalué par la critique et dont il montre bien l’aptitude à mettre un univers en forme. Le titre de son passionnant essai, Claude Sautet. Du Film noir à l’œuvre au blanc, fait référence au Grand Œuvre alchimique et à son symbolisme au sens jungien. Séparation du subtil et de l’épais, stade de purification sous l’égide de la Lune, l’œuvre au blanc est la deuxième étape, juste après l’œuvre au noir, qu’elle poursuit dans le sens d’un accroissement de la conscience de soi. Ludovic Maubreuil se penche ainsi sur le riche symbolisme chromatique des films de Sautet, qui, manifestement, comme tous les maîtres authentiques, ne laissait rien au hasard. Neurologue de formation, Ludovic Maubreuil revisite tous ces grands films que furent Les Choses de la vie, avec les inoubliables Michel Piccoli et Romy Schneider, César et Rosalie, sans oublier les premiers, Classe tous risques, avec l’immense Lino Ventura.

Personnages, situations, récurrences (comme le trio amoureux, la tabagie ou le rôle de l’argent), mais aussi dialogues et plans traduisent la profondeur et la subtilité de ce cinéaste. Le regretté Jean Parvulesco avait, dans son étrange roman Les Mystères de la Villa Atlantis, où le cinéaste apparaît aux côtés de Bulle Ogier ou de Dominique Sanda, souligné « l’irrémédiable, la vertigineuse et si belle tristesse du cinéma de Sautet ». L’homme n’avait en effet pas son pareil pour mettre en images la dissonance moderne, la poignante solitude de nos contemporains. Magnifiquement joués, ses couples incarnent cette déréliction d’enfants mécontents et gavés, qui fut le propre d’une époque : « Le cinéma de Sautet, c’est la tragédie de l’homme séparé, dont les déboires professionnels ou sentimentaux ne sont finalement que l’allégorie ».
Comment ne pas être ému par ce livre empli de savoir et de sensibilité, et qui fut parmi les derniers publiés par Pierre-Guillaume de Roux, gentilhomme des lettres ?
Une suggestion ? Que le cher Ludovic Maubreuil nous offre un essai du même niveau sur Jean-Pierre Melville !
Christopher Gérard
Ludovic Maubreuil, Claude Sautet. Du Film noir à l’œuvre au blanc, Pierre-Guillaume de Roux, 226 pages, 18€
Il est question de Ludovic Maubreuil dans Quolibets :
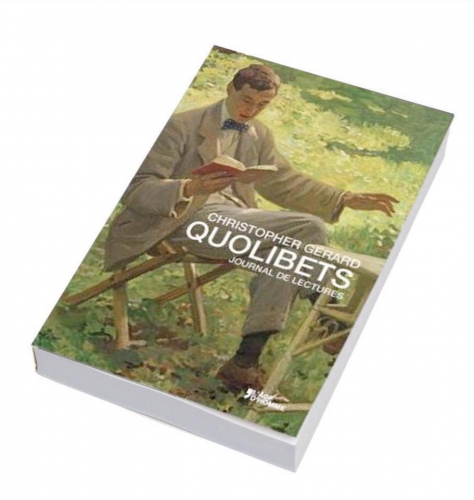
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : cinéma, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23 février 2017
La Morsure des Dieux

Née dans la Drôme en 1976 de parents kabyles qui l’abandonnent immédiatement, Cheyenne-Marie Carron est adoptée par une famille catholique, d’où l’importance dans toute son œuvre du patriotisme français à l’ancienne et de la foi chrétienne, qu’elle défend et illustre avec l’enthousiasme des convertis. Je parle d’œuvre, car, lentement mais sûrement, Cheyenne-Marie Carron trace son sillon dans le monde du cinéma français, univers étique au sein duquel elle tranche par la vigueur de convictions parfois naïves, mais toujours sincères – exprimées, Dieux merci, sans langue de bois. Scénariste, réalisatrice et productrice indépendante, Cheyenne-Marie est au four et au moulin, en authentique femme-orchestre qui n’est pas passée par ces écoles qui exténuent les talents et domestiquent les esprits.
Parmi ses créations, citons L’Apôtre (2014), qui narre la conversion au catholicisme d’un mahométan, film déprogrammé à la demande du Ministère de l’Intérieur à la suite des attentats de 2015.
Passionnée (cette épithète n’a rien de convenu), et pour cause, par le thème de l’identité, qu’elle soit nationale, culturelle ou spirituelle, Cheyenne-Marie s’intéresse depuis quelque temps aux sources païennes de notre imaginaire, à ce soubassement trop souvent occulté. Le résultat de ses méditations s’intitule La Morsure des Dieux ; la cinéaste y développe le thème délicat du conflit entre monothéisme et héritage plurimillénaire, entre paganisme et christianisme. Qu’une catholique, convertie de surcroît, aborde ce sujet épineux (et, disons-le, casse-cou), mérite d'être salué. Le moyen, d’ailleurs, de ne pas saluer cette dame qui clame son amour pour la vieille Europe… et porte très haut La 317ème section de Schoendorffer ?
Tourné près de Bayonne, La Morsure des Dieux met en scène un couple formé de Sébastien (François Pouron, un bloc d’énergie), paysan basque et loyal païen, et Juliette (exquise Fleur Geffrier - qui fera soupirer plus d’un spectateur), aide-soignante pour qui charité n’est pas qu’un mot, mais bien une manière de vivre. Deux êtres entiers, d’une grande beauté physique et surtout intérieure, se heurtent et s’aiment dans ce magnifique Pays basque filmé avec une grâce, une simplicité qui n’empêchent jamais l’intensité. Ce mixte, comme la ferme direction des acteurs, évoque le jeune Eric Rohmer. De sublimes chants traditionnels viennent scander le film qui, en réalité, aborde trois thèmes : l’amour naissant entre deux jeunes gens prédestinés, le conflit entre l’ancienne religion qui revient et les dogmes qui s’effacent, et, sans doute le plus poignant, la mort de la paysannerie.
Je dois en effet faire cette confidence : dans La Morsure des Dieux, la querelle entre paganisme et christianisme est le thème … qui me touche le moins, sans doute en raison du caractère parfois didactique du propos, trop explicatif à mon goût, malgré de belles images, comme ce feu solsticial, ces danses traditionnelles basques et la vision, un peu rapide, d’un bel autel polythéiste dans la chambre du paganus. Les échanges de ce dernier avec son ami le prêtre (en soutane, s’il vous plaît !) comme avec son amie de cœur m’ont paru quelque peu cérébraux. Heureusement, il y a ce dialogue avec le vent et les arbres dans la montagne ; et ces troublantes noces de juin...
En revanche, le portrait de ces paysans acculés au désespoir et qui se battent dos au mur (l’entretien avec le banquier, lui-même fils honteux de paysans ruinés) m’a pris à la gorge, tant la mort de l’ancienne France transparaît dans ce conte des collines basques.
Parmi tous ces films pervers ou niais, au milieu du naufrage subventionné de la création cinématographique, La Morsure des Dieux témoigne du talent d’une artiste courageuse.
Chapeau bas !
Christopher Gérard
La Morsure des Dieux, un film de Cheyenne-Marie Carron.

Pour soutenir l’artiste, qui travaille sans subventions,
commander le film via son site
http://www.cheyennecarron.com/







