24 novembre 2025
Ecrivains de Wallonie ?
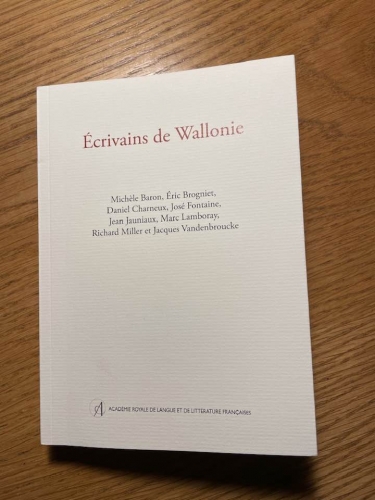
« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » déclarait à juste titre, en avril 2025, Éric Brogniet, poète, éditeur, fondateur de la Maison de la Poésie à Namur. Ce membre de l’Académie royale introduisait en ces termes le colloque consacré aux écrivains de Wallonie, tenu au Palais des Académies, joyau de l’architecture néo-classique et jadis résidence du Prince d’Orange.

Ce colloque, dont les actes viennent de paraître sous l’élégante casaque de l’Académie royale, est singulier à deux titres. D’une part, il met en valeur quelques écrivains dits « régionalistes » ou « wallons » du XXème siècle belge, et ce dans le temple de la langue et de la littérature dites « françaises » ; de l’autre, y sont évoqués deux authentiques maudits des Lettres belges, occultés depuis des années.
Éric Brogniet commence par retracer les étapes du mouvement wallon, qui apparaît comme inspiré de son homologue flamand, antérieur et d’une autre cohérence (le mouvement wallon oscillant pour sa part entre velléités d’autonomie et rattachement à la grande France). Si le nationalisme flamand, d’esprit néo-romantique (fondé sur l’inepte sophisme « La langue est tout le peuple ») et devant beaucoup à l’aide tout sauf désintéressée du Reich (deuxième et troisième du nom), peut être vu comme un sous-produit de l’état unitaire belge, le nationalisme wallon apparaît lui comme un sous-produit… de ce même nationalisme nordiste°.
Se pose la question de l’identité, belge, wallonne, « française » de notre littérature francophone. Pour ma part, je pense depuis longtemps qu’il conviendrait de parler non de communauté française de Belgique, mais bien de Belgique romande, comme il existe une Belgique flamande et une allemande. Les écrivains de langue française de ce pays sont-ils « wallons » ? « Français » ? Pourquoi pas « romands » ? Vaste problème.
Le colloque évoque des auteurs tels que Thierry Haumont, Hubert Krains ou Jean Tousseul. Particulièrement intéressante est la contribution consacrée à une série d’écrivains ardennais (et non wallons ?) un peu oubliés, qui transmettent une vision panthéiste de l’Ardenne.
Les deux contributions les plus sensibles traitent de deux maudits, Constant Malva et Pierre Hubermont, deux écrivains majeurs du courant prolétarien, salués par A. Barbusse et H. Poulaille, membres un temps du Parti communiste (belge) puis passés, qui au trotskisme, qui au socialisme révolutionnaire. Tous deux provenaient du milieu ouvrier du Borinage ; tous deux connurent le travail dans la mine, dès l’adolescence.

Ces deux autodidactes, relativement peu scolarisés, ignorés par les grandes maisons d’édition, ont livré des témoignages parfois bouleversants sur la vie des mineurs et de leur famille. Ma Nuit au jour le jour (manuscrit refusé quinze ans durant par des éditeurs) ou Histoire de ma mère, de Constant Malva, Treize hommes dans la mine, de Pierre Hubermont sont des livres forts et qui resteront. Leur vision du mineur, et du prolétaire en général, ne donne jamais dans le romantisme niais de la littérature engagée – d’où sa puissance d’évocation.

Constant Malva
Sous l’Occupation, ces deux écrivains de sensibilité antifasciste, et même surréaliste pour Malva, basculent, sans doute en raison de leur pacifisme et d’une ahurissante naïveté. Malva, qui crevait de faim, accepte des causeries à la radio, quelques articles. Hubermont, lui, s’engage davantage dans la presse sous contrôle allemand et même dans la Communauté Culturelle Wallonne – une opération des services du Reich en vue de la fragmentation du royaume. Crime suprême, Hubermont, l’ancien communiste horrifié par ce qu’il avait vu de l’URSS de Staline (il participa à une conférence d’écrivains révolutionnaires à Kharkov en 1930), se rendit à Katyn pour témoigner du massacre d’officiers polonais par les bolcheviques. Sa brochure Ce que j’ai vu à Katyn ne lui fut jamais pardonnée.

Pierre Hubermont
A la lecture des pages pondérées et bien informées sur ces deux destins brisés, je me suis souvenu des conversations que j’eus naguère avec le regretté Jean-Pierre Canon, anarchiste et pacifiste pur sucre (un pacifiste dénommé Canon !) qui, dans sa merveilleuse librairie La Borgne Agasse, proposait un rayon très complet sur la littérature prolétarienne, grande oubliée de notre histoire littéraire, que l’Académie sort aujourd’hui d’un injuste oubli.
Christopher Gérard
Éric Brogniet dir., Écrivains de Wallonie, Académie royale, 202 pages, 19€
° Une bourde de taille dans la présentation d’E. Brogniet, qui confond, page 39, deux mouvements flamands, le VNV et le Verdinaso et fait de Joris Van Severen, un « indépendantiste et membre de la SS flamande ». Le pauvre Van Severen, qui était plus grand-néerlandais que flamingant, qui s’était converti en 1938 à la défense du royaume, avait été assassiné de manière ignominieuse par des soldats français à Abbeville en mai 1940.
Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







