21 juillet 2022
Fry's Ties
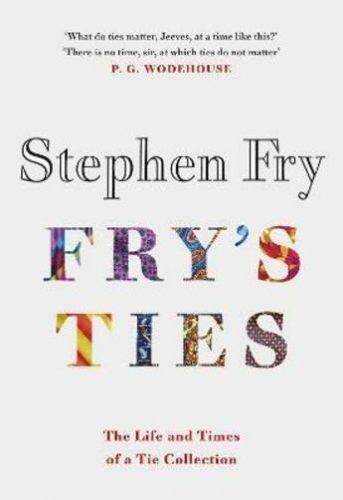
L’un de mes plus vifs plaisirs, lors de chacun de mes passages à Londres, est de m’attarder chez Hatchard's, 187 Picadilly, libraires depuis 1797 et fournisseurs de la Cour (by Appointment to Her Majesty the Queen, to H.R.H. the Duke of Edinburgh and to H.R.H. the Prince of Wales).

Nous sommes à deux pas des merveilles de Jermyn street, de Wilton’s, le plus ancien restaurant de Londres (since 1742) et de Burlington Arcade - une sorte de triangle d’or, ou disons de Saint des Saints, pour les anglomanes.
Quatre étages de livres où se perdre dans une parfaite quiétude, un personnel attentif, des tapis moelleux, et cette excellente idée de proposer aux visiteurs des signed copies de nouveautés choisies - j’ai ainsi pu m’offrir deux romans de John le Carré signés, et Fry’s Ties, de Stephen Fry (1957), célébrissime acteur britannique (hilarant aux côtés de Hugh Laurie ou de Rowan Atkinson), écrivain et homme de radio. Ce volume a attiré mon attention grâce à la citation de P.G. Wodehouse sur sa couverture : « What do ties matter, Jeeves, at a time like this ? There is no time, sir, at which ties do not matter. » Pour un amateur de cravates tel que votre serviteur, la citation a comme un goût de signe de ralliement, à rebours du débraillé de rigueur.

La cravate a en effet mauvaise presse, vue comme un instrument de torture, ce qu’elle n’est pas (une cravate ne « serre » jamais le cou de celui qui la porte, c’est la chemise qui, dans ce cas, n’est pas ou plus à la bonne mesure. Il suffit de passer à la taille supérieure de la chemise … ou, plus héroïquement, de faire un régime), ou encore comme le symbole d’une masculinité, évidemment toxique, et donc honnie par puritaines & pisse-vinaigres.
Il est vrai que la cravate symbolise à la fois un code, une autorité, en un mot une verticalité à laquelle notre époque furieusement égalitaire semble de plus en plus allergique. Le meurtre du Père, la haine de toute autorité, l’obligation implicite de ne jamais sortir du rang sont devenus des dogmes qui ne se discutent plus sous peine de vertueuse exclusion. Exit la cravate, condamnée comme les guêtres ou la chaise à porteurs ? Voire.
L’amusant livre de Stephen Fry constitue une magnifique et souvent spirituelle défense à la fois du goût et de la forme comme manières de résister à l’indifférenciation moralisatrice.
Tout jeune, Fry se montrait déjà réfractaire à l’esprit de son temps, à l’époque pré-punk des 70 : à quinze ans, ne possédait-il pas déjà quarante cravates ? Qui dit mieux ? Ne se vantait-il pas de ne porter que des vêtements de l’époque de son grand-père ? Ne poussait-il pas la provocation à ne fumer que des Balkan Sobranie, à ne lire que des auteurs du passé : Waugh, Kipling et Wilde ? Sacré Fry !

Son livre, celui d’un dandy qui ne se prend aucunement au sérieux, est illustré de clichés et présente des cravates de sa collection personnelle, chacune devenant le prétexte à des évocations souvent drôles, à des réflexions parfois mélancoliques sur le temps qui passe, sur le style et l’art de vivre. En filigrane, belle et lucide critique de ce qu’il appelle justement The Great Disruption - « What was respectable yesterday is repressive and despicable today ».
Nous le suivons de Jermyn street, la rue des chemisiers londoniens, à Madison Avenue, de Milan à Melbourne. Jeu avec la mémoire, exercice pratique d’élégance, Fry’s Ties se lit d’une traite, crayon à la main. Page après page, l’auteur partage avec nous sa passion pour les belles soies tissées ou imprimées, pour le toucher d’une cravate ; chaque cravate lui évoque un épisode de sa vie, de son admission au Garrick Club, le cercle des hommes de théâtre, à deux pas de Covent Garden (cravate salmon and cucumber) à celle du Marylebone Cricket Club (cravate eggs and bacon), le très sélectif club des amateurs de ce sport incompréhensible. Fry nous explique le principe des stripes, ces rayures de couleur qui constituent le signe codé d’une appartenance à un régiment, un club ou un collège (Eton : fond bleu de Prusse et fines rayures bleues), voire une entreprise. Les British reps ties ont ceci de particulier que les rayures, les stripes, descendent de l’épaule gauche, du cœur, à la main droite - l’inverse trahissant, horresco referens, une cravate américaine.
Fry semble chez lui dans les plus grandes maisons, de Turnbull & Asser, qui fournit en son temps Kim Philby et James Bond. Au sous-sol de ce magasin, on peut encore voir, parmi de sublimes pyjamas, le siren suit taillé sur mesure pour Churchill pendant le Blitz (d’où l’allusion aux sirènes d’alarme) : une sorte de salopette en velours, pratique pour travailler au War Cabinet tout en fumant le cigare. Il évoque aussi, parmi bien d’autres, New & Lingwood, fournisseurs officiels d’Eton College depuis 1865, une autre adresse dont je pousse la porte à chacune de mes visites dans la Burlington Arcade, juste en face de la statue en bronze de Brummel : j’y ai acquis, moi qui ne fume que quatre cigares par an, un smoking hat en velours, une sorte de fez ou de tarbouche, orientalissime et d’un chic absolu, pour lire et relire John le Carré.

L’éloge que fait Stephen Fry de Brooks Brothers (established 1818) m’a transporté d’enthousiasme : ah, ces nœuds papillons ! Comment ne pas se désoler davantage de la fermeture du somptueux magasin londonien de Regent street, remplacé par un entrepôt à fripes pour adolescents attardés ?
D’autres évocations m’ont en revanche laissé de marbre : telle ou telle cravate psychédélique, ornée de pandas ou de grenouilles… Mais une touche de mauvais goût, calculée avec minutie autant qu’assumée avec assurance, ne relève-t-elle pas, parfois, d’une forme d’élégance, en tout cas d’une sorte de courage suprêmement British ?
Bref, une promenade pleine d’humour et de charme qui plaira aux esthètes et à tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans certaine grisaille obligatoire.
Christopher Gérard
Stephen Fry, Fry’s Ties. The Life and Times of a Tie Collection, Michael Joseph, 256 pages, 14.99£

Lire aussi :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2020/12/28/le-chouan-des-villes-6287020.html
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18 juillet 2022
L’ultime roman de John le Carré

Nombreux sont ceux, je l’ai dit naguère, qui ne comprennent pas que John le Carré (1931-2020) n’ait jamais eu le Nobel de littérature, tant son oeuvre, traduite dans maintes langues, a changé du tout au tout le roman d’espionnage et radiographié cette Angleterre impériale « en chute libre », celle de M. Johnson e.a., qui l’exaspérait au point de lui faire prendre, juste avant de mourir, la nationalité irlandaise.
L’ancien professeur à Eton devenu cold warrior à Berne, Hambourg et Berlin, l’agent des prestigieux MI 5 (sécurité intérieure) et MI 6 (documentation extérieure) s’est révélé comme l’un des auteurs majeurs de la littérature contemporaine.
C’est donc avec une réelle tristesse que j’ai lu, sans même attendre la traduction française, prévue en octobre au Seuil, Silverview, son ultime roman, paru moins d’un an après sa mort. Le titre lui-même traduit bien le caractère énigmatique du récit, tout en allusions et en demi-teintes, qui, sans être un chef-d’œuvre stricto sensu, nous laisse ce que, dans sa postface, le fils de l’écrivain, Nick Cornwell (lui aussi auteur), appelle justement « a song of experience ». Dès les premières pages, le lecteur est pris dans les filets de son « agent traitant », qui le manipule avec maestria.

Comme toujours chez le Carré, les grandes figures sont réussies : Proctor, officiellement diplomate du Foreign Office et en réalité officier supérieur du Secret Intelligence Service, naguère chef de station à Buenos Aires du temps de la Guerre des Falklands, aujourd’hui chargé de tirer au clair une trouble affaire de fuites dans un réseau hyper-sécurisé où communique la crème des services anglo-américains. Proctor provient d’une famille de la gentry, mais attention libérale - pas tory pour un shilling - qui a compté quelques figures d’espions dans le Lisbonne de la guerre, chez les décodeurs de Bletchley Park et même dans l’Albanie des années 50.
Aux antipodes de l’espion désabusé qui fait bien entendu songer à Smiley, Julian - « a great Roman emperor » -, jeune trader de la City reconverti pour des raisons inconnues en libraire dans une station balnéaire de l’East Anglia avec ses plages 1900. Le roman commence d’ailleurs dans cette librairie déserte, où débarque, revêtu d’un imper râpé et coiffé d’un Homburg démodé, un ami de son défunt père, Edward, parfois prononcé Edvard, émigré polonais, ex-professeur de théologie marxiste à La Havane, Zagreb et Gdansk, fils d’un fasciste polonais fusillé à la Libération, ci-devant agent des services britanniques. En quelques pages, toute l’atmosphère du récit est campée avec ce ton et ce génie du dialogue propres à le Carré. Nous apprenons au fil du récit qu’Edvard a été connu par le Service sous le pseudo de Florian, agent aussi providentiel - excellent rendement - que portant malheur à ceux qui l’approchent de trop près, comme cette famille jordanienne, active dans une ONG saoudienne en Bosnie et qui sera victime d’une bavure. Edvard-Florian se trouvait en effet en mission dans le coin, recrutant à tour de bras sous identité allemande dans les Balkans en feu. Ses bons contacts avec un colonel serbe (les inévitables méchants du récit) lui permettent de sauver la belle Salma, mais ni son mari ni son fils. Dévasté par cette tuerie dont il est peut-être responsable, Florian se réfugie en Angleterre, à Silverview, le manoir de sa future femme, Deborah, qui se trouve être analyste en chef du Service pour le Moyen Orient. Le Carré signale incidemment que Silverview est la traduction anglaise de Silberblick, le nom de la maison occupée à Weimar par Nietzsche et sa sœur pendant les dernières années de la vie du philosophe. N’en révélons pas davantage.
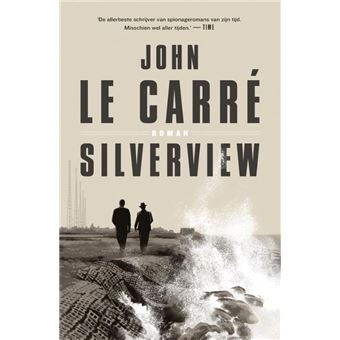
Nous retrouvons dans ce roman testament de le Carré nombre de ses obsessions : la figure d’un père indigne (ici, ils sont deux), l’analyse du traître en tant qu’archétype humain, l’exaspération face à la vassalisation d’une Grande-Bretagne rêvant à sa grandeur disparue, la virulente critique de la politique américaine (« America’s determination to manage the Middle East at all costs, its habits of launching a new war every time it needs to deal with the effects of the last one » et, à méditer en ces temps de propagandes éhontées, « NATO as a leftover Cold War relic doing more harm than good »). Enfin, cette vision grinçante de services secrets finalement peu efficaces, taraudés par le doute comme par l’arrivisme.
Quel talent, tudieu ! Comment ne pas rêver au roman que lui aurait inspiré cette atroce guerre d’Ukraine ?
Christopher Gérard
John le Carré, Silverview, Penguin Books, 256 pages, 8,99£
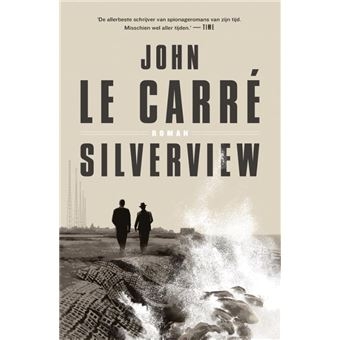
Lire aussi mon hommage du 14 décembre 2020 :
http://archaion.hautetfort.com/archive/2020/12/14/exit-john-le-carre-6284184.html
Il est question de John le Carré dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







