17 juin 2014
Un maître du Witz : Bernard du Boucheron

Enarque, ancien haut responsable dans l’industrie aéronautique, Bernard du Boucheron a décroché à 76 ans le Grand Prix du roman de l’Académie française avec Court Serpent, son premier roman - style au couteau et cruel raffinement. Six romans tout aussi pessimistes, publiés chez Gallimard, ont confirmé qu’il s’agissait d’un écrivain de haut parage et à rebours des modes. Voilà que, pour son huitième roman, il change d’éditeurtant il semble que Le Cauchemar de Winston ait effarouché la grande maison. Il est vrai que, dans le genre - difficile - de l’utopie mal-pensante, Boucheron atteint un sommet.
Mai 1941, Hitler, alias le Conducteur, échappant aux manœuvres de son médecin (zigouillé par la police secrète), retrouve un semblant de lucidité et annule l’opération Barbarossa. C’est le Grand Tournant, quand Ribbentrop et Molotov se partagent le continent (hilarant dialogue entre les deux prédateurs) dans le cadre d’une paix « perpétuelle ». Londres feint de reconnaître la prédominance allemande sur l’Europe en attendant son heure. Quant aux foules grisâtres de France, prises d’une frénésie de dénonciations, elles subissent bon gré mal gré la férule du Maréchal dans un fumet d’ail et de pieds mal lavés, faute de savon : « ce peuple indomptable qui a toujours accepté la servitude si même il ne recherchait pas, ce peuple artiste qui chante faux et a voué un culte à la laideur, cette nation généreuse que ne vit que pour son bas de laine, ces universalistes qui ignorent tout du monde, ces amateurs de grandeur pour qui le mot « petit » est un suprême éloge ». Au nom du Parti, Aragon chante le génie de Staline et d’Hitler, pendant que ses camarades passent en masse au service de la Grande Allemagne, « tant est grand le prestige de la tyrannie dans la patrie de la liberté où l’aplatissement va de pair avec l’insurrection ». Vichy s’installe à Versailles et Laval se suicide ( ?) pour céder la place à l’Ambigu, un avocat pourri d’ambition, ancien élève des Maristes - le genre à se faire limer les canines pour offrir un sourire plus enjôleur. Boucheron se surpasse dans la description de cet ambitieux qui « collabore sans ardeur et résiste sans conflits ». Avec Speer, l’Ambigu, que ses affidés surnomment Tonton, va négocier la Paix de Pantin, qui fait de la France, où renaissent des cultes naturistes, un modèle de décroissance. En 1951, rose à la main, l’Ambigu accueille la dépouille du Maréchal au Panthéon. Le même reçoit le Conducteur à Paris, sur la tombe du Soldat inconnu. Débarrassé d’une SS décidément encombrante, le Conducteur, dont Boucheron imagine une interview délirante avec un journaliste étrusque (en fait : albanais), prépare son triomphe dans une débauche de grands travaux tandis que la perfide Albion concocte sa terrible revanche. Du grand œuvre, qui laisse pantois.
Christopher Gérard
Bernard du Boucheron, Le Cauchemar de Winston, Editions du Rocher, 190 pages, 17€
PS: B. du Boucheron est l'un des 122 auteurs présentés dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, uchronie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11 juin 2014
Ghislain de Diesbach, un gentilhomme de notre temps
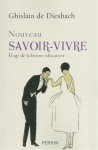
De nos jours, la politesse passe pour ringarde, pour ne pas dire suspecte, car, comme le souligne Ghislain de Diesbach dans cet essai bienvenu, « faite d’interdictions destinées à discipliner chez l’homme sa sauvagerie primitive ». Que cèdent les barrières et les barbares déferlent : Diesbach cite le voussoiement, tout en distances et en délicatesse, interdit par les sans-culottes au profit du brutal tutoiement « citoyen », qui mène droit à la guillotine. Et comme au recul de la civilisation s’ajoute un infantilisme triomphant (exemple : trois couples de trentenaires flasques avec moutards invertébrés au restaurant), comment ne pas le suivre pour réhabiliter le savoir-vivre, justement qualifié de « chef-d’œuvre en péril » ?
Avec autant d’esprit que d’humour, Diesbach précise que ce qui caractérise l’homme du monde, c’est que lui, au moins, sait qu’il est mal élevé… Hautement instructif, tout le livre est truffé d’anecdotes souvent hilarantes (comme gaffe célèbre, il cite celle de ce sommelier qui, servant du champagne au Grand-duc Wladimir, lui chuchote à l’oreille : « Brut impérial 1893 »), puisées chez quelques grands noms du monde comme Pringué et Boni de Castellane ou tout simplement dans la vaste mémoire de l’auteur.
On y apprend une foule de choses inutiles, ô combien importantes : toujours offrir un nombre impair de fleurs, ne jamais balbutier le piteux « enchanté » lorsqu’on est présenté, manger le poisson avec deux fourchettes, saluer une altesse (vraie ou fausse), ne pas galvauder le baisemain, voussoyer (« une espèce d’élégance qui préserve de la vulgarité, une certaine douceur aussi, une bonne grâce teintée de pudeur »), et, en cas de naufrage, « se retenir de taper à coups d’avirons sur les malheureux qui s’accrochent à la chaloupe ». Même la poignée de mains inspire une sorte de retenue à Diesbach, qui lui préfère « la courbette militaire et un peu mécanique des Allemands, la froideur anglo-saxonne », car plus hygiéniques… depuis que plus personne ne porte de gants. Il aurait pu citer Barbey : « beaucoup d’amis, beaucoup de gants, de peur de la gale ». Ma joie à la lecture de ses lignes assassines sur le téléphone portatif, celui-là même que triturent tant de ploucs d’un pouce graisseux, même à table : « ne devrait être délivré que sur ordonnance » !
Rédigé dans un français ferme et clair, ce Nouveau savoir-vivre charme par son humour antimoderne non dénué d’un zeste de cynisme, celui des civilisations accomplies… même si, in fine, le diplodocus réactionnaire baisse le masque : le comte de Diesbach apparaît avant tout comme un esthète qui, par élégance morale, sait qu’il lui revient, comme à tout homme du monde qui se respecte, de faire oublier leur défaite aux vaincus de l’existence.
Christopher Gérard
Ghislain de Diesbach, Le Nouveau savoir-vivre. Eloge de la bonne éducation, Perrin, 270 p., 21€
*
Rencontre avec Ghislain de Diesbach
Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,
aux éditions L’Age d’Homme
http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0
Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Pourrait-on vous qualifier de « gentilhomme de notre temps »?
Qui suis-je ? Je me suis souvent posé la question sans jamais pouvoir la résoudre, ayant découvert en moi trop d’éléments contradictoires pour me reconnaître une personnalité coulée d’une seule pièce, comme ces statues qui ornent les tombeaux ou les places. J’aime à dire que je suis né sous le Second Empire et j’en ai toujours aimé le régime, ainsi que les souverains, pensant comme La Varende que Napoléon III a été le dernier roi de France. Ayant dans mes veines le sang des colonels-propriétaires du Régiment de Diesbach au service de France, et aussi celui du fondateur de la Compagnie des Indes d’Ostende, ainsi que de l’inventeur, pendant le blocus continental, du procédé pour blanchir le sucre de betterave et le commercialiser, je me sens tour à tour militaire ou manufacturier, en regrettant de n’avoir pas été armateur ou planteur. Je ne dirais donc pas que je ne me sens pas gentilhomme au sens que l’on donnait sous l’Ancien Régime à ce mot, détestant d’ailleurs le préfixe gentil, qui dit faible, et préférant le terme de « patricien » ainsi qu’on l’entendait jadis à Rome et même à Londres ou Hambourg au XVIII° siècle, ce qui permet de concilier le commerce des denrées commerciales avec celui des beaux esprits.
Quelles ont été les grandes lectures, celles qui vous ont marqué pour la vie?
Dans mon enfance, Jules Verne, chantre de l’apogée de la civilisation européenne au XIX° siècle et la comtesse de Ségur, parfait manuel de bonne éducation, puis dès mon adolescence, Maupassant, Balzac, mais surtout les auteurs anglais des XVIII° siècle et XIX° siècle, avant de passer un peu plus tard à Virginia Woolf et aux écrivains de ce que l’on appelait alors le groupe de Bloomsbury.
Et les grandes rencontres ?
Le goût des livres m’a donné celui de leurs auteurs et ce fut ainsi que dans ma prime jeunesse je suis allé voir Ferdinand Bac, le dernier témoin du Second Empire, La Varende, puis Jean Giono, me trouvant par hasard près de chez lui, et enfin Marguerite Yourcenar dont les Mémoires d’Hadrien m’avaient enthousiasmé, me faisant aimer soudain tout ce qui m’avait tant ennuyé jadis pendant mes études. Une fois à Paris, j’ai connu beaucoup d’écrivains, dont Julien Green, le plus remarquable, mais la liste, là, serait trop longue…
Outre des ouvrages d’histoire (par exemple une Histoire de l’Emigration, que l’on réédite ces jours-ci), vous avez publié, chez Perrin, des biographies d’écrivains très remarquées : Madame de Staël, Proust, Chateaubriand, Le tour de Jules Verne en quatre-vingt livres. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé ces choix et ce que chacun de ces auteurs vous a apporté ?
Mes biographies d’écrivains, comme Madame de Staël, Proust, Chateaubriand, sont en général le fruit du hasard, voire d’une opportunité, mais il existe malgré tout un fil conducteur. Ayant par goût personnel voulu écrire une Histoire de l’Emigration, j’ai été frappé en lisant Souvenirs et Mémoires sur la fin du XVIII° siècle de l’âpreté des jugement sur Necker, véritablement jeté en pâture aux chiens après avoir été considéré pendant des années comme le sauveur de la France. Ainsi l’idée m’est-elle venue de le réhabiliter, puis, en travaillant à sa biographie, j’ai trouvé que sa fille Germaine de Staël était un personnage infiniment plus haut en couleur et intéressant. Je suis donc passé du père à la fille, et en préparant mon livre sur celle-ci j’ai amassé une documentation qui pouvait me servir également sur Chateaubriand, qui fut comme elle un grand opposant à Napoléon.
Dans ces deux écrivains, surtout Madame de Staël, j’ai admiré le goût des formules, les réflexions politiques, et j’en notais au passage avec l’idée que cela pouvait servir pour un autre livre, un ouvrage de morale politique par exemple. En revanche, j’ai fait d’autres livres pour le seul plaisir de témoigner ma reconnaissance à des auteurs qui avaient enchanté ma jeunesse, comme Jules Verne, dont j’ai analysé l’œuvre dans Le Tour de Jules verne en quatre-vingts livres, la comtesse de Ségur, dont l’œuvre, une fois décryptée, la montre, ainsi que Jules Verne, assez différente de l’image traditionnelle et enfin Ferdinand Bac, le premier à encourager ma vocation de mémorialiste et d’historien.
Vous publiez à Versailles un Petit dictionnaire des idées mal reçues, dans l’esprit de Rivarol, mais aussi de Proudhon, que vous citez: « j’ai pris la plume pour la servir – la liberté – et je n’aurai servi qu’à hâter la servitude générale et la confusion ». Quelle en est la genèse ?
Le Petit dictionnaire des idées mal reçues a été composé d’une toute autre façon et au hasard des lectures, des rencontres, des observations faites pendant ma vie professionnelle et parfois de propos entendus dans un restaurant ou pendant une soirée mondaine. En vérité, je dirais qu’il s’est fait tout seul, sans plan préconçu, ce qui explique l’ordre alphabétique. Ayant toujours détesté la bêtise, j’avais été consterné en lisant le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, brave homme et petit esprit, ainsi que le montra d’ailleurs dans ses Souvenirs son ami Maxime du Camp, un auteur méconnu, lui.
Ce déclin que vous fustigez avec panache, pensez-vous que certains livres l’aient annoncé, voire précipité ? A contrario, certains titres, du passé comme du présent, vous semblent-ils de parfaits antidotes ?
Le déclin que je stigmatise a, je le crains, toujours existé, depuis Louis XIV, je pense, et la seule chose qui a changé c’est l’accélération de l’Histoire. Avec le progrès technique, et la diffusion de plus en plus rapide, « en temps réel », des idées, surtout les mauvaises, l’homme d’aujourd’hui voit un pays se défaire ou se dissoudre alors qu’au XIX° siècle seuls des esprits pénétrants, comme Tocqueville ou Custine, voire Edmond de Goncourt, apercevaient les fissures et prophétisaient la ruine un jour de l’édifice. En ce qui concerne la France, il y eut dès l’aube du XX° siècle des écrivains comme Barrès qui sonnèrent le glas de la civilisation occidentale. Entre les deux guerres, dans les années 30, bien des écrivains publièrent des livres sur ce que l’un d’eux, un Anglais, appelait « Le suicide de la Vieille Europe ». Aucun de ces livres n’a eu malheureusement d’influence sur le cours des événements ; ils sont lus la plupart du temps par des esprits déjà convaincus, dont ils justifient les craintes ou les théories, mais demeurent sans effet sur « les masses » auxquelles reste en fin de compte le dernier mot, puisque ce sont elles qui votent.
Vous fûtes l’ami et le biographe de Philippe Jullian, « un esthète aux Enfers ». Vous avez aussi évoqué la princesse Bibesco. Ce monde des salons littéraires a-t-il disparu à jamais ? Si oui, quand et pourquoi ?
Le monde ancien, d’avant la Grande Guerre, a survécu d’une certaine manière jusqu’à mai 1968, car il y avait encore à Paris, dans ce qu’il est convenu d’appeler « le monde », des hôtesses tenant salon, des femmes aimant à réunir autour d’elles, sinon les meilleurs esprits, parfois récalcitrants, du moins des gens à la mode, ceux dont on parlait. Il y avait le salon académique de la duchesse de la Rochefoucauld, de sa belle-sœur, la comtesse de Fels, le salon musical de Mme Tézenas et d’autres encore où l’on voyait, devenus vieux, voire cacochymes, des jeunes gens qui avaient hanté jadis les salons décrits, sinon fréquentés, par Marcel Proust. Marthe Bibesco était une survivante de cette époque et l’avait bien connue ; elle l’avait aussi jugée à sa juste valeur et en a laissé une peinture exacte dans son roman le moins connu : Egalité. Philippe Jullian, lui aussi, a connu les vestiges de cette société, devenue d’ailleurs une sorte de Café-Society suivant le titre d’un de ses romans, et l’a cruellement caricaturée dans ses albums, comme dans l’illustration de certains de ses livres.
On se moquait alors, dans la fin des années 60, de ces dames assoiffées de gloire, aimant recevoir pour le plaisir d’être citées dans les chroniques mondaines, confondant leurs invités, prenant un peintre pour un écrivain, assurant à un cinéaste en vogue qu’elles se délectaient de son dernier roman, mais elles avaient du bon, car leurs salons étaient des endroits agréables où se retrouver, faire de nouvelles connaissances et faire aussi de l’esprit.
Les derniers salons ont fermé, car personne aujourd’hui n’a suffisamment de fortune pour avoir un hôtel particulier et y tenir table ouverte, ainsi que le faisait Marie-Laure de Noailles, ou un hôtel tout court, comme le Meurice où recevait chaque semaine Florence Gould. L’impôt sur le revenu, puis l’impôt sur la fortune et l’impôt sur l’impôt que représente la Contribution sociale généralisée, aboutiront progressivement à la disparition des patrimoines. Ainsi que je l’écris dans mon Petit dictionnaire des idées mal reçues, il n’y a pas en France égalité des citoyens devant l’impôt, mais égalisation des fortunes par l’impôt. Les cafés littéraires n’ont plus leur clientèle d’autrefois. La vague démocratique a tout englouti.
Vos projets ?
Dans un monde aussi démocratisé, où chaque citoyen est de plus en plus « conditionné », numéroté, en attendant d’être soviétisé par le biais trompeur du capitalisme international, comment faire des projets, sinon celui de « résister » ?
Paris, le 9 novembre 2007
Propos recueillis par Christopher Gérard.
La Presse littéraire XII, déc. 2007 – janvier 2008.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, savoir-vivre, aristocratie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05 juin 2014
Roland Laudenbach ou l’insolence

« Un esprit fort qui n’autorise pas les habiles à calomnier l’honneur et les barbares à offenser la civilisation »
Pol Vandromme
Mea maxima culpa, je confesse que, au début des merveilleuses années 80 (Mitterand, Reagan & Jean-Paul II), j’étais un étudiant dissipé, qui passait beaucoup plus de temps chez les bouquinistes que dans les amphithéâtres de mon Alma Mater. Il est vrai que, au cours de « grands courants de la philosophie », nous devions subir l’indigeste charabia d’un ancien secrétaire de Sartre, qui eut l’unique mérite - involontaire - de me vacciner à tout jamais contre l’imposture aux mille faces.
Je préférais flâner dans diverses librairies, dont Bruxelles était riche alors et où, du premier coup d’œil, je repérais la casaque blanche et vermillon ornée du mythique LTR dessiné par le peintre Salvat. De mes promenades je ramenais dans ma soupente des trésors intitulés Le Songe de l’Empereur, Minutes d’un libertin, Au large du siècle, sans oublier L’Histoire égoïste - les mémoires de Jacques Laurent, auteur d’un pamphlet, Paul et Jean-Paul, que je ne lus que bien plus tard. Je faisais alors connaissance avec Pol Vandromme et Michel Déon, Gabriel Matzneff et Willy de Spens. Ma joie quand je découvris, sur une étagère haut-perchée, un exemplaire intact du Drieu parmi nous de Jean Mabire.
Gavé de scolastique sartrienne à l’Université, je prenais en quelque sorte le maquis – un maquis blanc dont le commandant en chef, lointain, quasi mythique, se nommait Roland Laudenbach, alias Michel Braspart. Dans le joli Cahier que LTR publia en 1974 pour ses trente ans, j’appris ce qu’il fallait savoir de cet éditeur inflexible, l’ami de Cocteau et de Genet, l’homme qui brava les interdits de la police de la pensée non seulement en éditant des proscrits (dont certain poète madrilène, un temps collaborateur de Valeurs actuelles) et des pestiférés comme Morand et Giono, victimes de la vindicte des nouveaux puritains - les amis de Sartre & consorts. J’aimais que Vandromme exaltât chez Laudenbach ce sens de l’amitié : « une amitié sur un mode divinatoire et quasi initiatique » et que l’éditeur en personne, qui fut aussi romancier et scénariste, évoquât « l’amitié qui excuse tout, qui s’exprime soit par fou rire, soit par silence et autorise une connivence aux codes secrets ».
Une « connivence aux codes secrets » : quel plus beau programme pour un jeune rebelle de vingt ans et des poussières, en bisbille contre son époque et qui se cherchait des aînés qui ne fussent pas des pions ?
Cette connivence, je l’ai connue, non avec Laudenbach, disparu en 1991 et que je ne rencontrai jamais (même si, dès la fin de mon service militaire, j’avais écrit 40 rue du Bac pour y solliciter un emploi), mais avec Dimitri, le fondateur de L’Age d’Homme, dans divers lieux conspiratifs tels que la cave de la rue Férou, le Café de la Mairie ou son stand de la Foire du Livre.
J’aimais, et continue d’aimer à la folie ce côté hidalgo, intraitable sur les valeurs, sauvage même, et, je le confesse, ce parfum de conspiration. Cette générosité, dont Gabriel Matzneff témoigne dans L’Archange aux pieds fourchus, et je ne sais plus qui, qui disait les larmes de Laudenbach à l’annonce du Prix Goncourt décerné à Jacques Laurent pour Les Bêtises… publiées chez Grasset. De même, j’aimais que Laudenbach témoignât pour son confrère Lindon, des éditions de Minuit (celui-ci lui rendit la pareille lors d’un procès pour offenses au chef de l’état).
Et quel catalogue ! Gripari et Mourlet, Volkoff et Sérant, Héduy et Schoendorffer, Anouilh et Dominique de Roux… Un feu d’artifice. Les libertins du siècle, dont nous sommes aujourd’hui les orphelins.
Christopher Gérard
Publié dans le numéro 14 de Livr'Arbitres, revue littéraire non conformiste http://livr-arbitres.com/
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04 juin 2014
Avec Guy Féquant

Vingt ans ! Cela fait vingt ans que les livres de Guy Féquant occupent une place de choix dans ma bibliothèque. Lui que je croyais parti pour toujours à la Réunion est revenu dans la maison ancestrale et s’est remis à écrire !
Petit-fils de berger, Guy Féquant a été professeur d’histoire et de géographie. Spécialiste de Tacite, il s’est nourri des Latins, de Lucrèce aux chroniqueurs carolingiens, des Romantiques allemands, jusqu’à notre cher Jünger. Lecteur de Gracq et de Déon, de Caillois et de Borges, il affectionne les écrivains voyageurs : White, Leigh Fermor, Bouvier… Aujourd’hui, il s’adonne aux joies de la retraite dans un petit village de sa Champagne natale, près de Rethel – où, en 1432, Philippe le Bon mit en place l’Ordre de la Toison d’Or. Cette province, il lui a rendu hommage dans son premier livre, Le Ciel des bergers (1986), étonnant dialogue archaïque entre un homme et le sol qui l’a vu naître, et aussi tribut rendu à ses aïeux bergers et laboureurs des terres crayeuses, comme ce grand-père qui lui dit un jour : « D’abord, ne jamais se complaire dans les petits maux que le destin nous inflige ; ensuite ouvrir grand son esprit à la magnificence du monde ; enfin ne consentir à rentrer en soi que pour prier ».
Après un essai consacré à Saint-John Perse, Guy Féquant a publié deux beaux romans malheureusement épuisés et qu’un éditeur ferait bien de rééditer.
Odinsey, qui s’ouvre par la devise figurant sur la pierre tombale de Martin Heidegger, « La marche à l’étoile, rien que cela », est la chronique imaginaire de l’île d’Odin, qui ressemble étrangement à l’Ultima Thulé de Pythéas. Lecteur d’Horace et d’Hérodote, botaniste et ornithologue (comme Féquant), Stéphane Arnasson y incarne un rebelle jüngerien qui assiste, impuissant, à la fin de la société aristocratique et païenne - c’est tout un, comme toujours -, celle des sagas, des prophétesses et des princes, emportée par la triple montée du christianisme, de la monarchie centralisée et du règne des marchands.
Le Jaseur boréal tire son nom d’un oiseau de mauvais augure, que la vieille langue thioise appelle pestvogel – l’oiseau qui annonce la peste, la guerre et la famine. Le lecteur y suit pas à pas, sans lâcher son grimoire une seconde, le jeune Manfred, élève d’une école monastique et compagnon d’Erik le Rouge en Amérique. Surnommé Julien l’Apostat par un frère ambigu qui préférerait avoir affaire à un athée, Manfred flirte avec un paganisme encore bien vivant (nous sommes aux alentours de l’an mil) tout en étant fasciné – qui ne le serait pas ? – par la figure du « moine grammairien voué au culte des livres et à la méditation au cœur de la forêt, ce désert d’Occident ».
J’avais lu ces livres il y a vingt ans, avec quel plaisir. Voilà que le facteur me dépose Plume, un roman, ou est-ce un récit ?, qui m’a ému et que j’ai abondamment crayonné. Plume est une sorte d’éloge des chats, comme le précise la dédicace manuscrite : « le silence des chats est celui des grands initiateurs ». Un couple de lettrés réfugié dans un village bourguignon, lui professeur de japonais et qualifié par sa femme, une traductrice, de mutashi otoko (« homme de jadis ») – un contemplatif fasciné par le grand mystère, « celui de l’instant volé à l’avalanche du temps ». Un rebelle, encore, rétif au monde moderne, vu comme « un complot contre l’âme, contre la part de nous-mêmes qui veut sans cesse relier la terre aux étoiles.»
Un jour, une chatte, légère et aérienne, arrive on ne sait d’où, sans doute abandonnée par des citadins, et se fait adopter d’emblée. Angora à la démarche décidée, tachée de noir et de blanc, Plume s’impose avec sa logique obéissant à des flux mystérieux. Entre l’homme et le félin se nouent des liens d’une étonnante profondeur, d’autant plus intenses que, lors d’un séjour à la Réunion, un autre chat, Timour, avait déjà occupé une place importante dans sa vie. Tout le récit tourne autour de la mort des deux chats, et de la métamorphose qu’elle implique chez l’humain qui leur survit. Moraliste influencé par le taoïsme comme par le vieux paganisme gaulois, Guy Féquant chante les chats, leur noblesse « sans passé ni attente », leur résistance aux mises au pas comme à tout dressage. L’époque, dit-il, n’est pas aux chats, trop indépendants, trop fins, mais plutôt aux chiens de garde et de camps. Le style, classique et d’une belle sobriété, rehausse ces réflexions tour à tour poétiques et désabusées que je suis sûr de relire encore.
Christopher Gérard
Guy Féquant, Plume, Editions Noires Terres, 222 p. 15€
Odinsey et Le Jaseur boréal avaient été publiés à la Manufacture.
Lire aussi mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, chats | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Avec Paul Morand

Heureuse initiative que celle des éditions Montparnasse de proposer une série de disques DVD reprenant une partie des Archives du XXème siècle naguère réunies par Jean José Marchand. On sait que ce dernier avait enregistré cent cinquante écrivains pour l’ORTF, de Borges à Dos Passos. Aujourd’hui, ce sont plus de trois heures d’entretiens avec Paul Morand (1888-1976) qui sortent du placard. Le texte en avait été publié par La Table ronde (dans la Petite vermillon) il y a une douzaine d’années. Grâce aux disques, la voix de Paul Morand, sa diction raffinée (« bien entendûû »), celle du Paris d’avant 1900, nous berce pour notre plus grand bonheur.
L’ancien diplomate, le dilettante cosmopolite, le chantre de 1925 répond aux questions préparées par Jean José Marchand, et posées d’une voix nasillarde par Pierre-André Boutang, dont la délicate insistance vient souvent à bout du mutisme morandien. Car, par un plaisant paradoxe, l’auteur de Tais-toi n’aimait guère parler : « si on parle on ne peut pas écrire, et on écrit dans la mesure où on ne peut pas parler ». Installé sur un banc de son jardin des environs de Rambouillet, sanglé dans une chemise jonquille à son chiffre, Paul Morand évoque donc l’incendie du Bazar de la Charité, son premier grand voyage, de la rue Marbeuf aux Tuileries… le jour de l’inauguration du Métropolitain.
Défilent les ombres de Schwob et de Rodin, de Giraudoux et de Larbaud, de Proust et de Sarah Bernhardt. L’homme a connu tant de monde… Oxford en 1908, le Quai d’Orsay sous Philippe Berthelot, Londres en 1912, les Roaring Twenties, New York et Tanger, et Venise, bien sûr. Morand avoue avoir mené, grâce à ses parents, « une vie poétique, très peu située dans l’espace et le temps ». Passent Claudel, Léger, Cocteau (« seize ans, il les a eus jusqu’à ses soixante-quinze ans »), Picasso. On reste pantois devant pareille mémoire (Morand a alors 83 ans), pareille clarté d’esprit : l’homme se souvient de tout avec une désespérante précision.
Christopher Gérard
Paul Morand, Entretiens réunis par Jean José Marchand, menés par Pierre-André Boutang (juillet/août 1970 et janvier 1971), Archives du XXème siècle, Editions Montparnasse, 25 € le double DVD.
***

Dieux qu’elle était attendue, la publication de la mythique correspondance échangée entre Paul Morand et Jacques Chardonne ! De 1949 à 1968, les deux ci-devant s’écrivirent en toute liberté près de 3000 lettres dont ils ne prévoyaient la publication qu’en l’an 2000, bien après leur mort. Un premier volume, préfacé par Michel Déon et annoté avec soin, rassemble 800 missives (1949-1960) qui composent une sorte de Journal commun, quasi matrimonial, moins inutile que mal-pensant, où nos deux amis disent sans fards ce qu’ils pensent de la France d’après-guerre, de leurs confrères et de leurs contemporains, de Sagan à celui que Morand nomme drôlement « Gaulle ». Contrairement à ce que l’on pouvait craindre en ces temps de sensiblerie néo-quaker, aucune coupure d’importance n’ampute le texte d’origine, qui propose ainsi un tableau bigarré des années 50, un concerto joué à quatre mains par deux virtuoses.
En guise de verdict, comment ne pas citer Chardonne : « une explosion ravissante » ? La richesse, la variété et la totale liberté de ces lettres ravissent. Sécheresse ? Cynisme ? Méchanceté ? Parfois, oui, mais quelle langue, et quelle lucidité ! Une œuvre unique.
Si Chardonne, trente ans éditeur chez Stock, parle surtout du milieu (du marais) littéraire, d’écrivains suivis avec attention (Nimier, Marceau, Laurent, Frank) et de revues (La Parisienne, Arts), de ses stratégies aussi, Morand, autrement plus étincelant, nous entretient de voyages (magnifiques peintures de Tanger ou de Lisbonne sous Salazar…) et d’art de vivre. Surtout, l’ancien diplomate évoque sa riche expérience et revient sur sa carrière au Quai d’Orsay, stoppée net à la Libération. Morand sait lire une carte et connaît l’histoire de l’Europe : « si l’Europe, de 1814 à 1939, a voulu que le Danube fût européen, et non russe, c’est que c’est par là qu’on arrive à Paris, depuis 1000 ans. J’ai lutté sur le limes de 1938 à 1944. » Le martyre de Budapest, l’intervention à Suez, la guerre en Algérie et l’arrivée au pouvoir du Général, que Morand déteste (« le Nasser du pauvre », l’homme « qui a fait don de la France à sa personne », Churchill étant lui qualifié de « fossoyeur de l’Europe »), nous valent des commentaires acerbes et d’une belle lucidité.
Chardonne, parfois flatteur à l’excès avec Morand, madré quand il s’agit de combines éditoriales, cruel et tarabiscoté (le côté huguenot ?), si réglé, si Vieille France (« se restreindre, rester une source ») est, au détour d’une lettre, capable de jolis raccourcis : « Les écrivains, c’est comme les émigrés de jadis, seuls, ruminant leur religion dans un monde étranger ». Ou, sur l’époque : « un âge de la débilité qui a eu pour père des enfants, un cauchemar d’évanescents.» De jugements sans appel sur les estimés confrères. Montherlant par exemple : « il n’a rien dans la cervelle, sauf un peu d’histoire romaine. C’est un sot. (…) Un ronchonneur, un ridicule paillard. Cela pue le célibataire, le vantard. (…) Farceur. » Et Fraigneau, qualifié de « mauvaise doublure de Cocteau ». Blondin, dont le talent est qualifié de mince, lui inspire ces lignes assassines : « je ne crois pas qu’il se détruise en buvant ; je crois qu’il boit parce qu’il se sent un homme détruit ». Dutourd a droit à cette pique : « le visage de la sottise gentille ».
L’un et l’autre, l’ermite de La Frette et l’exilé de Vevey, tous deux rescapés de l’épuration des Lettres, s’échangent des conseils boursiers (« gardez les cuivres, le nickel, et l’acier » serine un Morand très sûr de lui), de bonnes adresses à Séville ou à Roscoff, des compliments (surtout Chardonne) et des inquiétudes, notamment sur la santé du jeune Nimier. Des potins aussi, des histoires de femmes, des anecdotes de dîners en ville. Le récit de leurs manœuvres pour desserrer l’étreinte du « cordon du sérail », comprendre : la conspiration du silence qui, de manière sournoise, les nie depuis la Libération. A ce sujet, Chardonne s’exclame : « nous sommes des morts ressuscités », évoquant l’action de Nimier pour mettre fin à l’ostracisme.
L’un ne sait à peu près rien, sinon les intrigues du Paris des lettres et les histoires de couple. L’autre bondit d’un train dans un cabriolet, dépeint en quelques traits géniaux Tanger ou le Londres d’avant 14. Sans avoir jamais le temps de s’agacer, le lecteur change de registre, de ton et de regard, pour son plus grand plaisir. Plaisir suspect, je m’empresse de le dire, tant nos scrogneugneux, réactionnaires impénitents, expriment leur mépris de toutes les vaches sacrées d’aujourd’hui, des Hébreux à ces messieurs de la Manchette, et, en général, de ceux que Morand surnomme les « pygmées prolétaires ».
J’avoue préférer Morand à Chardonne, plus profond, plus à l’écoute du monde et parce qu’il sait voir comme personne. Ainsi, cette peinture de l’Espagne encore intacte : « Des journées bleues, des vieilles murailles cuites au soleil, des mules noires passent sur un crépi blanc, suivies d’une poussière rouge, c’est le bonheur. » Ou cette sentence d’une rare profondeur : « Le social est permanent, sinon éternel ; le national est éphémère ». Morand, oui, homme d’Ancien Régime, au regard clair et au cœur sec, qui se définit de la sorte : « Je suis un homme de l’Occident, de l’ombre qui tombe, de la nuit qui vient. »
Christopher Gérard
Correspondance tome I, 1949-1960
Paul Morand et Jacques Chardonne
Préface de Michel Déon
Gallimard, 1168 pages, 46,50€
*
**
"La vie n'est pas le critère à partir duquel on juge l'art." Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la littérature française, 2005.
Journaliste et normalien, auteur d’un essai sur le voyage d'écrivains français à Weimar sous l'Occupation (Le Voyage d’automne, Plon, 2000), F. Dufay se penche, dans Le soufre et le moisi. La droite littéraire après 1945. Chardonne, Morand et les hussards (Perrin), sur la droite littéraire après 1945 en comparant les itinéraires croisés de Paul Morand et de Jacques Chardonne. Ces deux phares de l’avant-guerre doivent « repartir à zéro » non en raison d'une quelconque collaboration mais plutôt de compromissions. « Rien d’horrible en fait », admettra Bernard Frank: quelques textes favorables à l'Europe nouvelle pour Chardonne, ancien dreyfusard et ami de L. Blum, défendu en 1945 par Mauriac et Paulhan. Morand, quant à lui, représente Vichy à Bucarest et à Berne sans pour autant s'impliquer dans la Révolution nationale. En 1953, il est réintégré dans la Carrière. Pendant la guerre, ces deux écrivains interviennent en faveur de proscrits (le propre fils de Chardonne est déporté pour espionnage). Avec le triomphe sans partage de la gauche idéologique, adepte d'une épuration permanente, toute la droite se voit en 1945 ostracisée par une nouvelle caste dominante, acquise aux utopies révolutionnaires, et qui organise autour d’elle une véritable conspiration du silence. La mode existentialiste, la toute-puissance de Sartre et des Temps modernes, le terrorisme intellectuel du PC et de ses filiales font alors peser une chape de plomb sur la vie culturelle. F. Dufay semble tout ignorer de l'atmosphère tendue de l'époque: pensons à l'affaire Kravchenko, à la négation systématique des atrocités soviétiques, aux procès de Moscou. Une poignée d’écrivains – M. Dufay écrirait « un quarteron » - se ligue pour défendre une liberté de création réellement mise en danger, ainsi que les nombreux interdits de séjour (plus d'une centaine d'auteurs, qui figurent sur la liste noire du CNE): les hussards, inventés par B. Frank dans son fameux "Grognards et hussards". Roger Nimier, le plus actif d’entre eux, se lie avec Morand et Chardonne avant de réhabiliter Céline de façon quasi miraculeuse. Tous ces « non-conformistes des années cinquante » ferraillent contre les professeurs de marxisme, les démocrates-chrétiens apeurés et autres compagnons de route.
Parmi ses multiples faiblesses, le livre superficiel de F. Dufay ne mentionne pas le lien évident avec les réseaux révolutionnaires-conservateurs des années 30, étudiés en leur temps par J.-L. Loubet del Bayle, puis par Nicolas Kessler. La monumentale Histoire des droites en France, publiée sous la direction de J.-F. Sirinelli (Gallimard) n'est pas même citée, pas plus que les thèses de N. Hewitt, de G. Loiseaux ou de J. Verdès-Leroux: il s'agit du travail d'un journaliste, plus friand d'anecdotes que d'analyses. A F. Dufay revient toutefois le mérite d'avoir souligné le paradoxe suivant: les apôtres du désengagement et d'une frivolité toute "parisienne" ont souvent fait leurs classes à l’Action française ou dans ses marges; certains reprennent du service au moment de la guerre d’Algérie (Nimier et Laurent appartiennent à la mouvance OAS). Leur désinvolture, leur indifférence à l’histoire ressemblent à des leurres : comme le remarque à juste titre B. Frank, « ce sont des écrivains que les circonstances ont contraint à se moquer de la politique ». Cette indifférence feinte pour l'histoire masque à peine l'impuissance des vaincus. Mais ce constat, B. Frank l'avait fait en 1952 avec autant d'élégance que d'esprit. F. Dufay, lui, se montre bien plus sévère que son talentueux prédécesseur et propose, au lieu d'une essai littéraire tentant de comprendre une époque troublée (la fin d'une guerre civile, les débuts de la guerre froide), une sorte d'enquête policière où le gendarme fait la morale aux délinquants, un sermon où le puritain fustige les libertins. Son moralisme est d'autant plus agaçant qu'il est anachronique, fondé sur des a priori illustrés par un vocabulaire qui trahit son hostilité profonde pour des écrivains injustement qualifiés d'épigones: les hussards, "ces écrivaillons bourrés de tics", dont le pedigree serait "chargé", "sévissent" dans des revues "ou autre Table ronde"; ils sont nourris de la "soupe primitive de l'Action française", etc. A-t-il vraiment lu toute l'œuvre de Déon et de Laurent? A-t-il pris la mesure de la mise au pas des lettres françaises en ces années d'après-guerre? Quant à Morand et Chardonne, stylistes reconnus par leurs pairs, ils se distingueraient par "une commune sécheresse de style et de cœur". Morand, qui travaille jusqu'à son dernier souffle, l'auteur de plus de 60 livres entre 1920 et 1976, date de sa mort, réduit à quelques pages d'un journal intime où il passe sa rage devant le déclin d'une civilisation! Un superbe écrivain jugé à l'aune du politiquement correct le plus abêtissant!
En outre, l'accumulation de clichés ne constituant pas une analyse, le lecteur a l'impression de lire un pamphlet dont l'auteur se contente trop souvent de lectures partielles (de préférences des citations courtes d'écrits privés), de procès d'intention (l'antisémitisme présumé, jamais prouvé, de Nimier ou de Déon; la volonté prêtée à Chardonne de lancer une épuration à l'envers). F. Dufay a pu consulter la fameuse correspondance quotidienne échangée entre Morand et Chardonne, d'où la méchanceté n'est pas toujours absente, c'est un fait… qui ne prouve rien, si ce n'est que deux scrogneugneus peuvent très bien dire du mal de leurs contemporains comme nous le faisons tous un jour ou l'autre. Pratiquer une telle réduction du supérieur à l'inférieur - une manie des biographes à l'anglo-saxonne? - n'est-ce pas négliger l'essentiel: l'œuvre de ces artistes, manifestement méconnue. Qualifier un joyau classique tel que Parfaite de Saligny de "perle rococo" n'est pas une preuve de goût ni de lucidité. Insister avec lourdeur sur la "sécheresse" de Morand, c'est oublier que, dans Tais-toi, l'artiste met en scène un homme paralysé par la pudeur et le goût de la solitude. C'est ne pas tenir compte des témoignages nombreux - Jacques Brenner, dans Le Flâneur indiscret ou Marcel Schneider, dans L'Eternité fragile - sur l'attention portée aux cadets de Chardonne, la jeunesse d'esprit et la gentillesse d'un Morand léguant sa garde-robe à un homosexuel notoire (sans parler des Juifs aidés au bon moment, puisque tel est devenu le critère absolu).
L'artiste. Voilà celui que F. Dufay ne réussit pas à comprendre, et donc à aimer. Il aurait dû réfléchir à cette phrase de Barthes, tirée de Sur Racine (1963): "tout le monde sent bien que l'œuvre échappe, qu'elle est autre chose que son histoire même, la somme de ses sources, de ses influences et de ses modèles: un noyau dur, irréductible, dans la masse indécise des événements, des conditions, des mentalités collectives". Il n'a rien vu du mystère de la création, du salut par l'art grâce au purgatoire imposé (probablement mérité) à ces écrivains qui, mis hors jeu, se rétablissent grâce à leur talent bien davantage que par l'action souterraine d'une quelconque conjuration.
© Christopher Gérard
Sur Paul Morand, lire mon Journal de lectures :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, droite littéraire, essai | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







