15 janvier 2015
Jacques Laurent ou le Joyce français

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05 juin 2014
Roland Laudenbach ou l’insolence

« Un esprit fort qui n’autorise pas les habiles à calomnier l’honneur et les barbares à offenser la civilisation »
Pol Vandromme
Mea maxima culpa, je confesse que, au début des merveilleuses années 80 (Mitterand, Reagan & Jean-Paul II), j’étais un étudiant dissipé, qui passait beaucoup plus de temps chez les bouquinistes que dans les amphithéâtres de mon Alma Mater. Il est vrai que, au cours de « grands courants de la philosophie », nous devions subir l’indigeste charabia d’un ancien secrétaire de Sartre, qui eut l’unique mérite - involontaire - de me vacciner à tout jamais contre l’imposture aux mille faces.
Je préférais flâner dans diverses librairies, dont Bruxelles était riche alors et où, du premier coup d’œil, je repérais la casaque blanche et vermillon ornée du mythique LTR dessiné par le peintre Salvat. De mes promenades je ramenais dans ma soupente des trésors intitulés Le Songe de l’Empereur, Minutes d’un libertin, Au large du siècle, sans oublier L’Histoire égoïste - les mémoires de Jacques Laurent, auteur d’un pamphlet, Paul et Jean-Paul, que je ne lus que bien plus tard. Je faisais alors connaissance avec Pol Vandromme et Michel Déon, Gabriel Matzneff et Willy de Spens. Ma joie quand je découvris, sur une étagère haut-perchée, un exemplaire intact du Drieu parmi nous de Jean Mabire.
Gavé de scolastique sartrienne à l’Université, je prenais en quelque sorte le maquis – un maquis blanc dont le commandant en chef, lointain, quasi mythique, se nommait Roland Laudenbach, alias Michel Braspart. Dans le joli Cahier que LTR publia en 1974 pour ses trente ans, j’appris ce qu’il fallait savoir de cet éditeur inflexible, l’ami de Cocteau et de Genet, l’homme qui brava les interdits de la police de la pensée non seulement en éditant des proscrits (dont certain poète madrilène, un temps collaborateur de Valeurs actuelles) et des pestiférés comme Morand et Giono, victimes de la vindicte des nouveaux puritains - les amis de Sartre & consorts. J’aimais que Vandromme exaltât chez Laudenbach ce sens de l’amitié : « une amitié sur un mode divinatoire et quasi initiatique » et que l’éditeur en personne, qui fut aussi romancier et scénariste, évoquât « l’amitié qui excuse tout, qui s’exprime soit par fou rire, soit par silence et autorise une connivence aux codes secrets ».
Une « connivence aux codes secrets » : quel plus beau programme pour un jeune rebelle de vingt ans et des poussières, en bisbille contre son époque et qui se cherchait des aînés qui ne fussent pas des pions ?
Cette connivence, je l’ai connue, non avec Laudenbach, disparu en 1991 et que je ne rencontrai jamais (même si, dès la fin de mon service militaire, j’avais écrit 40 rue du Bac pour y solliciter un emploi), mais avec Dimitri, le fondateur de L’Age d’Homme, dans divers lieux conspiratifs tels que la cave de la rue Férou, le Café de la Mairie ou son stand de la Foire du Livre.
J’aimais, et continue d’aimer à la folie ce côté hidalgo, intraitable sur les valeurs, sauvage même, et, je le confesse, ce parfum de conspiration. Cette générosité, dont Gabriel Matzneff témoigne dans L’Archange aux pieds fourchus, et je ne sais plus qui, qui disait les larmes de Laudenbach à l’annonce du Prix Goncourt décerné à Jacques Laurent pour Les Bêtises… publiées chez Grasset. De même, j’aimais que Laudenbach témoignât pour son confrère Lindon, des éditions de Minuit (celui-ci lui rendit la pareille lors d’un procès pour offenses au chef de l’état).
Et quel catalogue ! Gripari et Mourlet, Volkoff et Sérant, Héduy et Schoendorffer, Anouilh et Dominique de Roux… Un feu d’artifice. Les libertins du siècle, dont nous sommes aujourd’hui les orphelins.
Christopher Gérard
Publié dans le numéro 14 de Livr'Arbitres, revue littéraire non conformiste http://livr-arbitres.com/
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28 octobre 2009
Michel Déon
Concernant cet écrivain, voir mon livre Journal de lecture,
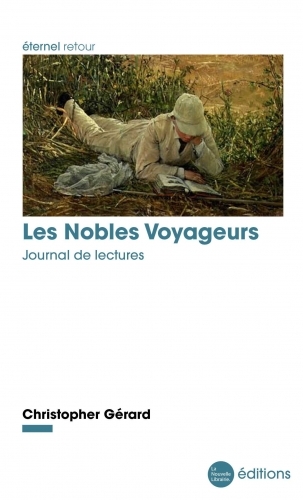
Avec Lettres de château (Gallimard), Michel Déon nous offre un splendide exercice d’admiration. Alors que tant d'écrivains oscillent quand il s'agit de rendre hommage à leurs enchanteurs, Déon choisit de leur rendre une visite de digestion. Un lettré salue ceux qui l'ont nourri - peintres et poètes - avec une épatante capacité d’émerveillement, juste ce qu'il faut d'humour, beaucoup de gratitude et, last but not least, de réels moments de grâce. Ses pages sur Nicolas Poussin suscitent ainsi un bonheur qui rappellera la lecture d'Un déjeuner de soleil ou des Poneys sauvages. En quelques lignes lumineuses, Déon partage ses réflexions sur un peintre qui "a abordé des rivages inconnus, dialogué avec des puissances ou ténébreuses ou radieuses". Toulet (Déon prononce le t final), Braque et Manet, Apollinaire et Conrad nous valent des pages témoignant d'une éblouissante maîtrise sans rien de brillant. Non, simplement, un gentilhomme nous guide dans sa mémoire et restitue un monde, celui de l'Europe civilisée.
Tous les aficionados de Déon liront donc ce livre… et prieront le libraire Eric Fosse ( fossefosse.e@wanadoo.fr) de leur céder, à prix d’or s’il le faut, le catalogue qu’il a édité à l’occasion des 90 printemps de MD : belle préface de Pierre Joannon (connu de tous les amoureux de l’Irlande comme des déoniens – it’s all the same). Et des raretés : le mythique Adieu à Sheila (Robert Laffont, Marseille, 1944, avec envoi), Amours perdues (Bordas, 1944), des grands papiers en veux-tu en voilà, des E.O. par dizaines, la Lettre à un jeune Rastignac (celui-là, je l’ai !) avec envoi à Raoul Girardet, des éditions rares illustrées, le manuscrit d’Ariane à Naxos relié par Miguet, celui du Dieu pâle (que MD semble considérer comme un péché de jeunesse), bref : Byzance.
Surtout, l’E.O. de Plaisirs, par Michel Férou, aux éditions de Paris, la mythique série blonde : le roman coquin de l’ermite de Tynagh.
Christopher Gérard
Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02 février 2009
Rencontre avec Michel Mourlet

Les Maux de la langue
«Nous sommes entourés d'amnésiques et de myopes qui voient de l'enrichissement dans la perte progressive de notre lexique et applaudissent la vitalité d'une syntaxe réduite à des rudiments qu'on a renoncé à enseigner»: ces lignes résument à merveille Les Maux de la langue, essai d'une rare lucidité sur l'indolence des francophones devant le déclin programmé de leur langue. Avec autant d'esprit que de bon sens, l'écrivain Michel Mourlet, actif depuis plus de quarante ans, s'en prend à la capitulation des «déshérités de la langue», hypnotisés par un discours dominant qui taxe de «ringarde» toute velléité de résistance à une pollution mentale s'attaquant aux structures mêmes de notre esprit. M. Mourlet ne se contente pas d'analyser les causes du mal comme le rôle des agents destructeurs (cuistres de l'administration, pédocrates réformistes, zombies publicitaires,…), il s'attaque aussi aux fautes les plus courantes de la novlangue techno-marchande: travailler sur Paris; le servile votre attention s'il vous plaît; les grotesques show room, deal et challenge; l'absurde celles et ceux (bel exemple de gynagogie); sans oublier les inévitables incontournable ou addiction. Pourquoi cette manie du barbarisme (initialiser, finaliser), pourquoi cette docilité de perroquet devant la pensée unique? Œuvre de salubrité publique, Les Maux de la langue constitue non point je ne sais quel improbable must, mais bien le nec plus ultra d'un combat essentiel; car perdre sa langue, c'est accepter l'asservissement.
Christopher Gérard
Michel Mourlet, Les Maux de la langue, France Univers, 300 p., 19 euros.
Voir: http://mourlet.blog.mongenie.com/
Entretien avec Michel Mourlet
Propos recueillis par Christopher Gérard
Depuis votre premier livre, D’Exil et de mort (1963), roman salué par Paul Morand, vous n’avez cessé d’écrire. Quel genre d’écrivain êtes-vous ?
Quelqu’un, me semble-t-il, qui a des curiosités multiples, répugne à la spécialisation et n’est jamais là où on l’attend. J’ai au moins cinq catégories de lecteurs : ceux qui pensent que je suis un théoricien du cinéma ; ceux qui pensent que je suis un écrivain de fiction, accessoirement essayiste de droite ; ceux qui me prennent pour un journaliste ; ceux qui ne me connaissent que pour mes activités théâtrales, pièces et critiques ; ceux enfin pour qui je suis un militant souverainiste anti-« franglais », administrateur de Défense de la langue française. Peu de gens de chaque catégorie savent que je m’occupe d’autre chose. Ces cloisons m’amusent beaucoup. En fait je crois surtout être un écrivain secret qui a horreur des gesticulations publicitaires et se ferait du souci pour l’avenir s’il avait, dans l’immédiat, une trop large audience. Dans ce sens précis, Paul-Jean Toulet ou Vialatte demeurent pour moi des modèles.
Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?
J’ai envie de répondre : Ni Dieu ni maître ! Je crois n’avoir eu que d’intimes admirations. Dans le passé et le désordre, quelques noms me viennent à l’esprit : Hugo, Valéry, Nietzsche, Racine, Vigny, La Bruyère, Stendhal, Barrès… Côtoyés : Fraigneau, Montherlant. En vérité j’ai lu ou connu personnellement – et infiniment goûté – beaucoup plus d’écrivains que cela et chacun a pu déposer en moi quelque chose de lui. Mais, comme je l’avais expliqué dans Le Figaro en réponse à un questionnaire des années 60, je suis le dernier à pouvoir identifier de manière objective les lectures qui m’ont influencé. Au moins deux commentaires sur mes Chroniques de Patrice Dumby, l’un de Michel Déon, l’autre de Jean-Marie Drot, m’ont attribué Larbaud comme ancêtre. Or il se trouve que j’ai peu lu Larbaud. N’est-ce pas curieux ? Il y a quelque chose que je peux ajouter néanmoins, concernant la formation des talents : les échanges d’idées, de brouillons et de remarques sur ces premiers jets entre amis du même âge, si les jeunes gens en question sont suffisamment ouverts, peuvent être féconds. Flaubert et Bouilhet en fournissent la preuve ; de même Valéry, Gide et Pierre Louÿs. J’ai expérimenté cela avec deux camarades de lycée : le futur écrivain Jacques Serguine, le futur cinéaste et producteur Pierre Rissient.
Vous avez aussi fréquenté de grands peintres. Quelles ont été les rencontres les plus décisives ?
Je n’ai pas assez côtoyé Salvat, qui avait créé la couverture de mon premier roman à la Table Ronde (et, par la suite, offert à mon magazine Matulu une très belle illustration de notre dossier sur Déon), pour dire que mes rencontres avec lui furent décisives. Elles étaient plutôt une conséquence de notre commune amitié pour André Fraigneau et Roland Laudenbach. J’en profite pour dire que Laudenbach, à mon avis, fut le dernier grand éditeur parisien, un éditeur de la trempe des Bernard Grasset, Robert Denoël ou Gaston Gallimard, pour qui « littérature » signifiait quelque chose de plus que la commercialisation d’un produit. Fermons la parenthèse. En revanche, j’ai très bien connu Savignac, qui n’était pas un grand peintre mais un immense affichiste. Il avait un sens extraordinaire du gag visuel et m’enchantait par ses propos réactionnaires d’une savoureuse virulence, qui frappaient toujours juste. Je possède de lui plusieurs gouaches grand format, notamment les illustrations originales des premières éditions de mes Maux de la langue, ainsi que l’affiche destinée à l’Illusionniste de Sacha Guitry, qui orne la couverture d’Écrivains de France. J’ai entretenu aussi, surtout à l’époque de Matulu, des contacts assez réguliers avec Mathieu, qui m’écrivait de superbes lettres, de son écriture de « seul calligraphe occidental », comme disait Malraux. J’en ai même conservé les enveloppes, qui mériteraient d’être encadrées. Mais le peintre dont j’ai été le plus proche, c’est sans nul doute Chapelain-Midy, dont la hauteur de vue, l’exigence esthétique, la profondeur de jugement, l’élégance morale et la complète indifférence aux modes intellectuelles correspondaient tout à fait à ce que j’attendais d’un artiste. C’est lui qui a peint l’admirable scène qui illustre la couverture de ma Chanson de Maguelonne, rééditée il y a trois ans. Avec les épîtres qu’il m’a envoyées, on pourrait presque composer un traité de l’Art… A contrario, et sans vouloir choquer personne, j’ai rencontré une fois le sculpteur César à Monte-Carlo et ne me suis pas attardé : il m’est apparu comme l’« artiste contemporain » par excellence, un faiseur.
Le cinéma occupe une place importante dans votre vie comme dans votre œuvre. Vous apparaissez dans A bout de souffle et vous passez même pour le législateur d’un courant. Qu’en est-il ?
Effectivement, j’ai une très grande carrière d’acteur derrière moi : dans l’obscurité de la salle du Mac-Mahon où se déroule une scène d’À bout de souffle, j’étais un des spectateurs. J’incarne également un consommateur attablé à la terrasse d’un café dans le Signe du Lion de Rohmer, un passant dans la foule de Vu du pont, et j’ai joué deux fois mon propre rôle : dans le premier film en Cinérama, comme rapin anonyme préparant les Arts Déco à l’Académie Cola Rossi de Montparnasse, et comme auteur dramatique dans l’Ordre vert, docufiction de la jeune et combien douée Corinne Garfin ! Plus sérieusement : j’ai participe au mouvement d’agit-prop cinématographique dit « mac-mahonien », en tant que « théoricien », comme disent les auteurs de mes notices biographiques, et bien que je n’aime guère ce mot. Ainsi que je l’ai confié récemment aux Inrockuptibles et au Choc du mois, je préfère être considéré comme l’analyste passionné d’une « expérience limite » du cinéma. (…)
J’ai rencontré Otto Preminger, de qui j’ai appris la fascination cinématographique, grâce à Laura, Angel Face, le Mystérieux Dr Korvo et Sainte Jeanne. J’ai rencontré mon ennemi intime le scénariste Cesare Zavattini, à Rome, et j’ai même enregistré avec lui un long entretien qui doit dormir dans un de mes tiroirs. Il avait tout compris de la nécessité du réalisme et rien de la nécessité du choix. J’ai bavardé maintes fois avec Losey, à Londres, avant qu’il ne laissât quelque peu corrompre son esthétique brutalement rigoureuse par des enjolivures compliquées. Et Lang, bien sûr ! Dans mon prochain livre sur le cinéma, je raconterai mon dernier déjeuner avec lui. Et Tati, et Deville, et Sautet, et Astruc, et le cher Vittorio Cottafavi, que j’ai visité pour la dernière fois en 1995 à Rome où je m’étais rendu une fois de plus, pour cause de Centenaire du cinéma.
Vous venez de publier Les Maux de la langue, un impressionnant recueil de chroniques consacrées à la défense du français. Quelle en est la genèse ?
Tout est parti d’une conférence que j’ai prononcée en 1981 devant un parterre d’officiers de l’École supérieure de guerre qui planchaient sur le concept de « défense globale », celle-ci devant selon moi inclure la défense de notre principal instrument de communication, de notre plus visible repère d’identité et de son trésor patrimonial. À partir de là, je me suis rendu compte que la plupart des gens étaient inconscients des enjeux géopolitiques – et même simplement personnels – du langage, et qu’ils articulaient leur idiome à peu près comme un animal aboie, rugit ou hurle ; ce qui ouvre les vannes d’un darwinisme linguistique où le plus fort en muscles et en gueule fait la loi. La question aujourd’hui se résume à ceci : puisque N millions de producteurs de Coca-Cola font ensemble plus de bruit que les autres, doit-on pour autant embaumer Molière dans un sarcophage comme Plaute et Aristophane ? Si l’on ajoute à cette question la constatation qu’en France même, N millions d’irresponsables et d’illettrés (je pèse mes mots et use de litote) s’en fichent et même parfois s’en félicitent, n’y a-t-il pas de quoi foncer dans le tas, lance en avant ? Ce fut mon cas, à partir du Discours de la langue, dont même le Président Mitterrand, fin lettré et grand amateur de Chardonne, tint à me remercier.
(…)
Clichy, octobre 2008.
"Le petit-fils de Valéry Larbaud": ainsi Michel Déon définissait-il Michel Mourlet, salué dès son premier roman, D'Exil et de mort (1961), par André Fraigneau et Paul Morand (« une écriture dont il faut faire grand cas »). Quelques années plus tard, un autre grand esprit, Robert Poulet, le félicita pour sa lucidité et pour son mépris affirmé des "jouissances morbides de la décadence".
Depuis plus de quarante ans, Michel Mourlet incarne ainsi sans faiblir la figure du poète-soldat, témoignant à sa manière de la permanence d’une figure immortalisée jadis par Alexandre Dumas: la fine lame qui récite Clément Marot aux belles (Tu descouvris ma poitrine assez blanche...), l’amateur de flacons pansus et de poulardes de Bresse, bref, l’homme archaïque dans toute son horreur. Nuançons immédiatement le propos : messire Mourlet se passionne depuis toujours pour le cinématographe, sur lequel il a écrit quelques livres de référence. Proche de Fritz Lang et d’Eric Rohmer, il fit partie des Mac-Mahoniens et, après avoir collaboré aux Cahiers du Cinéma, fut directeur de Présence du Cinéma. Les cinéphiles n’ignorent pas que cet ami de Cottafavi apparaît fugitivement dans A bout de souffle…
Avant de nous pencher sur l’écrivain proprement dit, rappelons tout de même l'aventure de Matulu (1971-1974), les trente numéros de cette mythique «gazette littéraire» tenue à bout de bras par notre mousquetaire, qui ferrailla avec panache contre les snobs et les pourrisseurs à l'heure où, trahissant leur fonction, les lettrés de France et d'ailleurs - la soi-disant intelligentsia - sombraient dans l'infantilisme dévoyé. Acte exemplaire de résistance à la destruction programmée de l'héritage commun, Matulu peut être considéré comme l'une des batailles d'arrêt menée en Europe contre ce que Jean Parvulesco, ami et complice de Mourlet, nomme la conjuration du Non-Etre. On songe à d'autres brûlots littéraires: Exil, la revue de Dominique de Roux; les Cahiers de la Table ronde, ou encore à la Nouvelle Revue de Paris, qui menèrent aussi leur guérilla contre l'imposture. Sans oublier, bien sûr, La Parisienne!
Autre acte de résistance spirituelle, ce petit livre que tous les dissidents devraient chérir: Le Discours de la langue (1985), lumineuse défense du français et de sa providentielle pureté. Dans la première livraison de la revue Antaios (été 1993), Mourlet se qualifie de païen, plus proche de Néron - quel artiste périt avec lui! - que des sectateurs de Chrestos, en un mot suivant du Grand Pan "qui enchante et terrifie". Encore une excellente raison de s'intéresser à cet esprit singulier: son paganisme serein, suprêmement gallo-romain, celui des jardins et des bois sacrés.
La réédition du bijou que constitue La Chanson de Maguelonne permet de (re)découvrir ce délicieux roman, publié naguère à la Table ronde, celle du grand seigneur qu'était Laudenbach et où officie aujourd'hui la propre fille de Michel Déon. De quoi s'agit-il? D'un galop vers l'Orient, accompli par un jeune noble provençal, épris de la troublante Maguelonne ("elle ne se possédait vraiment qu'au fond d'elle-même, au fond du silence"), fille du roi de Naples et promise à Gonzague, un fat, quoique bon escrimeur. Bref, un conte narrant les aventures d'un couple idéal, aidé par un troubadour en qui l'on reconnaîtra certains traits de l'auteur. Eloge discret de la chevalerie, hymne à la Méditerranée, exaltation de l'amour tant platonique que charnel (la fille du calife!), cette Chanson, dont le thème remonte à la nuit des temps, enchante et terrifie, comme le Grand Pan adoré par Mourlet. Elle enchante par sa grâce, par son goût du bonheur, par son illustration d'un idéal aristocratique, celui des Fils de Roi: "cette race peu nombreuse mais fidèle, perpétuée de siècle en siècle, qui méprise les intérêts vulgaires et les remous de l'époque pour se consacrer tout entière à la quête du bonheur et de la beauté". Elle terrifie, sans en avoir l'air, par son rappel discret de la puissance des enchantements comme des multiples masques que revêt la Mort.
Mourlet, petit-fils de Larbaud? Certes, mais aussi de Nerval et de Gobineau.
Michel Mourlet, La Chanson de Maguelonne, Atlantica, 174 p., 15 euros.
On lira bien sûr toute l'œuvre de Mourlet, mais accordons une mention spéciale à La Sanglière (Ed. Loris Talmart, postface de J. Parvulesco), qui recueille trois pièces de théâtre, chacune traitant d'un moment de l'histoire européenne. Un livre essentiel.
***
"A chaque époque, ce n’est qu’une poignée d’hommes qui empêche la société de pourrir tout à fait ”. Voilà un mot d’Henri Miller qui s’applique à merveille à Michel Mourlet, qui, dans Ecrivains de France. XXème siècle, (éd. Valmonde Trédaniel), présente une galerie d’écrivains saupoudrée d’entretiens souvent parus dans la revue Matulu, qu’il anima dans les années septante. Depuis la parution de son premier roman en 1963 (D’Exil et de mort, La Table ronde), M. Mourlet n’a plus cessé d’illustrer une certaine vision du monde, un certaine idée de la beauté et de la France, une France paysanne et royale, rebelle et raffinée (voir son journal en ligne : http://mourlet.blog.mongenie.com/).
Ecrivains de France peut se lire comme une réflexion lucide, sans rien d’amer, sur le calamiteux XXè siècle (1914-1989). Le lecteur retrouvera ou découvrira au fil des pages le très grec Anouilh; Gaxotte (qui réhabilita Louis XV), Dutourd, Benoist-Méchin (auteur d’un remarquable essai sur les jardins), Déon l’Irlandais (“ émanait de lui une odeur d’Europe ” dixit André Fraigneau), Béraud l’enraciné: “ l’homogénéité fondamentale de cette pensée tout entière accrochée au terroir, aux vertus profondes et simples de la race française telle qu’elle a été constituée par les siècles dans sa diversité régionale et qu’elle existe encore, sous les reniements et les effervescences médiatiques d’une morale officielle déboussolée ”. Sur le même sujet, M. Mourlet évoque le cosmopolite Larbaud: ”Il faudrait s’entendre sur la notion de cosmopolitisme, chère à Larbaud. Autrefois privilège d’une élite intellectuelle et voyageuse, elle a pris depuis quelques décennies une coloration fortement péjorative aux yeux des moins compromis dans le nouvel Ordre moral. Synonyme de déracinement, de métissage culturel, c’est la forme mondialiste et grand-bourgeoise de la massification égalitaire, idéal actuel des sociétés évoluées: le retour à l’indifférencié primordial du troupeau dont tout l’effort des hommes avait été de sortir depuis qu’ils marchent debout. (...) Ainsi, le cosmopolite d’aujourd’hui est essentiellement un colonisé qui jargonne le yanqui (comme dit Etiemble) et ne se plaît qu’à l’ombre des gratte-ciel poussés comme champignons sous toutes les latitudes, ébloui par la technique, la verroterie et le catéchisme de l’american way of life. ” Tout le livre est à l’avenant, mal-pensant en diable ! Bref, nous avons affaire à un authentique libertin, chez qui le goût du plaisir va de pair avec un esprit acéré, jamais dupe de l’imposture aux mille faces. L’entretien avec Henry de Montherlant, sans doute le dernier accordé avant son suicide, constitue une parfaite illustration de l’esprit de la Vieille Europe, qui repose sur un sens aigu des hiérarchies morales et esthétiques.
© Christopher Gérard
Il est longuement question de Michel Mourlet
dans mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards, langue française | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26 février 2008
Guy Dupré, clandestin capital
Concernant cet écrivain, voir mon Journal de lecture,
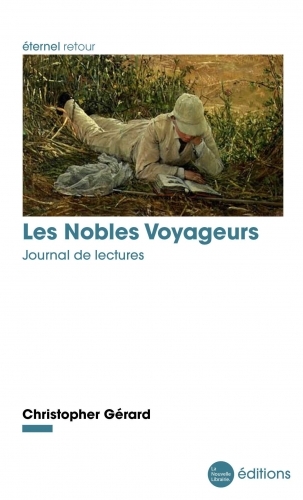
Entretien avec Guy Dupré
Christopher Gérard: Qui êtes-vous? Toute votre œuvre, essais et romans confondus, témoigne d'une puissante nostalgie, celle d'un Ordre mystique et guerrier. Quelles sont les racines de cette double vocation sacerdotale et militaire?
Historiquement parlant, j’appartiens à la première génération française d’anciens non combattants. J’étais de l’une des trois classes exemptées du service militaire pour avoir été touchées, pour ceux qui n’étaient pas étudiants, par le S.T.O. À l’âge de Guy Môquet j’étudiais l’Énéide au lycée Henri IV dans la classe de Georges Pompidou. Un de mes camarades de seconde, au collège de Saint-Germain-en-Laye, Marco Menegoz, rejoignit un maquis en 44 : fusillé sans qu’on ait donné son nom à une station de métro. Autre condisciple, Pierre Sergent, engagé en 44 et devenu capitaine dans la Légion étrangère ; lors du putsch d’Alger, il rallia ceux que le général de Gaulle a appelé les « officiers perdus ». Un autre, Michel Mourre, affilié à dix-sept ans au francisme de Marcel Bucard, entra au séminaire, y perdit la foi, et se retira d’une autre façon du siècle en s’attelant à son monumental Dictionnaire d’Histoire universelle. J’avais dû, pour ma part, mes rations de survie aux Baudelaire et Rainer Maria Rilke, aux Normands Flaubert et Barbey d’Aurevilly, aux Apollinaire et Milosz qui n’avaient pas une goutte de sang français dans les veines. Sans prétendre à substituer la satiété à la disette, j’entrai dans l’après-occupation avec la volonté de me revancher sur les années de rationnement et dénutrition qui avaient menacé mes sources vives. A mon aversion pour les sectateurs de l’absurde, sartreux et camusards, se liait mon rattachement intérieur à l’ordre militaire mort à Hiroshima, où naquit la mère de mon père. Une sorte d’obligation de participer au Vème acte de l’armée sur les théâtres d’opérations extérieures, en supplantant dans son ton le souffleur. D’exprimer à ma façon « le trouble de l’armée au combat » selon l’expression du général de Gaulle, dont le général Weygand, qui lui non plus n’avait pas une goutte de sang français dans les veines, me disait qu’il « n’avait pas trop de deux églises à Colombey pour s’y confesser de ses péchés ». Au croa-croa des corbeaux au col Mao ce serait préférer le chant du cygne de l’antique honneur militaire. Chant du cygne qui me mettait dans tous mes états – ces états qui me feraient remonter jusqu’aux débuts de la guerre franco-française, commencée avec la dégradation du capitaine Dreyfus pour finir avec l’exécution du colonel Bastien-Thiry. L’honneur du capitaine Dreyfus est de n’avoir jamais été dreyfusard. Le péché de Barrès, comme celui du Bernanos de La grande Peur des Bien-Pensants, est de n’avoir pas compris que Dreyfus était de leur bord, lié par le secret professionnel, et qu’il importait de l’isoler, de le détacher de son parti, pour honorer en lui l’officier perdu, l’officier sauvé d’un chapitre inédit de Servitude et grandeur militaires.
Parmi les constantes de votre œuvre, il y a cette loi de Sainte-Beuve. Comment s'est-elle imposée à vous?
C’est dans son unique roman, Volupté, que Sainte-Beuve, qui fit Hugo cocu, a placé dans la bouche de son héros Amaury l’énoncé de ce que j’ai appelé la « loi de Sainte-Beuve ». Amaury, né dans les dernières années da la monarchie, raconte à un jeune ami les souvenirs de jeunesse de sa propre mère : « Comme les souvenirs ainsi communiqués nous font entrer dans la fleur des choses précédentes et repoussent doucement notre berceau en arrière ! » Pour nous, retourner vers la mémoire d’avant, ce serait le temps que nos mères apprirent à épingler de petits drapeaux sur la carte des départements envahis. Trop jeunes pour devenir veuves, elles correspondirent avec le promis dont elles étaient les marraines de guerre. Entre la communauté des « morts pour la patrie » et nos esseulements, une transfusion s’opérait. Nous n’aurions pas trop de cette jeunesse souterraine pour réchauffer l’hiver de la feue France. Quant à la querelle entre maréchalistes et généralistes, comment aurions-nous pu opposer le général me voici au maréchal nous voilà ? Pareils à ces tritons barbus, ces monstres marins que Marcel Proust entrevoyait à l’Opéra, dans l’ombre transparente de la baignoire de la princesse de Guermantes, et dont on n’aurait su dire s’ils étaient en train de pondre, nageaient ou respiraient en dormant. Comment les jugerions-nous, les opposerions-nous, quand, à nos yeux, leur justification secrète était de nous entretenir dans le mystère douloureux et glorieux d’où tout découle et qui s’appelle le mystère du temps ?
Votre premier roman, Les Fiancées sont froides, s'inspire du romantisme allemand bien plus que du surréalisme. Thanatos me paraît la figure tutélaire de ce livre ensorcelant, et la désertion l'un de ses thèmes principaux. Après vingt-huit ans de retraite, vous publiez Le grand Coucher, un peu votre Guerre civile. Avec Les Mamantes, vous développez le thème de la Mère (si possible veuve), préférable à la Fille (si possible vierge). Peut-on y voir le reflet d'une obsession, celle du refus d'engendrer? En fin de compte, l'écrivain n'est-il pas souvent fils et père de personne?
Dans chacun de mes trois romans le narrateur s’adresse à l’autre : dans Les Fiancées sont froides le hussard devenu écrivain public s’adresse à un hussard qui pourrait être son fils et qui a lui-même déserté ; dans Le Grand Coucher le récitant dédie son mémoire à la veuve qui servait d’appeau au colonel recruteur ; l’amant en deuil des Mamantes explique à une jeune vivante pour quelles raisons occultes il a si longtemps refusé de lui faire l’amour « à la papa ». Il y a chez les trois désertion, abandon de corps, refus de reconnaître le père comme le fils – trahison de l’histoire humanoïde au profit d’une affiliation d’ordre extra-mondain. Il leur faut transgresser la loi naturelle, substituer à la loi du sang qui régissait l’ancien pacte social la règle d’une transmission elle-même garante d’une filiation élective.
Quel regard jetez-vous sur les Lettres françaises d'aujourd'hui? Quelles lectures conseilleriez-vous à un impétrant?
Même en littérature, disait Barrès, il y a avantage à n’être pas un imbécile. Nuançons le propos : « Il y a avantage, en littérature, à ne pas entrer dans la descendance de Monsieur Homais » - avantage à ne pas prendre les lampions du 14 juillet pour les lumières du siècle. « Je m’ennuie en France, disait Baudelaire, parce que tout le monde y ressemble à Voltaire ». Aujourd’hui comme avant-hier la référence aux « lumières » est un cache-misère et le laïcisme dévot la canne blanche dont les mal-voyants se font un gourdin. A l’âge où je ne voyais pas très clair, trois livres m’avaient aidé à remettre la pendule à l’heure : Les Sources occultes du romantisme, d’Auguste Viatte ; L’Âme romantique et le rêve, d’Albert Béguin ; La Poésie moderne et le sacré, de Jules Monnerot. A ce trio salvateur, permettez-moi d’ajouter le théologien allemand H. Urs von Balthasar, dont Albert Béguin m’avait cité ce passage sur le temps que j’aimerais choisir comme épigraphe et épitaphe : « Des temps et des destins antérieurs reçoivent leur sens de temps et de destins ultérieurs, les temps antérieurs sont si peu enfermés dans le moment de la durée qu’ils ont occupé et si peu irrévocablement passés qu’ils restent au contraire directement accessibles en tout temps. Et cet accès est de telle nature qu’il détermine leur essence – passée seulement en apparence – et qu’il les transforme continuellement avec le progrès du temps. »
Paris, le 13 novembre 2006
Publié dans La Presse littéraire, décembre 2006.
Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, guy dupré, nimier, hussards | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







