21 avril 2015
Avec Jérôme Leroy
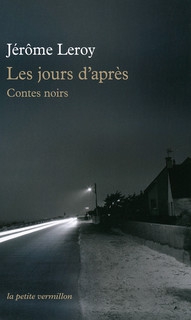
Les Jours d’après
& autres chansons tristes
Dans L’ Ange gardien, son dernier polar, Jérôme Leroy récapitulait des passions et des hantises à peu près inchangées depuis ses premiers romans : une France à son crépuscule, en proie à des élites corrompues, hantée par des polices parallèles… Avec le temps, il a ajouté à ce cortège de calamités le changement climatique et les mutations génétiques, déjà présents dans de précédents recueils de nouvelles. Les Jours d’après confirme le diagnostic posé dans Une si douce apocalypse ou dans Comme un fauteuil Voltaire dans une bibliothèque en ruine. Simplement, l’écrivain mêle avec maestria critique sociale (l’héritage de Jonquet et Fajardie – mais bonifié) et critique de la démocratie de marché, anticipation sur un mode apocalyptique (lecteur de l’Evangile de Jean, Jérôme croit davantage à la Fin qu’aux cycles), horreur dans le genre gore (clins d’œil de cinéphile) et, en attentif lecteur des Belges Owen et Sternberg, fantastique, voire réalisme magique (l’une des nouvelles, un bijou d’implicite, Crèvecoeur, illustre à merveille cette variante si particulière du fantastique).
Barbouzes bibliophiles et flics au bout du rouleau, zombies domestiqués par la grâce d’un vocalisateur pour midinettes, DRH à la gâchette facile (Browning GP 35 & Pamas G 1 avec son levier de désarmement), écrivains gavés de tranquillisants et de pouilly-fumé, politiciens humanoïdes menacés d’une panne générale peuplent ces contes noirs. Même refus de la décadence, même déchirante nostalgie du monde d’avant, même tendresse pour une France souveraine… Vers 1991, le regretté Dominique Venner disait de Monnaie bleue que « avec plus de force parfois que les essais historiques, certains romans sont les vrais révélateurs de leur époque, dévoilant tares ou aspirations ». Ceci vaut pour les contes orwelliens de Jérôme Leroy, très lucide, comme son ami Sébastien Lapaque, sur la liquidation programmée de l’indépendance nationale, et donc des appareils gaulliste et communiste. L’une ou l’autre nouvelle décrivent bien ce processus à l’œuvre depuis les années 60, qui mériterait un ou deux grands romans, que Jérôme et Sébastien, écrivains politiques autant qu’esthètes, nous doivent.
Un autre dimension des Jours d’après mérite d’être soulignée : si Leroy n’a jamais caché sa tendresse pour la France du Nord, il s’emploie ici à poétiser ces villes méconnues qui ont pour nom Roubaix, Arras et Lille – cette dernière, où il vit, étant décrite aujourd’hui… et après la catastrophe, alors peuplée de bonobos dyslexiques et d’hyènes maniaco-dépressives.
Avec Sauf dans les chansons, Jérôme Leroy renoue avec la poésie, ou, plus exactement avec une sorte de cantilène mélancolique, qui chante les matins profonds de Grèce et les pluies des Flandres, les femmes perdues et le vin, le plaisir si bref et le temps qui fuit, inexorable : « Dans l’appartement du temps / Sur les boulevards de l’hiver / Flandres temps et Drôme / Flandres temps et Drôme / S’éblouit votre fantôme. » Une poétesse russe, Natalia Medvedeva ; le confrère Thierry Marignac, encore un écrivain secret de haut parage, Amy Winehouse et Jacques Chardonne apparaissent au fil de ces chansons, dont la voix évoque le fado – cette voix singulière dont il y a encore beaucoup à attendre.
Christopher Gérard
Jérôme Leroy, Les Jours d’après, Petite vermillon, 8.7€ et Sauf dans les chansons, La Table ronde, 14€
***
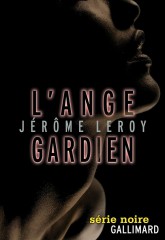
Joli montage que cet Ange gardien, où Jérôme Leroy récapitule des obsessions et des hantises qui n’ont guère changé depuis Monnaie bleue : il est vrai que la Vème République ne se porte pas mieux depuis les hideuses années 80, enlisée qu’elle est dans les égouts d’une mondialisation à marche forcée. Leroy n’a guère d’égal aujourd’hui pour décrire la faune de notre Bas Empire climatisé : journalistes à gages, flics stipendiés, éditeurs marrons, politiciens abrutis…
Les éditions originales recouvertes de papier cristal et les piquantes professeurs de lettres, les armes de poing et les vins non trafiqués, les anxiolytiques (stupéfiante, son érudition à propos de xanax & lexomil), le Rouen d’avant la catastrophe et les polices parallèles, tout un univers poétique ou glaçant revient sous la plume de notre révolté mélancolique.
Si dans Le Bloc, son précédent polar, il décrivait les coups tordus d’un gouvernement de droite qui pariait sur des émeutes ethniques pour se maintenir au pouvoir, aujourd’hui c’est à la gauche établie qu’il réserve quelques tirs tendus. Outre un climat proto-totalitaire, celui de notre décadence, on retrouve dans L’Ange gardien bien des personnages du Bloc, à commencer par Stanko, l’homme des basses œuvres du Bloc patriotique, le parti du tribun Dorgelles. L’Ange gardien passe pourtant un cran au-dessus du Bloc en raison de la plus grande densité de ses personnages, d’une critique sociale mieux intégrée au fil du récit et moins manichéenne, donc plus profonde, enfin d’un humour plus désespéré encore. Prenons le pivot de ce roman, Berthet, l’ange de la mort : sentimental samouraï d’un Occident décomposé, tueur méthodique (quoique parfois négligent : sa chair est faible) qui choisit des pseudonymes littéraires (Jacques Sternberg !) et collectionne les éditions originales de Toulet ou de Michaux. Cette (improbable) barbouze, qui a débuté sous Pompidou, a trempé dans bien des affaires, du meurtre de Pierre Goldmann à la noyade de tel activiste dextriste. Berthet appartient en fait à l’Unité, que d’aucuns appellent l’Etat profond, un service public occulte, invisible et omniprésent, spécialisé dans le nettoyage, y compris médiatique. Ses honorables correspondants se nichent partout, au CNRS comme dans les ministères et les grandes entreprises, et ses chefs, aux noms de cinéastes, nulle part. L’Unité ne fait pas de politique : elle l’influence en tirant le tapis d’un coup sec au bon moment, d’où quelques chutes regrettables. Au début de la Vème, l’Unité maintenait l’ordre national et républicain ; sous l’actuel président, elle ne fait plus que colmater les brèches, pour retarder le naufrage. Signe de nos temps de déréliction, l’Unité subit le même sort que l’école publique ou la poste : les contrats à durée indéterminée cèdent la place à des extras, incompétents et pressurés. La qualité s’en ressent ; Berthet en fait l’expérience dans la nuit lisboète. Il lui suffit de découper au bistouri l’oreille d’un collègue (une scène à la Dexter) pour apprendre que sa protégée, qu’il suit à son insu depuis vingt ans, la ravissante Kardiatou Diop, jeune Secrétaire d’Etat issue des quartiers de Roubaix, va faire l’objet d’une « opé » à la demande de son parti, celui de l’Exemple et du Changement. Non sans brio, Leroy inverse l’intrigue du Bloc : au complot interne à la droite nationaliste - vertueuse liquidation des affreux à la veille du grand soir - il substitue une double conspiration, autrement plus subtile : le sacrifice d’une martyre de la diversité et, cerise sur le gâteau, de la Walkyrie, la fille du tribun Dorgelles, et hop, « Liberté, égalité, fraternité ». Heureusement, il y a encore dans cette France crépusculaire des tueurs dont l’honneur s’appelle fidélité…
L’Ange gardien constitue une parfaite illustration de l’hétérotélie, quand de tortueuses manœuvres aboutissent au résultat inverse de celui recherché. Autre personnage attachant de ce roman où alternent douceur et noirceur, poésie et brutalité (des scènes de sexe trop appuyées, Série noire oblige), celui, récurrent dans l’œuvre du camarade Jérôme, de l’écrivain qui ne va pas trop bien, le lettré dépressif et drogué aux « benzos », l’amant précaire. Joubert est le nom de ce quinquagénaire désabusé, qui pige à droite toute malgré ses idéaux rosâtres et, au lieu de bâtir son œuvre, commet, pour boire, des romans pornographiques. La rencontre entre la barbouze et l’écrivain, un autre leitmotiv chez Leroy, est ici particulièrement réussie, car non dénuée d’un humour grinçant. Concluons. Notre « chardonnien sensuel et contrarié » n’a pas failli à sa mission : d’une belle ampleur, le montage tient la route, baigné d’une réelle poésie, celle des matins grecs et des bistrots parisiens, grâce au talent d’un de nos beaux écrivains*, qui sait, lui, « qu’il n’y a de vérité et de sens que dans la métaphysique ».
Christopher Gérard
Jérôme Leroy, L’Ange gardien, Série noire, 330 p., 18.90€
*L’honnêteté commande de déplorer, page 142, un « rentrer sur Paris » qui devrait me valoir une ou deux fillettes de Chinon sans soufre.
On dit encore davantage de mal de Jérôme Leroy
dans mon journal de lectures.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20 avril 2015
Les Rouges et les Noirs

La Legge dell’odio, titre original de l’épopée d’A. Garlini, illustre mieux le sujet de cette fresque de l’Italie des années de plomb que celui choisi par Gallimard, tant le personnage principal, Stefano Guerra, incarne un avatar d’Arès aux noires prunelles, le terrible dieu de la guerre. Les Œufs du dragon aurait aussi convenu…
Etudiant à Rome en 1968, Guerra appartient par tradition familiale à la droite la plus incandescente, plus proche en réalité des « Chinois » de l’ultragauche et d’autres anars que des bourgeois de la Démocratie chrétienne ou même des notables du M.S.I. Guerra le bien nommé affronte ainsi la police, vole une arme et, par accident, tue un militant gauchiste dont il a séduit la sœur. En quelques heures s’est jouée la tragédie d’une vie dédiée à la violence, à l’odio. Pris en mains par un réseau noir plus ou moins clandestin, constitué des rescapés de la Decima Mas et des ultimes partisans de Mussolini, Guerra plonge dans l’activisme le plus violent et le plus trouble, qui allie combats de rue et trafic d’armes, sans oublier de sanglants attentats à la bombe. Bientôt, sous l’influence de son mentor, le très ambigu Franco, meneur ressemblant étrangement à Guido Giannettini, l’un des protagonistes de la stratégie de la tension, Guerra rencontre militants et barbouzes au cours d’une dérive nihiliste qui évoque celle de nos modernes djihadistes. Malgré des longueurs et quelques bavardages, Les Noirs et les Rouges se révèle un grand roman, où nous accompagnons le jeune activiste devenu tueur, lecteur de Nietzsche, de von Salomon et même de Marcuse, jusque dans sa cavale en Afghanistan et en Patagonie. Nous le suivons aussi Corso Vittorio Emmanuele, dans l’appartement de Julius Evola, l’auteur de Chevaucher le tigre, qui chasse le jeune homme en ces termes : « tu es un loup bleu. Va-t’en ». Le penseur de la Tradizione rejette le proscrit, l’exclu, le maudit archétypal qu’est Stefano Guerra – homo sacer.
Romancier politique, Garlini dépeint sans trembler les collusions entre activistes rouges ou noirs (les deux mouvances s’infiltrant à qui mieux mieux) et officines politico-militaires, d’où les agents US ne sont pas absents : « se servent-ils de nous ou nous servons-nous d’eux ? », se demandent ces têtes brûlées, jusqu’à l’éblouissement final. Toutefois, l’auteur voit plus loin qu’une énième dénonciation de l’extrémisme, qui serait sans intérêt : il comprend de l’intérieur un type d’homme, le Kshatriya, héraut d’une mystique de la violence vue comme une purification, l’homme d’épée dépourvu de légitimité dans une époque où règnent le mensonge et la parodie. Stefano Guerra est une sorte d’Achille contemporain, un enragé aveuglé par une pulsion de destruction, que le romancier nous fait toutefois prendre en affection. Romancier psychologique, Garlini décrit en clinicien un cas d’Oedipe non résolu et les conséquences d’un tel malheur. Sa peinture de l’amour passion comme de la fraternité des activistes, avec leur part d’ambiguïté, doit être saluée, de même que celle des rapports complexes entre l’agent traitant et celui qu’il manipule. La gauche ultra, la Toskana-Fraktion, n’en sort pas grandie : « des bourgeois de bonne famille : l’école jusqu’à une heure, le déjeuner avec maman et la leçon de tennis, un italien sans accent régional, le petit pull en cachemire, les oreilles remplies par la musique des concerts de Santa Cecilia et la méchanceté arrogante du gamin qui a mis la domestique en cloque ». Sur fond de Volkswagen Coccinelles et de rengaines absurdes, un grand roman donc sur la décadence mercantile des 60’, sur les parodies de chevalerie et la quête d’un ordre d’acier, au sein duquel « les mains couvertes de sang aident à corriger le regard ».
Christopher Gérard
A. Garlini, Les Rouges et les Noirs, Gallimard, 676 p., 27.50€
Une version de la présente chronique a paru dans Service littéraire
Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, italie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |







