Avec Sébastien Lapaque
25 février 2014
Théorie de la carte postale
« Est-ce qu’on est sérieux quand on écrit des cartes postales ? » s’interroge Sébastien Lapaque. Question purement rhétorique, car, depuis toujours, ce flâneur impénitent rafle, partout où le mènent ses pérégrinations équinoxiales ou germanopratines, des cartes postales par brassées. Ces cartes, du Brésil et du Musée de Cluny, de Pau* et d’Alger, il les adresse à ses amis pour les étonner, les amuser, atténuer leur peine et, en fait, « maintenir et tisser des liens d’humanité solide et vraie dans le monde de la séparation ». On s’en doutait, avec dom Lapaque, la métaphysique n’est jamais loin : griffonner, sur une table de bistrot où tiédit un Vittel-menthe, quelques mots au bic 4 couleurs, « le stylo des épiciers et des collégiens », constitue un acte de haute magie blanche. Vraiment ? Mais oui, estimé lecteur : il s’agit pour l’adepte de transmuer le temps réel des prothèses électroniques en temps différé – celui des saints et des mystiques. Il s’agit pour l’anarque, le rebelle cher à Jünger (et à Bernanos), de se retirer des polémiques subalternes, qui crétinisent et avilissent, pour redevenir l’un de ces Véridiques en qui Nietzsche voyait les aristocrates de la pensée. Il s’agit de créer une once de beauté – les mots, les précieux mots, et l’encre qui les trace – dans un monde à l’envahissante laideur. Au styliste la carte postale impose une langue ferme, lapidaire – classique. Donc suspecte en ces temps de cotonneuse logorrhée. Mieux, Lapaque prend un soin maniaque, non pas – Dieux merci ! – à collectionner comme le premier écureuil venu, mais à sauver du naufrage des centaines de cartes plus ou moins anciennes, qu’il déniche chez les bouquinistes et dont il truffe ses livres. Lire ces cartes sépia à voix haute, répéter un message rédigé dans la fièvre du 11 novembre 1918 ou à l'aube du 27 juillet 1962, articuler avec soin le prénom d’une marraine, d’un oncle ou d’un fils aujourd’hui défunts ou perclus de rhumatismes, c’est abolir le temps qui dévore tout, c’est sauver des visages de l’oubli. La carte postale comme prélude à la rêverie, comme rituel orphique.
Christopher Gérard
Sébastien Lapaque, Théorie de la carte postale, Actes Sud, 10 sesterces.
* Lapaque salue aussi les Mânes de P.-J. Toulet, qui s’adressa des centaines de cartes postales pour se raconter des histoires.
*
**
Concernant cet écrivain, voir mon livre Journal de lecture,
Et cet entretien:
Qui êtes-vous?
Dans Les Identités remarquables, le héros se rappelle le temps où il aimait «tout ce qu’il peut y avoir de sonore dans une idée» — partant dans une définition de soi. Et son ami Laroque se souvient qu’il épatait les filles en citant Alcméon de Crotone ou Nonnos de Panopolis. À l’orée de son âge d’homme, on aime le bruit, les mots qui claquent, les citations, les références. Comme eux, j’ai dû me sentir tour à tour classique et romantique. Aujourd’hui, je pourrais continuer. Me dire anarchiste chrétien ou catholique baroque. Mais la configuration du monde en tribus par l’économie autonomisée ne me donne pas envie de me bricoler une identité. Je préfère écouter le Paul de l’Epître aux Galates : «Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.» Et puis, si je savais qui j’étais, je n’écrirais pas de livres.
Quelles ont été pour vous les grandes rencontres?
Né trop tard dans un siècle trop vieux, c’est dans les livres que l’on fait ses rencontres les plus marquantes. J’aimais Balzac, Flaubert, Simenon. Je n’ai pas le souvenir d’avoir reçu l’enseignement décisif d’un professeur, sauf un professeur de physique-chimie (!) qui m’avait donné à lire L'adieu au roi de Pierre Schoendoerffer en classe de seconde. Au lycée Hoche à Versailles, je subissais les cours de vieux marxistes ralliés aux vertus de l’économie de marché et des droits de l’homme. C’était la fin des années 1980, la Bourse, l’argent, l’Empire du Bien, l’impératif catégorique d’Emmanuel Kant, bientôt les bombes incendiaires sur l’Irak… Vous voyez le genre… Pour avoir des bonnes notes, il fallait aimer Brecht et Sartre… Enfant, j’aimais l’aventure : Stevenson, Maurice Leblanc. À quinze ans, je lisais Saint Exupéry et Guy de Larigaudie… J’ai découvert ce qu’était la littérature avec l’œuvre de Bernanos, les essais d’abord, puis les romans. J’avais remarqué La Liberté pour quoi faire ? en librairie, le titre m’avait conquis. À la même époque, j’ai lu Maurras : c’était un bon moyen d’exaspérer les imbéciles. Mais avec Bernanos, j’avais ingurgité l’anticorps avant de prendre le poison. J’ai vite compris que le maurrassisme était un modernisme. Je préférais Pascal, Simone Weil, Jacques Maritain et le François Mauriac des romans et du Bloc Notes… L’humanisme intégral… C’est mon côté catho de gauche… À l’époque, il y avait aussi Orwell… Mes anticorps à la Critique de la raison pratique, c’était la Somme de saint Thomas d’Aquin, que j’ai toujours gardée à portée de main, et l’Ethique à Nicomaque d’Aristote. En 1988, j’avais dix-sept ans lorsque ont paru les Commentaires sur la Société du spectacle de Guy Debord aux éditions Lebovici. J’ai eu la chance d’avoir des amis plus âgés qui m’ont conseillé d’acquérir ce volume à la couverture grise. Quel tremblement… «La construction d’un présent où la mode elle-même, de l’habillement aux chanteurs, s’est immobilisée, qui veut oublier le passé et qui ne donne plus l’impression de croire à un avenir, est obtenue par l’incessant passage circulaire de l’information, revenant à tout instant sur une liste très succincte des mêmes vétilles, annoncées passionnément comme d’importantes nouvelles ; alors que ne passent que rarement, et par brèves saccades, les nouvelles véritablement importantes, sur ce qui change effectivement. Elles concernent toujours la condamnation que ce monde semble avoir prononcée contre son existence, les étapes de son autodestruction programmée.» Je me souviens qu’un de mes voisins, fils de bonne famille qui étudiait à Sciences-Po, m’avait surpris dans un train de banlieue avec ce livre entre les mains… «Qui t’a dit de lire ça ?» … Il avait raison de me parler comme ça. Qui ? Héritage et transmission, «générations d'esprits fécondants et d'esprits fécondés, qui à leur tour fécondent d'autres esprits ; filiation des maîtres et des disciples» (Larbaud) : c’est là toujours toute la question.
De Narcisse à Clytemnestre, les figures de la mythologie sont très présentes dans votre œuvre. Ce que vous nommez «le plus ancien et le plus caché»…
Pardon de faire le cuistre en citant le Proust de Contre Sainte-Beuve, mais ce n’est pas S.L. qui s’exprime dans les Identités remarquables… «Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices.»… C’est Laroque qui évoque l’importance de la «ce qui est le plus ancien et le plus caché». Dans les Idées heureuses, mon précédent roman, le héros se faisait appeler Philoctète. Lui aussi savait que l’Antiquité, c’est le trésor enterré au fond du jardin auquel on ne revient pas par hasard, mais parce qu’on connaît son prix. Faire retour à Homère, Thucydide ou Platon, convoquer les figures de la mythologie, mettre en scène leur réelle présence, c’est savoir qu’il y a du toujours dans le temps qui passe. Voué à naître orphelin et à mourir célibataire, l’homme du XXIe siècle n’aime pas entendre ce toujours. La survalorisation de sa singularité lui fait écarter le trésor de l’expérience humaine. Tant pis pour lui.
Votre dernier roman, Les Identités remarquables, peut-il se lire comme un memento mori contemporain, une mise en garde ainsi qu'une illustration de cette philosophie tragique que Clément Rosset, que vous avez peut-être lu, avait synthétisée il y a plus de quarante ans?
Clément Rosset est longtemps resté caché dans un angle mort de ma bibliothèque. C’est mon amie Alice Déon, qui dirige les éditions de la Table Ronde, qui a insisté pour que je le lise. Le sentiment tragique de la vie, je l’avais trouvé auparavant chez Pascal, Kierkegaard, Bernanos. Qui saura à quel point leur cœur a saigné ? Ce que j’aime chez Pascal, c’est le sentiment aigu de l’ambiguïté du monde et du caractère inauthentique de la vie quotidienne. Les identités remarquables essaie de traduire ce sentiment en employant des moyens qui appartiennent au seul roman.
Pour revenir à ma première question, qui êtes-vous, puis-je voir en vous un mélange de reître (comme le sous-lieutenant Laroque, le narrateur de votre roman) et de lettré (comme votre singulier héros - mais s'agit-il d'un héros?)?
C’est étrange que vous parliez du «sous-lieutenant» Laroque, je ne me souviens pas de lui avoir donné ce grade. Dans mon idée, bien qu’agrégé de l’Université et boxeur amateur de bon niveau, Laroque a fini son service militaire avec le grade de caporal-chef, incapable d’être passé sous-officier, et a fortiori officier, à cause de son franc-parler. Laroque, c’est un garçon que je vois bien siffloter «le Déserteur» en passant sous les fenêtres de son colonel avec la Médaille miraculeuse cousue au fond de son béret amarante… Mais bon, si vous dites qu’il est sous-lieutenant, c’est que j’ai dû l’écrire quelque part. Sous-lieutenant, c’était le grade Stendhal au sein du 6e régiment de Dragons, l’ancien La Reine Dragons du siècle de Louis XIV. C’est le régiment dans lequel Bernanos s’est engagé en 1914 et dans lequel il a servi pendant presque toute la Première Guerre mondiale. Il a fini avec le grade de brigadier… Mais revenons-en à nos reîtres et à nos lettrés… Laroque n’est pas mon double, le héros non plus. Le personnage que j’aime le mieux, dans mon roman, c’est Caroline, la petite marchande de jouets : simplicité, tendresse, intelligence.
In vino veritas pourrait être l'une de vos devises. Dionysos semble lui aussi omniprésent dans le roman comme dans ce précieux Petit Lapaque des vins de copains, dont le cru 2009 est enfin disponible chez les cavistes ?
Dionysos, c’est le deux fois né, celui qui vient semer le désordre régénérateur au sein de nos vies trop bien peignées. Dans un roman, comme dans la vie, il faut que la folie joue sa partie. Le vin, c’est une extension du domaine de la lutte. L’important est de proposer un art de vivre complet, une vision du monde cohérente pour faire face à la dévastation capitaliste. J’ai présenté ma collection de vins une première fois en 2006, je récidive : avantage aux vins de vignerons, expressifs et naturels, non trafiqués, peu ou pas soufrés, « à boire entre amis, « entre hommes », probablement en grande quantité, pour discuter rugby » comme l’écrit le critique anglais Paul Strang, qui est un peu l’anti Robert Parker, vous l’aurez compris. Ces vins « nouvelle vague » ont pris l’avantage sur les bêtes de concours bodybuildées. Et je crois savoir qu’on en trouve dans de nombreux endroits en Belgique. En épigraphe de la nouvelle édition du Petit Lapaque des vins de copains, j’ai reproduit une réflexion de Joan Sfar qui résume mon propos. «Il me semble que la pensée occidentale, qu’elle soit religieuse ou philosophique, s’est bâtie autour de deux éléments sacrés : le vin et les étoiles. On boit, on regarde le cosmos et on invente la Bible, la pensée dialectique, la géométrie, l’amour du prochain, le Graal, le roman moderne. On ne peut vivre debout que si l’on est perpétuellement tendu entre la terre et le cosmos. Perdre ces deux liens c’est redevenir des singes. Aujourd’hui, on ne voit plus les étoiles à cause des lumières des villes. Voilà qu’on nous propose de tous boire le même vin. On a le droit de dire NON, parfois ?»
«Ce monde (…) borgne et bête, fragile, méchant, infantile, agité, orgueilleux», «ce siècle en miettes» : me permettrez-vous de vous considérer comme appartenant à la noble cohorte des antimodernes?
J’ai lu les Antimodernes d’Antoine Compagnon. Je ne vais pas vous mentir en prétendant que la place avantageuse que vous me réservez sur la photographie de famille aux côtés de Joseph de Maistre, Charles Baudelaire, Léon Bloy, Charles Péguy, Jean Paulhan et Roland Barthes me déplaît. Mais j’en reviens à votre première question : je ne suis pas en recherche d’une tribu. L’écriture est un exercice solitaire, une responsabilité personnelle. Attendez que je sois mort pour savoir dans quelle case me ranger : six pieds sous terre, tout cela n’aura plus beaucoup d’importance. Ce qui ne veut pas dire que je me crois le seul dans mon genre. J’ai des maîtres, j’ai aussi des contemporains. Parmi les écrivains de ma date, j’éprouve un sentiment de fraternité à l’égard de Jérôme Leroy, Jean-Marc Parisis et François Taillandier. Mais nous n’avons pas la prétention de former une école ou un groupe constitué. Vous me direz que nous n’en avons plus la possibilité… N’importe ! Nous vaincrons parce que nous sommes les plus faibles.
Propos recueillis par Christopher Gérard, entre Amazonie et Brabant, équinoxe de septembre 2009.


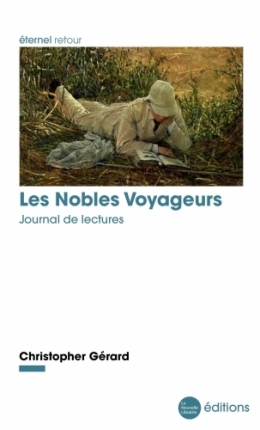
Les commentaires sont fermés.