De bibliotheca mea (31 décembre 2018)
Entretien avec Rony Demaeseneer
Dans l’intimité d’une bibliothèque d’écrivain…
Quelles sont vos premières lectures marquantes ? Ces lectures sont-elles associées pour vous à des souvenirs, des impressions liées à la matérialité du livre : une illustration de couverture, un grain de papier, un format, une odeur, une collection, etc.
C’est le 6 décembre 1972 qu’un livre a changé ma vie. A peine âgé de dix ans, j’ai reçu de ma grand-mère un album illustré qui, malgré déménagements & pérégrinations, ne m’a jamais quitté : Légendes de la Grèce ancienne. Le monde merveilleux des dieux, des déesses, des nymphes et des héros, de Roger Lancelyn Green, écrivain britannique formé à Merton College (Oxford) sous la direction de C. S. Lewis et, comme lui, membre du cercle littéraire informel des Inklings.
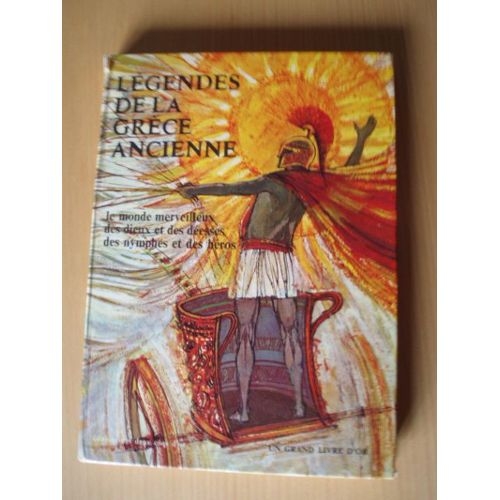
Comment ne pas rêver, toute une vie d’homme et d’artiste, aux noms d’Ouranos et de Gaïa, dont naquirent Océan, Chronos (le Temps, au centre de toute vie d’écrivain ?), le géant Antée (lequel donna son nom à une prestigieuse revue symboliste belge du début du XXème siècle, où l’on lisait Christian Beck, André Gide et Rémy de Gourmont) ? Combien d’heures solitaires passées à rêver à Mnémosyne, qui de Zeus enfanta neuf filles, les Muses ? A Phaéton et au char du Soleil, à l’imprudent Icare, à cette fascinante Toison d’Or (qui parle au cœur de tous les Bruxellois), au courageux Thésée ? Quelques années plus tard, un splendide feuilleton italien m’initia aux voyages d’Ulysse, au courage de Thésée, à la noblesse du chien Argos.
D’autres invoqueront Proust ou Kafka. Moi, ce sont les dieux et les déesses, les nymphes et les héros qui, à jamais, ont peuplé mon imaginaire. Cet album aux couleurs fauves me plongea dans le monde de la lecture, que je n’ai plus quitté. Toujours grâce à ma grand-mère, j’ai découvert, dans la bibliothèque verte, dont je recevais un volume à chaque bon bulletin, Les Aventures de Langelot, un agent secret au service de la France (du Général), dont l’auteur, le lieutenant X, je l’appris trente ans plus tard, n’était autre que Vladimir Volkoff, qui allait, par le truchement de mon éditeur Dimitri, devenir un ami.
Sans oublier Henry de Monfreid et Joseph Peyré - un avant-goût de l’aventure à une époque, les tristes années 70, où l’on voyageait peu, même en rêve. Puis, dans l’horrible reliure bleue des éditions Walter Beckers de Kalmthout, Jules Verne (Michel Strogoff, Vingt mille lieues sous les mers. Et, mon préféré, Voyage au centre de la terre). Un peu plus tard, dans les petits volumes de poche Marabout à cinq francs, les récits d’explorateurs (comme le spéléologue Norbert Casteret) ou de guerriers (Le Grand cirque de Pierre Clostermann, l’épopée des Belges de la RAF…), mais pas Bob Morane, que je n’ai jamais lu (de même que je n’ai jamais, au grand jamais, ouvert un volume de la collection Signes de piste, qui n’avaient pas leur place dans la mouvance laïque et dont je n’ai perçu que fort tard, à l’âge adulte, le caractère ambigu). Progressant avec vaillance, toujours chez Marabout, je fis la connaissance du plus merveilleux défenseur de l’esprit mousquetaire comme de l’idéal monarchique, l’immense Alexandre Dumas, éducateur des âmes. Bien plus tard, quand, au lieu de m’ennuyer comme un rat mort à divers cours ex cathedra de l’ULB (je précise : ni ceux de Lambros Couloubaritsis ni ceux de Charles Delvoye), je traînais en bibliothèque et chez les bouquinistes, j’appris la passion pour Dumas de Jacques Laurent, l’un des plus talentueux Hussards.

Je fus ému jusqu’aux larmes quand je sus que mon cher Jacques Laurent ne se résigna à lire Le Vicomte de Bragelonne que peu de temps avant de se tuer, tant l’accablait l’idée même de « voir » la mort de ses amis d’Artagnan et surtout celle, dans la grotte, de Porthos. Si je cite cette anecdote, c’est pour confirmer aux lecteurs que, pour moi, la littérature n’est pas un jeu et que des personnages de roman peuvent devenir des amis.
Un mot encore pour saluer cette collection de poche Marabout avec ses couvertures kitsch et néanmoins fascinantes : il faut dire et redire l’importance historique de cette maison qui, grâce au travail de Jean-Baptiste Baronian, révéla au jeune public Thomas Owen et Jean Ray, les Sortilèges de Ghelderode et les errances de Gérard Prévot, tant d’autres encore. Comment en effet oublier ces beaux recueils, La Belgique fantastique, bientôt suivi de l’Angleterre, de l’Allemagne et de la France ?
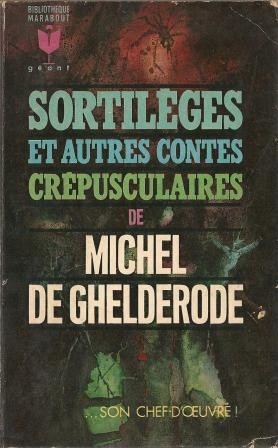
Puis vinrent, à la fin de l’adolescence, les collections de poche « sérieuses », au papier si vite jauni, Press Pocket, Folio, Le Livre de Poche, qui ne portaient pas encore en quatrième de couverture ces satanés codes-barres : Les Tambours de bronze, de Jean Lartéguy ; La 317ème section de Pierre Schoendorffer ; tout Joseph Kessel (Nuits de princes !); Maupassant (Bel-Ami !), Nietzsche et Huysmans, Jünger. En rhétorique, deux chocs, Voyage au bout de la nuit, lu de manière hallucinée en deux jours et une nuit, et Le Rouge et le noir, dégusté dans une sorte de transe.
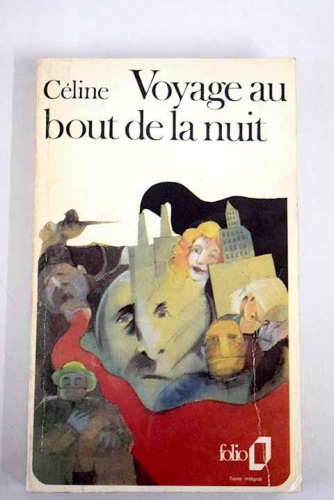
Plus tard viendront les casaques rouge et noir des éditions de la Table ronde (celle de Laudenbach), les livres si originaux de L’Age d’Homme (où j’allais un jour faire mon entrée) et de la collection Alphée des éditions du Rocher, ceux d’une grande maison bruxelloise, les éditions Jacques Antoine, avec leur élégant graphisme, la jolie collection littéraire d’André Versaille chez Complexe…
Dans mes Quolibets, j’ai salué soixante-huit figures d’irréguliers, dont un clandestin capital dont je viens d’apprendre la mort, mon ami Guy Dupré, l’auteur de Les Fiancées sont froides.
Etes-vous d’une certaine manière un « fouineur », « chineur » de bibliothèque, librairie et/ou bouquineries ? On retrouve ça et là cette ambiance de librairie, de bouquinerie dans certains de vos ouvrages, je pense entre autres au narrateur d’Aux Armes de Bruxelles ?
Dans Aux Armes de Bruxelles, mes flâneries urbaines, j’évoque une quinzaine de librairies, dont certaines ont disparu, comme Corman (rue Ravenstein et celle d’Ostende), Libris (y compris l’antenne du Passage 44) ou Pauli (rue de Namur et Porte Louise). Parmi elles, nombre de bouquineries, petit monde que j’ai beaucoup fréquenté en quarante ans et qui, lui aussi, a subi des pertes irréparables, de Henri Mercier, de La Proue, à Jean-Pïerre Canon, de La Borgne Agasse, sans oublier Françoise De Paepe, du Bateau Livre, rue des Eperonniers, qui, vers 1983, me poussa à lire Chardonne et Léautaud.
Pendant près de deux ans, à la fin des années 80, j’ai moi-même été libraire, chez Libris, avenue de la Toison d’Or. J’y ai rencontré le vieux Robert Laffont, l’écrivain Pascal Quignard et quelques autres… Mon grand plaisir était d’être le premier à ouvrir les colis d’offices – les nouveautés.
J’ai passé des centaines d’heures en chasses solitaires chez les libraires, surtout d’occasion, qui, très longtemps, ont occupé la quasi totalité de mes loisirs. Adolescent, puis jeune homme et enfin adulte, j’ai fouiné comme un sanglier dans la forêt, papoté avec les libraires, enregistré dans ma mémoire mille titres et anecdotes glanés dans les rayons, avant de recouvrir mes trouvailles de papier cristal – sans doute le seul travail manuel dans lequel je ne me montre pas totalement manchot.
Dans mon premier roman, Le Songe d’Empédocle, j’ai utilisé en les métamorphosant ces souvenirs de chasse aux livres. Surtout, l’un des personnages du roman est précisément la bibliothèque « borgésienne » du héros … Encore aujourd’hui, malgré le manque de temps, il m’arrive de hanter le Pêle-Mêle et les Petits Riens, Nijinski et Génicot, où je croise les confrères Delperdange et De Decker, Crickillon et Baronian.
Simplement, j’achète bien moins que naguère, conscient que le temps m’est compté… comme la place – j’y reviendrai.
Quant aux bibliothèques, je leur dois maintes découvertes, et ce dès la fin de l’école primaire, quand nos instituteurs nous emmenaient rue de la Paille, à L’Heure joyeuse, tout près du repaire historique du mouvement Cobra. A la fin des Plastic Seventies, je fréquentais la bibliothèque communale d’Ixelles, rue Mercelis – rue mythique (De Coster, Baudelaire, Poulet-Malassis). Je n’oublierai jamais le bruissement des néons de la grande salle, quand je faisais mon choix dans les rayons. Une fois étudiant, j’eus accès aux trésors de la bibliothèque des Sciences humaines de l’ULB (et à son immense salle de lecture avec ses recoins cachés à l’étage), ainsi qu’au Sanctum Sanctorum, je veux dire la Royale, à une époque où le service y était exécrable. Longtemps, je m’y suis morfondu dans l’attente que la lumière rouge daigne enfin clignoter sur ma table de travail, signe que l’ouvrage demandé était arrivé - ou non. L’une de mes victoires fut de pouvoir y occuper, plus ou moins clandestinement, une table à l’étage, avec les vrais papivores blanchis sous le harnais (et quelques toqués mémorables). Pourtant, j’ai toujours préféré travailler chez moi, quitte à photocopier des tonnes d’articles, car, au fond, ce que j’aime, dans les bibliothèques, c’est surtout l’accès direct, qui permet les flâneries… et surtout la rêverie.
Avez-vous un côté bibliophile ? Etes-vous attentif aux tirages de tête, aux reliures, etc.
Bibliophile, je ne le suis guère stricto sensu. Aucun goût pour les grands papiers, de toute façon hors de ma portée en raison de leur prix, et parce que cette pratique sent l’investissement et la thésaurisation. Que certains puissent acheter un livre non coupé et ne pas le lire pour cette raison me dépasse. En revanche, une belle reliure peut me faire envie… pourvu que le texte soit à la hauteur, car ce dernier conserve la priorité absolue. Surtout, un bel envoi, même sur un volume fatigué, me touche, de même qu’une jolie provenance. Je possède ainsi une étude sur Louis Ménard dédicacée à James Ensor, un exemplaire du S.P. du Treizième César de Montherlant adressé à Guy Vaes (deux € au Pêle-Mêle), un Morand dédicacé à Déon et un Abellio à Poulet…
Je ne dépenserai jamais pour cela des sommes folles, n’étant en réalité ni collectionneur ni fétichiste, mais un bel envoi, oui, risque de me séduire. C’est pourquoi, chaque fois que j’ai pu l’obtenir d’un écrivain que j’admirais, j’ai fait dédicacer au moins un de ses livres, sinon davantage. De même, je conserve avec soin la correspondance, parfois volumineuse, que j’ai échangée avec ceux que Matzneff appelle justement les maîtres et complices, de Jünger (qui me cite dans ses Mémoires) à Déon, de Vaes à Vandromme.
Votre bibliothèque personnelle constitue-t-elle un outil de référence pour l’écriture ? Feriez-vous la distinction entre une bibliothèque de travail et une bibliothèque d’agrément au sein de vos collections ? Peut-on y relever un classement ; comment sont rangés les ouvrages, par langue, par auteur, par genre, par affinité, etc.
Ma bibliothèque regroupe quelque cinq mille volumes répartis dans un petit appartement de quatre pièces qui constitue à la fois un oratoire et un laboratoire, un bureau et un refuge, dépourvu du moindre téléphone et même d’internet. J’ai poussé le zèle jusqu’à saboter la sonnette ! Nul n’y a accès ; je garde pour moi le privilège d’y passer l’aspirateur et d’en dépoussiérer les étagères, quand l’envie me prend (deux fois par an). Il n’y a donc que très peu de livres dans l’appartement où je vis (à un autre étage du même immeuble Art déco), à la grande surprise/déception de mes invités : juste quelques coffee table books et les quelques volumes en lecture. Mon épouse pratique de même et dispose d’une chambre de bonne sous les combles, elle aussi pleine comme un œuf.
Outil de référence ? Cela me paraît bien académique : le principal outil, ce sont ce que Hercule Poirot nomme the little grey cells ; puis viennent les réminiscences, les carnets et les archives. Je ne fais pas de différence entre bibliothèques : pour moi, le dictionnaire de Littré, celui de Bertaud du Chazaud pour les synonymes, mon fidèle vieux Grevisse (l’édition de 1950, trouvée pour trente francs aux Petits Riens), les trois volumes du Dupré sont une source inépuisable de plaisirs. Un écrivain digne de ce nom n’est-il pas avant tout philo-logue – amoureux des mots et de la langue qu’il sert, la plume à la main ?
Le classement ? D’une totale subjectivité et juste assez désordonné pour garder son charme. Je me méfie des bibliothèques trop nettes comme je ris sous cape quand je vois tel confrère posant devant ses Pléiades, agglutinés comme à la FNAC.
Chaque auteur y a droit à son espace, parfois important, comme Jünger ou Eliade, Drieu la Rochelle ou Montherlant, Morand ou Barbey d’Aurevilly, Mohrt ou Déon, Waugh ou Léautaud, Le Carré ou Vandromme, etc. J’ai groupé mes auteurs par aire géographique ou historique : les Anciens (les volumes des collections Loeb et Budé), les Irlandais, les Russes, les Belges… Il y a aussi des ensembles plus thématiques : les mythologies, la philosophie, l’esthétique …
Avez-vous besoin d’être entouré de livres pour écrire ? Ou bien pouvez-vous écrire dans un train, un café, etc.
Si je puis prendre des notes un peu partout dans un carnet, j’écris chez moi, dans le silence et entouré de mes amis Littré, Larousse et Cie. Je ne pourrais jamais écrire dans un café – ce qui me paraît souvent une pose, à mes yeux ridicule, celle des faux écrivains, qui veulent être vus en proie « aux affres de la création », comme chantait l’autre.
Pour moi, écrire est un acte intime, solitaire, relevant d’une ascèse toute en gaîté, d’un dialogue muet avec soi-même et avec les maîtres. De toute façon, je dois pouvoir me lever pour gyrovaguer à mon aise, pour me relire à haute voix et tester une phrase. Impensable à La Mort subite !
Les auteurs, les ouvrages que vous citez dans vos livres peuvent-ils être d’une certaine façon vus comme des clins d’œil à des écrivains qui font partie de votre famille littéraire, donc aussi qui composent votre bibliothèque personnelle et intime ?
C’est là une évidence : les exergues, comme les titres, font partie intégrante de l’œuvre ; ils révèlent des filiations et/ou des pistes. Certains sont peut-être des pièges ou des leurres. Si je cite Empédocle ou Léautaud, Huguenin ou Rezzori, il y a bien une raison, qui ne s’explique pas.
Prêtez-vous vos livres facilement ? Mais surtout les récupérez-vous en général aussi facilement ?
Sauf rarissimes exceptions, je ne prête pas mes livres.
Entre ces deux citations, vers laquelle pencheriez-vous ?« Un livre de cuisine, ce n’est pas un livre de dépenses, mais un livre de recettes. » de Sacha Guitry ou « Un livre n’est rien qu’un petit tas de feuilles sèches. »de Jean-Paul Sartre ?
Je refuse de choisir entre l’amusante pirouette de boulevard et la sentence faussement profonde. Depuis les cours de rhétorique, où je fus abreuvé jusqu’à la nausée de sa prose moralisatrice, Sartre m’inspire de la répulsion. Prétendre comme il le fait qu’un livre « n’est rien que » traduit surtout sa sécheresse d’âme.
Je vous en propose donc une troisième, autrement plus fraîche et plus dense, picorée dans Mille roses trémières du regretté Marcel Schneider : « Le rôle de l’écrivain est de créer la vision par le style et de faire passer un courant magnétique entre le lecteur et lui ». Vision, style, courant magnétique, tout est dit. Le reste est bavardage de pédants.
Christopher Gérard
Janvier MMXVIII

Écrit par Archaïon | Lien permanent | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |


