Portrait païen
05 août 2016
Né en 1962 à New York d’une mère d’origine anglo-irlandaise et d’un père brabançon, j’aurais pu devenir a quite American si mes parents n’avaient décidé de revenir en Europe. De fait, j’ai vécu et continue de vivre à Bruxelles, capitale d’un pays bizarre que Baudelaire, cette mauvaise langue, décrivait comme le résultat du mariage de la carpe et du lapin.
La Belgique est un pays fort singulier, difficile à comprendre, car encore très médiéval, traversé de clivages qui peuvent (à tort) prendre l’apparence de frontières : la langue, l’argent (comme partout), la sensibilité philosophique. On appartient au pilier catholique ou laïc – ce qui conditionne le choix de l’école, de l’université, et donc du milieu fréquenté. Du conjoint même.
Né dans un milieu déchristianisé depuis le XIXème siècle – des socialistes purs et durs qui, en 1870, par solidarité avec la Commune, descendirent dans la rue avec le drapeau rouge – je suis le fruit de l’école publique, et fier de l’être. J’ai étudié à l’Université de Bruxelles, créée peu après notre indépendance en réaction à la mainmise du clergé catholique sur l’enseignement (et sur toute la société). Par tradition familiale et scolaire, j’appartiens à ce milieu anticlérical qui a ses ridicules et ses grandeurs, au même titre que la bourgeoisie catholique.
Dès l’âge de douze ans, j’ai eu la chance d’étudier le latin à l’athénée (et non au collège – clivage oblige), un latin exempt de toute empreinte chrétienne : l’Antiquité, la vraie, la païenne, m’a donc été servie sur un plateau d’argent par des professeurs d’exception, de vrais moines laïcs que je ne manque jamais de saluer. Comme en outre, j’ai participé dès l’âge de treize ans à des fouilles archéologiques dans les Ardennes, le monde ancien m’a très vite été familier. J’en parle dans mon essai La Source pérenne, qui retrace mon itinéraire spirituel : en dégageant les ruines d’un sanctuaire païen du Bas Empire, en nettoyant tessons et monnaies de bronze portant la fière devise Soli invicto comiti, en reconstruisant les murs du fanum gallo-romain, j’ai pris conscience de mon identité profonde, antérieure. Ce paganisme ne m’a pas été « enseigné » stricto sensu puisque mon entourage était de tendance rationaliste. Je l’ai redécouvert seul… à moins que les Puissances - celles du sanctuaire ? - ne se soient servies de moi. Les lectures, les fouilles, le goût du latin puis du grec, des expériences de type panthéiste à l’adolescence en forêt, tout cela a fait de moi un polythéiste conscient dès l’âge de seize ans. Depuis, je n’ai pas dévié et n’ai aucunement l’intention de le faire : je creuse mon sillon, en loyal paganus.
Lors de ces fouilles et de ces randonnées, j’ai perçu confusément la présence du divin, la subtile approche des Dieux. Bien plus tard, en Inde, ce sentiment s’est mué en certitude : les Dieux sont partout, innombrables et indifférents à notre sort.
Après mes études secondaires à l’athénée, j’ai choisi d’étudier les langues dites « mortes » (latin et grec) à l’Université, histoire d’approfondir ma connaissance de la pensée païenne. Mon mémoire de fin d’études portait sur l’empereur Julien : une traduction commentée de son Contre les Galiléens, un ouvrage de polémique anti-chrétienne (comme ceux, antérieurs, de deux autres philosophes, Celse et Porphyre).
J’étais alors un jeune lettré, lecteur de Nietzsche, admirateur de Julien et de la résistance païenne. Je vibrais au souvenir de la belle Hypathie, assassinée par des moines fanatiques, les talibans de l’époque. Non sans naïveté, je m’identifiais au sénateur romain Symmaque, à tous les Païens convertis de force par une Eglise avide de pouvoir temporel. A cette époque, je découvris l’existence d’une résurgence païenne, consciente quoique maladroitement camouflée, au XVème siècle, celle du philosophe Pléthon et de sa Phratrie des Hellènes. Le renouveau païen de la Renaissance m’éblouissait, et continue de m’éblouir : les académies platoniciennes d’Italie, les arts régénérés par le retour à l’antique…
Ce jeune lettré urbain que j’étais ne pouvait qu’être révulsé par ce qui me semblait caractériser mon temps : l’inversion des valeurs, l’ostracisme contre toute verticalité, le règne des parodies, la plébéianisation du monde qui meurtrissent et obligent de vivre dans une clandestinité supérieure. Il n’est jamais drôle de participer au déclin d’une civilisation, déclin dont j’ai eu, très jeune, l’intuition profonde. Dans son Introduction à la métaphysique, Martin Heidegger dit l’essentiel sur l’âge sombre qui est le nôtre : « obscurcissement du monde, fuite des Dieux, destruction de la terre, grégarisation de l’homme, suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre ». C’est exactement ce que je ressens depuis le début de ma vie intellectuelle et spirituelle.
Les idéologies séculières, toutes issues de théologies dégénérées, les religions historiques ne répondent pas aux interrogations que pose l’âge sombre, car toutes nient le caractère tragique de l’existence, ce qu’avaient bien compris les Anciens, je veux dire les Païens archaïques – mes modèles. Lire Héraclite, surtout traduit et commenté par Marcel Conche, ou Platon expliqué de façon lumineuse par Jean-François Mattéi, écouter la voix de ces deux Grecs d’aujourd’hui m’ont armé contre l’imposture, fût-elle généreuse en apparence. Retour au réel, refus de toute consolation.
Durant mes études de philologie classique, j’avais découvert, lors d’une vente de livres anciens, un exemplaire d’Antaios, une revue allemande dirigée par Mircea Eliade et Ernst Jünger (1959-1971). Ces deux auteurs faisaient déjà partie de mon panthéon littéraire, et de savoir qu’ils avaient travaillé de concert me combla.
La haute tenue de cette revue, l’éventail des signatures (de Borges à Corbin) et cette volonté de réagir contre le nihilisme contemporain m’avaient plu. A l’époque, au début des années 80, le milieu universitaire se convertissait déjà à ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « politiquement correct », expression confortable et passe-partout à laquelle je préfère celle d’imposture matérialiste et égalitaire.
En 1992, comme il n’existait aucune revue sur le paganisme qui correspondît à mes attentes de rigueur et d’ouverture, j’ai décidé de relancer Antaios, deuxième du nom, dans le but de défendre et d’illustrer la vision païenne du monde, et aussi, je le concède, de me faire quelques ennemis. Jünger m’a écrit assez rapidement pour m’encourager ; il me cite d’ailleurs dans l’ultime volume de ses mémoires. Pour son centième anniversaire en 1995, je lui ai fait parvenir la réplique en argent de la rouelle gallo-romaine qui servait d’emblème à Antaios.
L’esprit de la revue se caractérisait par une ouverture tous azimuts – ce qui m’a été reproché à ma plus profonde jubilation. Le franc-maçon progressiste côtoyait l’anarchiste et le dextriste déjanté ; l’universitaire frayait avec le poète : de Jean Haudry, sanskritiste mondialement connu, à Jean Parvulesco, l’ami d’Eliade et de Cioran, tous communiaient dans une quête des sources pérennes de l’imaginaire indo-européen, de Delphes à Bénarès. Seule l’originalité en ouvrait les portes, ainsi que la fantaisie et l’érudition. Jamais l’esprit de chapelle (présent aussi chez les Païens), qui m’exaspère. Ce fut un beau moment, illustré par les trois aréopages parisiens, où nous reçûmes des gens aussi différents que Michel Maffesoli et Dominique Venner, le libertin et le hoplite. Je suis particulièrement fier des livraisons consacrées à Mithra, aux Lumières du Nord. Quand je suis allé aux Indes et que j’ai montré Antaios à des Brahmanes traditionalistes, j’ai eu la joie d’être approuvé avec chaleur.
La revue m’a mis en contact avec toutes sortes de gens, et bien entendu nombre de Païens : druidisants ânonnant un gaulois de cuisine, wiccans rose bonbon, shamanes du dimanche, militants schizoïdes. Pas mal de zigotos, d’esprits sectaires ; quelques belles figures aussi, conviées à participer à la revue. De cette aventure, j’ai retiré un livre, La Source pérenne. Quelques solides amitiés aussi – l’essentiel. Elle m’a servi de carte de visite lors de mes voyages aux Indes, où j’ai vu vivre des Polythéistes. Mes séjours à Bénarès ont probablement changé mon existence bien davantage que les articles d’Antaios. Qu’est-ce qu’un texte, même bien ficelé (et qui n’est pas un poème) à côté d’un bain dans le Gange, au lever du soleil ? A côté de ces quelques gestes si simples dans les temples ? Du sourire d’une orante ?
Peu après la mise en sommeil de la revue, j’ai commencé à écrire, non plus des textes « sérieux », mais de fiction. Je me suis lentement libéré des blocages mentaux induits par ma formation universitaire (et rationaliste). L’œuvre d’un Michel Maffesoli a fort compté, ainsi que celle de Clément Rosset. Surtout, D.H. Lawrence, M. Yourcenar, E. Jünger, M. Eliade, H. Hesse m’ont nourri … et c’est ainsi que je suis devenu écrivain.
Pour répondre à l’une de vos questions, voilà comment je vis le paganisme : par la magie de l’écriture. Créer de la beauté (le beau n’est jamais faux), comprendre l’ordre des choses me paraissent les plus belles manières de vivre mon paganisme, qui se fonde avant tout sur le gnôthi seauton delphique : « connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et ses Dieux ». Platon, pour définir une beauté associée au vrai et au bien, parle dans le Philèbe de juste proportion des parties et d’harmonie du tout. L’artiste authentique trouve ces consonances entre les parties et le tout ; il glorifie ce qui élève et réjouit l’âme ; il résiste aux sirènes du nihilisme comme aux facilités de la mode. En ce sens, l’art est un sacerdoce. Une rébellion aussi. Comme nombre de Païens d’aujourd’hui, je parle des sincères et des véridiques, j’ai trouvé ma voie dans l’art, un art conçu comme initiatique, qui transforme, et anagogique, qui tire vers le haut. Citons Hölderlin : « Le poète vient des hommes, mais il est exigé par les Dieux ». Ou le grand helléniste d’Oxford C. M. Bowra, qui, dans L’Expérience grecque, dit très justement ceci : « c’est le rôle du poète de saisir la beauté qui se cache dans les choses visibles et invisibles, de perpétuer en paroles les instants d’illumination et d’extase qu’il a connus et de les faire partager aux autres hommes. »
Ce sont ces visions qui me guident dans mon travail, et qui me rendent heureux. Or, je crois en la preuve par le bonheur. Ces bavards qui, en faisant la grimace, vous bassinent les oreilles avec leur souffrance ou leur conception de l’écriture… Ces Païens au visage torturé ou asservis au tabac…
Je ne suis pas amateur de grandes cérémonies, même s’il m’est arrivé de participer à des feux solsticiaux dans les forêts d’Ardenne. Je préfère l’intimité de mon cabinet, mes autels domestiques, et les arbres, dont je ne me lasse pas. Par crainte des parodies et de tout folklore, je préfère la méditation solitaire et la célébration à quelques-uns. Discrétion et intensité.
Dans mon premier roman, Le Songe d’Empédocle, j’ai imaginé une société secrète antique survivant jusqu’à nos jours (et en fait bien au-delà, vu le caractère en partie uchronique du roman), la Phratrie des Hellènes. Le roman illustre un type d’initiation, apollinienne et solaire. Le style aussi, je l’espère. Son héros, Padraig, me paraît une belle figure de Païen contemporain… qui doit beaucoup au scribe, mais aussi à d’autres personnes, notamment des femmes, qui, elles ne trichent pas quand il s’agit de l’essentiel.
Puis j’ai publié d’autres livres : romans, nouvelles, illustrant ma vision polythéiste et panthéiste d’un monde éternel, soumis à des cycles et habité par des puissances sans visage. Epicure et Sénèque sont mes maîtres, avec les Antésocratiques, Héraclite et Empédocle. Et comme je l’ai dit ces Grecs actuels que sont Conche, Mattéi, et bien entendu Rosset, dont La Philosophie tragique est pour moi comme un bréviaire. Rosset retrouve les postures homériques quand il décrit l’homme tragique, sans espoir ni illusions qui « ne consent jamais à s’avouer vaincu et à courber le front ». Tel est à mon sens l’archétype de l’homme européen – l’insoumis.
Si je devais définir mon paganisme, je dirais donc : tragique et serein. Parfaitement étranger à toute forme d’espérance et de quête d’un salut individuel, des fadaises indignes de l’homme libre, qui ne « croit » qu’au destin, le fatum des Romains. Même le mot charité m’exaspère, surtout si elle implique une forme mortelle de masochisme. Solidaire, oui, mais de manière conditionnelle. Quant à l’amour abstrait, à la malsaine préférence pour le lointain, au goût masochiste pour l’expiation de péchés imaginaires, non merci.
Face à l’assaut migratoire que nous subissons aujourd’hui dans sa phase aiguë, tétanisés et culpabilisés par diverses officines, dont celle du pape des Chrétiens, cette charité mal comprise et instrumentalisée par des esprits sournois et décadents risque de nous être fatale. Grimée en amour de l’autre, la haine de soi fera couler des fleuves de sang.
Mes souhaits pour l’avenir ?
Que les Européens retrouvent leur fierté, ce génie qui a créé le Parthénon et Versailles, Lascaux et la Sixtine. Que s’effondre ce culte abject de la marchandise qui défigure les visages, décompose les corps et ruine les âmes. Que le sacro-saint marché cesse d’incarner la valeur suprême. Que le culte parodique du dieu jaloux qui a pour prophète tel « chamelier péninsulaire » perde le plus de terrain possible ici comme ailleurs. Qu’une prise de conscience globale permette de purifier notre planète des déchets dont nous la saturons. Qu’Apollon et Aphrodite, pour parler grec, guident à nouveau les hommes libres, ceux qui prient debout.
Mars MMXVI


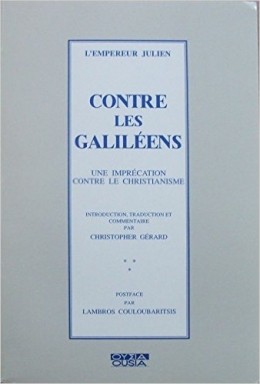


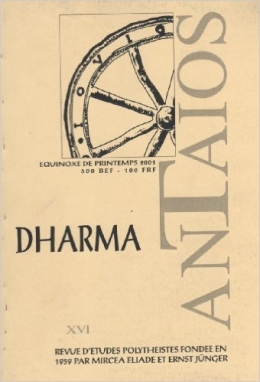
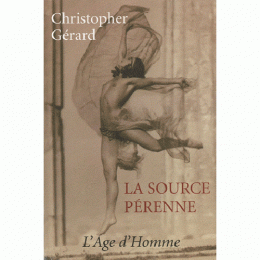


Les commentaires sont fermés.