La Mémoire vive d'Alain de Benoist
16 juillet 2012
Rencontre avec Alain de Benoist
A l'occasion de la parution de Mémoire vive.
Entretiens avec François Bousquet, Ed. Bernard de Fallois.
Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Un clerc étranger à son siècle ? Si tel est le cas, que lui reprochez-vous, à ce siècle ? Auriez-vous voulu vivre à une autre époque ? Laquelle ?
Je suis d’abord un essayiste, plus précisément un théoricien, quelqu’un qui depuis bientôt un demi-siècle s’intéresse avant tout à la philosophie politique et à l’histoire des idées. J’ai beaucoup publié, je dirige plusieurs revues. Mais dire ce que l’on fait suffit-il à se définir ? Ceux qui veulent en savoir plus devront lire Mémoire vive. Un « clerc étranger à son siècle » ? Sans doute. Je pourrais même dire un « Martien en exil », pour reprendre l’expression de Pierre Gripari. Mais je ne parlerais pas de « siècle ». Celui que nous vivons actuellement n’en est même pas à son premier quart, et il est trop tôt pour porter sur lui un jugement d’ensemble. D’autant que le monde n’a jamais été si incertain. Les anciens dieux sont morts, les nouveaux ne sont pas encore apparus, ce qui signifie que les repères qui nous étaient familiers s’effacent peu à peu, tandis que nous pouvons seulement imaginer ceux qui s’imposeront à nous dans l’avenir. Nous vivons un Zwischenzeit, une époque de transition. Mais il est bien vrai que dans cet entre-deux, que j’observe attentivement, je ne me sens guère à mon aise. Je suis à la fois dans le monde et étranger à ce monde. En état de sécession mentale, pourrait-on dire. Et comme cet état prend la forme d’une rébellion, peut-être faudrait-il dire que je suis engagé dans une guerre de sécession !
Cornelius Castoriadis disait que nous vivons une « époque de basses-eaux ». C’était encore trop peu dire. Nous sommes entrés dans un monde où tout ce qui était solide et durable et devenu transitoire et insignifiant. Un monde de flux et de reflux, relevant d’une sorte de logique « maritime » et liquide. Les types humains qui prédominent sont ceux du narcissique immature, de l’arriviste forcené, de l’imposteur satisfait. Mélange d’intolérance sectaire et d’hédonisme de bas niveau sur fond d’idées fausses et d’hygiénisme puritain. La constante progression de l’inculture me désole également. L’inculture n’est certes pas nouvelle. Sans doute était-elle même plus répandue dans le passé qu’elle ne l’est aujourd’hui, mais au moins ce n’étaient pas les incultes qui donnaient le ton. Ceux qui étaient incultes dans le domaine des choses de l’esprit avaient en outre une autre forme de culture, pratique, existentielle, liée à un certain rapport à la nature et à des types de savoir-faire auxquels la dissolution du monde rural a mis fin. Cela ne nourrit cependant chez moi aucune forme de restaurationnisme. J’ai toujours regardé avec suspicion l’idée selon laquelle c’était « mieux avant ». Nous avons généralement tendance à idéaliser le passé, à en tirer des fantasmes que nous opposons au présent. Cela dit, oui, il y a des époques que j’aurais aimé connaître. L’antiquité pré-chrétienne, qui me paraît rétrospectivement si merveilleusement autosuffisante, est l’un de mes univers de prédilection. J’aurais aimé connaître Athènes au Ve siècle av. notre ère. Y vivre ? Je ne sais pas.
Quelles sont les grandes lectures (littéraires) de jeunesse, ces livres qui vous ont marqué de façon inoubliable ?
Je raconte dans Mémoire vive à quel point j’ai dès l’enfance été boulimique de lectures de toutes sortes. Bien entendu, il ne suffit pas de lire beaucoup pour lire bien. Cela ne s’acquiert qu’avec le temps. On s’aperçoit alors que certaines lectures étaient destinées à tomber plus que d’autres dans un cœur préparé. Mais enfin, il y a quand même des livres qui vous marquent plus profondément, pour des raisons que l’on perçoit mal quand on y réfléchit maintenant et que, parfois, on ne comprend même plus du tout. C’est la même chose avec les films. Qui n’a pas revu à l’âge adulte avec une certaine déception un film qui nous avait pourtant marqué à l’extrême dans notre toute première jeunesse ? Lorsque j’avais quatorze ou quinze ans, je lisais avec passion Charles Dickens, Conan Doyle, Hector Malot ou Edgar Poe, mais j’adorais surtout deux auteurs assez mineurs, et un peu oubliés aujourd’hui, Hervé Bazin (Vipère au poing) et Gilbert Cesbron (Chiens perdus sans collier). J’aimais les histoires dont des enfants étaient les héros, et souvent les victimes, dans des contextes où les caractéristiques sociales étaient nettement marquées. J’aimais aussi tout ce qui pouvait, à l’inverse, m’emmener vers un lointain ailleurs : les grands romans de science-fiction genre Asimov, Richard Matheson ou Robert Henlein, ou bien les surréalistes. Mais je ne veux pas commencer à énumérer des auteurs, car on n’en finirait pas.
Et à l’âge adulte, les grands chocs littéraires ? Céline ?
Jusqu’à l’âge d’environ seize ans, je n’ai lu que de la littérature. Ensuite, j’ai commencé à lire des essais, qui se sont progressivement imposés au détriment des romanciers et des poètes. Aujourd’hui, je dois avouer que je ne lis pratiquement plus que des essais, à la fois par obligation « professionnelle » et par manque de temps. La production littéraire actuelle m’attire assez peu, à tort peut-être, car il doit bien y avoir des exceptions contrastant avec le flot de médiocrité qui se déverse en librairie. Mes vrais grands chocs littéraire de l’âge adulte, c’est donc surtout entre vingt et trente ans que je les ai connus. Il y a Céline, bien sûr, plus encore d’ailleurs pour Mort à crédit que pour Voyage au bout de la nuit. Le génie de l’écriture célinienne est si puissant qu’il oblige, une fois qu’on l’a fréquenté, à reconsidérer toute l’histoire de la littérature. Un autre choc a été ma rencontre avec l’œuvre de Montherlant, qu’il s’agisse de ses essais (Service inutile), de ses romans (Les jeunes filles) ou de son théâtre (La reine morte). La série des Jeunes filles (Pitié pour les femmes, Les lépreuses et Le démon du bien) est très certainement à l’origine de l’intérêt passionné que j’ai toujours porté à l’étude des psychologies masculine et féminine. Montherlant est à mes yeux l’exemple même de l’auteur classique. Il m’arrive fréquemment de prendre presque au hasard l’un de ses livres dans ma bibliothèque, et d’en lire quelques pages prises également n’importe où. Je retombe immédiatement sous le charme. Céline n’avait aucune sympathie pour Montherlant, dont l’écriture est en effet bien différente de la sienne. La postérité a d’ailleurs consacré le premier, tandis qu’elle oublie scandaleusement le second. Moi, je les aime autant l’un que l’autre, sans doute parce qu’ils touchent des aspects opposés mais également présents de ma personnalité.
Enfin, il y a eu Les deux étendards de Rebatet, ce roman-fleuve organisé comme un opéra wagnérien, qui m’a fait d’autant plus d’impression que je m’y suis projeté totalement. L’histoire d’Anne-Marie, dont Michel et Régis se disputent les faveurs, m’évoquait un amour absolu que j’avais moi-même connu dans mon adolescence. Je m’identifiais tour à tour à Régis le théologien et au très voltairien Michel. Qu’il se soit agi d’une histoire vraie (Michel est évidemment Rebatet, mais Anne-Marie et Régis ont également existé), quoique transfigurée et même sublimée par l’imagination romanesque, me touchait aussi.
Les écrivains - poètes ou romanciers ? - que vous relisez aujourd’hui et relirez demain ?
Je n’ai guère le temps d’en relire. Mais j’aimerais me replonger dans Zola, dans Flaubert, dans Stendhal, dans Dostoïesvki. Il serait peut-être temps aussi que je lise sérieusement Proust ! A l’occasion, quand même, outre Montherlant, je relis volontiers les romans de Koestler ou de Steinbeck, qui m’avaient fait forte impression dans ma jeunesse. Cependant, je préfère avant tout relire les auteurs de l’Antiquité. Quelques pages d’Homère, de Plutarque, de Cicéron, de Marc-Aurèle, voilà qui aide à supporter le temps maussade dans lequel nous vivons.
En près de cinquante ans de journalisme, par exemple au Figaro magazine à l’époque de Louis Pauwels, vous avez rencontré une pléiade d’artistes, toutes disciplines confondues. Quels sont ceux qui vous ont laissé l’impression la plus profonde ? Je songe, pour les seuls écrivains, à Koestler, Abellio…
Dans Mémoire vive, je consacre en effet bien des pages à évoquer les rencontres que j’ai faites. J’ai été lié d’amitié avec Arthur Koestler et Raymond Abellio jusqu’à la fin de leur vie, et j’en garde un souvenir particulièrement vif. Les deux hommes étaient bien différents, mais certains aspects de leur vie les rapprochaient. Koestler avait adhéré successivement au communisme et au sionisme, avant de s’en détacher violemment. Il avait aussi participé à la guerre d’Espagne du côté républicain (son Testament espagnol figure, lui aussi, parmi les livres qui m’ont infiniment marqué). J’allais lui rendre visite à Londres, où nous parlions surtout d’histoire des idées, et de son intérêt passionné pour les courants scientifiques « hétérodoxes ». A cette époque, il s’intéressait aussi à la parapsychologie. Il opposait à la théorie de Darwin des arguments auxquels j’essayais de répondre. C’était un homme intense, d’où émanait une puissance extraordinaire, qui le faisait ressembler à un lion.
Raymond Abellio, lui, avait d’abord appartenu à l’intérieur du parti socialiste à la tendance dite de la Gauche révolutionnaire. A l’époque du Front populaire, il avait travaillé au ministère de l’Economie nationale, puis à la présidence du Conseil. Fait prisonnier en mai 1940, il avait à son retour à Paris rejoint la Collaboration, avant de se mettre au service de la Résistance ! A la Libération était intervenue ce qu’il devait appeler lui-même sa « seconde naissance ». Devenu Raymond Abellio (il n’était jusque là que Georges Soulès), il devait se consacrer exclusivement à l’étude de l’ésotérisme, à l’« histoire invisible », à la « phénoménologie génétique », et mettre au point un modèle de « structure absolue » qui a marqué bien des esprits. Tout comme Koestler, c’était à la fois un esprit libre et un perpétuel dissident, qui m’a toujours manifesté une extrême gentillesse. J’avais l’habitude de le voir dans son petit appartement du 16e arrondissement de Paris, où nous nous lançions dans des discussions sans fin. Je me souviens de son visage massif, de ses grosses lunettes qui ressemblaient à des hublots. Ses plus grands romans, La tour de Babel et Visages immobiles, m’ont beaucoup marqué également, mais comme pour beaucoup d’autres « romans d’idées », ce n’est pas sous l’angle littéraire que je les appréciais le plus. Abellio, au demeurant, n’était pas un grand styliste, mais l’un des hommes les plus intelligents qu’il m’ait été donné de connaître.
Une amitié aussi ancienne que profonde vous lie à Gabriel Matzneff. Quelle en est l’origine et en quoi cet écrivain, sans doute l’un de nos tout grands stylistes, vous paraît-il exemplaire ?
Gabriel Matzneff est un ami d’un demi-siècle, puisque j’ai fait la connaissance à la fin de l’année 1962, sans doute par l’intermédiaire de François d’Orcival. C’était à peine quelques mois avant que « Gab la Rafale » ne commence à publier dans le journal Combat ces fameuses chroniques de télévision (sans grand rapport avec la télévision !) qu’il a eu la bonne idée de publier récemment en volume. Depuis cette date, nous déjeunons ou dînons régulièrement. De l’amitié est vite née entre nous. Ce que je trouve remarquable chez lui, c’est d’abord la façon dont il a très jeune acquis son style : il suffit aujourd’hui encore de lire Le défi pour voir que la formidable qualité d’écriture qui le caractérise était déjà là ! J’aime aussi la façon dont, tel Montherlant, il a su tirer de sa vie personnelle la trame de romans qui ont une portée générale, parce que les personnages y sont transfigurés. Ses carnets intimes, qui l’ont souvent fait accuser de « nombrilisme » par les esprits cul-de-plomb, ne relèvent à mes yeux nullement de l’exhibitionnisme. Ils manifestent plutôt une sorte de candeur qui va de pair avec sa liberté d’esprit, sa manière aérienne d’être tout naturellement au-dessus des choses et des êtres. Il y a de la danse dans sa façon d’écrire, comme il y a de l’inspiration « claire », solaire faudrait-il dire, dans sa manière d’exister. J’aime encore la façon dont, selon les règles de l’alternance, il n’exclut rien – sinon la mauvaise foi et la sottise – de tout ce que la vie peut lui offrir, la façon par exemple dont il peut défendre aussi bien Nietzsche que Pascal, Schopenhauer que Sénèque et saint Augustin. Gabriel Matzneff est un grand écrivain français, mais aussi un homme qui est instinctivement au-delà des modes éphémères, de la pensée toute faite, des sermons des nouvelles ligues de vertus. J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire dans le volume d’hommages qui lui a été consacré l’an dernier : les gens qui n’aiment pas Matzneff me sont immédiatement antipathiques. Et si j’ai un regret concernant Mémoire vive, c’est bien de n’y avoir pas plus longuement parlé de lui !
Impossible, avec le chef de la « nouvelle droite » (quoi que l’on pense de l’appellation, que vous avez été le premier à critiquer) de ne pas parler de « la droite ». En fin de compte, comment définiriez-vous sa substantifique moelle ?
Les étiquettes, c’est pour les pots de confiture ! La conclusion à laquelle je suis depuis longtemps parvenu concernant le clivage droite-gauche, c’est qu’il ne correspond pas à grand-chose. Les politologues ne sont jamais parvenus à identifier, d’une manière incontestée, un critère permettant de regrouper toutes les droites d’un côté, ou toutes les gauches de l’autre. Selon les époques et les lieux, la diversité est trop grande et, quel que soit le critère retenu, on trouvera toujours des exceptions. Né avec la modernité, le clivage droite-gauche tend à s’effacer avec lui. Il ne se maintient plus, à grand peine, que dans le domaine de la politique parlementaire, où les élites dominantes cherchent par tous les moyens à perpétuer un bipartisme garantissant une alternance, mais pas une alternative. Même en ce domaine, la volatilité électorale confirme ce que révèlent régulièrement les sondages : la droite et la gauche sont en proie à une crise d’identité profonde, et la plupart des gens ne voient plus vraiment ce qui les distingue. Au demeurant, tous les grands événements de ces dernières années ont fait surgir de nouveaux clivages, au regard desquels la grille d’interprétation en termes de droite et de gauche est devenue obsolète (le populisme, pour ne citer que lui, peut être aussi bien de droite que de gauche, la critique de la mondialisation également). Tout ce que l’on peut dire, avec prudence, c’est qu’il y a une mentalité de droite (qu’on trouve parfois aussi à gauche) et une mentalité de gauche (qu’on trouve aussi parfois à droite). A cette mentalité de droite, on pourrait associer certains traits caractéristiques, comme le sens du particulier, de préférence à l’universel, l’adhésion à l’éthique (tout particulièrement à l’éthique de l’honneur, qui est indissociable de l’esthétique) plutôt qu’à la morale, etc. Mais encore une fois, il y a toujours des exceptions. Sur les questions politiques, économiques et sociales, il y a d’ailleurs aujourd’hui autant de désaccords « à droite » qu’il y en a « à gauche ». La « substantifique moëlle », pour autant qu’il y en ait une, est encore à trouver !
A vos yeux, existe-t-il une droite littéraire ? Incarnée hier, et aujourd’hui ?
J’ai beaucoup de mal à répondre à cette question, parce que je la trouve à la fois trop large et un peu réductrice. Historiquement parlant, je ne vois que deux périodes où l’on peut, en France, parler véritablement de « droite littéraire ». D’abord à la fin du XIXe siècle, à l’époque des « grands réactionnaires », comme Barbey d’Aurevilly et Villiers de l’Isle-Adam, auxquels on peut adjoindre Léon Bloy, voire dans une certaine mesure Baudelaire. Ensuite les années 1950, avec l’école des « hussards » (Déon, Blondin, Nimier, Jacques Laurent) et des revues comme La Parisienne et surtout La Table ronde. C’est aussi l’époque de Marcel Aymé et de Jacques Perret. Mais en dehors de cela ? Paul Morand, Pierre Benoit ou Montherlant n’étaient certainement pas des auteurs de gauche, cela suffit-il à en faire des écrivains de droite ? Aujourd’hui, il y a certainement d’autres noms que l’on pourrait citer. Mais je ne suis pas sûr qu’ils relèvent véritablement d’une « droite littéraire ». On pourrait d’ailleurs aussi se demander s’il y a une « gauche littéraire » aujourd’hui…
Pour finir, la question : combien de livres possédez-vous ?
Environ 200 000 mais, c’est bien connu, quand on aime on ne compte pas ! C’est évidemment une bibliothèque de travail, et qui doit autant à ma « collectionnite » qu’à ma passion pour les différents domaines du savoir. De toute façon, je l’ai déjà dit, ce n’est pas le nombre de livres que l’on a lus qui importe, mais la manière dont on les a lus et ce que l’on en a retiré. Si j’avais à dresser le catalogue d’une « bibliothèque idéale », il ne compterait sans doute pas plus de cinq cents titres, ce qui est déjà beaucoup.
Juillet MMXII
Propos recueillis par Christopher Gérard
On dit du mal d'Alain de Benoist dans Les Nobles Voyageurs


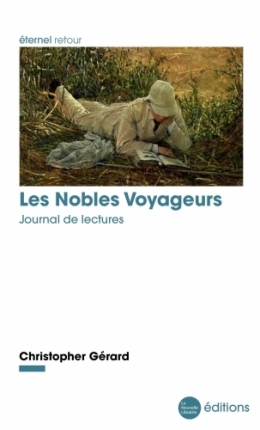
Les commentaires sont fermés.